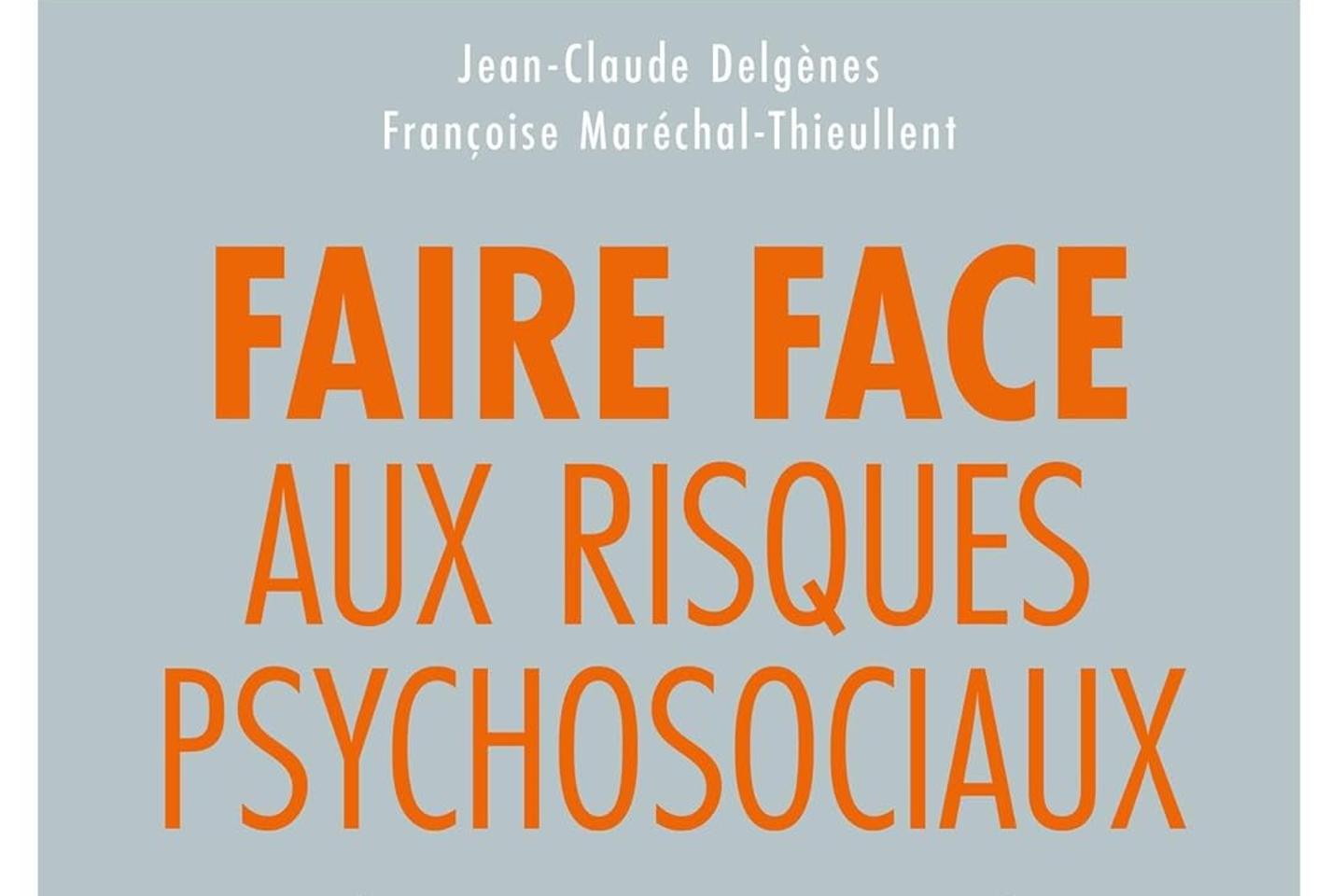Argentine : la réforme du travail de Javier Milei adoptée à l’Assemblée malgré une journée de grève générale

Les députés argentins ont adopté, dans la nuit de jeudi à vendredi 20 février, la loi sur la réforme de la législation du travail voulue par le président ultralibéral Javier Milei. Amendée par la chambre basse, qui l’a adoptée par 135 voix contre 115 après presque onze heures de débats, la loi dite de « modernisation du travail » doit désormais retourner au Sénat pour approbation définitive, étape que le gouvernement espère franchir la semaine prochaine. Le président Milei s’est félicité sur X du résultat du vote des députés, affirmant que la réforme « est destinée à en finir avec plus de 70 ans de retard dans les relations du travail des Argentins ».
Toute la journée de jeudi, l’Argentine a été paralysée par une quatrième grève générale en un peu plus de deux ans de mandat de M. Milei. Comme la semaine dernière, une manifestation largement pacifique a rassemblé plusieurs milliers de personnes aux abords du Parlement, avant de dégénérer en accrochages entre quelques dizaines de personnes et la police. Bouteilles et pierres ont volé en direction des forces de l’ordre, qui de leur côté ont fait usage de lacrymogènes, canons à eau et balles en caoutchouc, avant finalement d’avancer en force pour dégager la place, a constaté l’Agence France-Presse (AFP). Une dizaine de personnes ont été interpellées.
La grève de 24 heures a eu un suivi « très important », a affirmé Jorge Sola, codirigeant de la CGT (pro-péroniste, centre-gauche), principale centrale, revendiquant une activité arrêtée « à 90 % ». Le mouvement a été largement suivi dans les transports aériens et ferroviaires, ainsi que par les bus. A Buenos Aires, les aéroports et les gares étaient vides, a constaté l’AFP. La compagnie aérienne nationale Aerolineas Argentinas avait annoncé plus de 250 vols annulés.
La capitale a offert un visage contrasté : trafic de voitures plus dense qu’à l’accoutumée mais des arrêts de bus, d’habitude bondés, vidés. Et une grande majorité de commerces ouverts, bien que certains privés d’employés, retenus faute de transport. Dans l’air flottaient des relents d’ordures amoncelées dans la chaleur de l’été austral, faute de ramassage depuis 24 heures.
Regain de tension sociale
Le chef de cabinet des ministres (sorte de premier ministre) Manuel Adorni a fustigé une grève « perverse », une « extorsion », car « pour autant que les gens aient envie de travailler, si on leur coupe le transport, ils ne peuvent pas ».
La grève illustre un regain de tension sociale, quatre mois après le succès de Javier Milei aux législatives de mi-mandat. Projet-clé de la seconde moitié du mandat de M. Milei, la réforme facilite les licenciements, réduit le barème d’indemnités, rend possible l’extension de la journée de travail jusqu’à 12 heures, étend les services dits « essentiels » en cas de grève et autorise le fractionnement des congés.
Pour l’exécutif, ce texte va permettre de doper l’embauche dans une économie qui compte plus de 40 % d’emploi informel. Notamment en freinant ce que le gouvernement dénonce comme « l’industrie des procès », une judiciarisation à outrance du monde du travail. « Pas une modernisation, une précarisation », rétorque la CGT, qui dénonce un texte « régressif et anticonstitutionnel ».
M. Milei compte boucler sa réforme totem d’ici le 1ᵉʳ mars, pour son discours annuel au Parlement. En attendant, loin de la grève et des tensions, il assistait jeudi à Washington au « Conseil de paix » de son allié Donald Trump. Au pouvoir depuis décembre 2023, il a enregistré un succès macro-économique majeur face à l’inflation, ramenée de plus de 150 % à 32 % en interannuel. Mais aux prix d’une austérité budgétaire et de coupes dans l’emploi public qui ont anémié consommation et activité. En deux ans, près de 300 000 emplois ont été perdus, public et privé confondus.