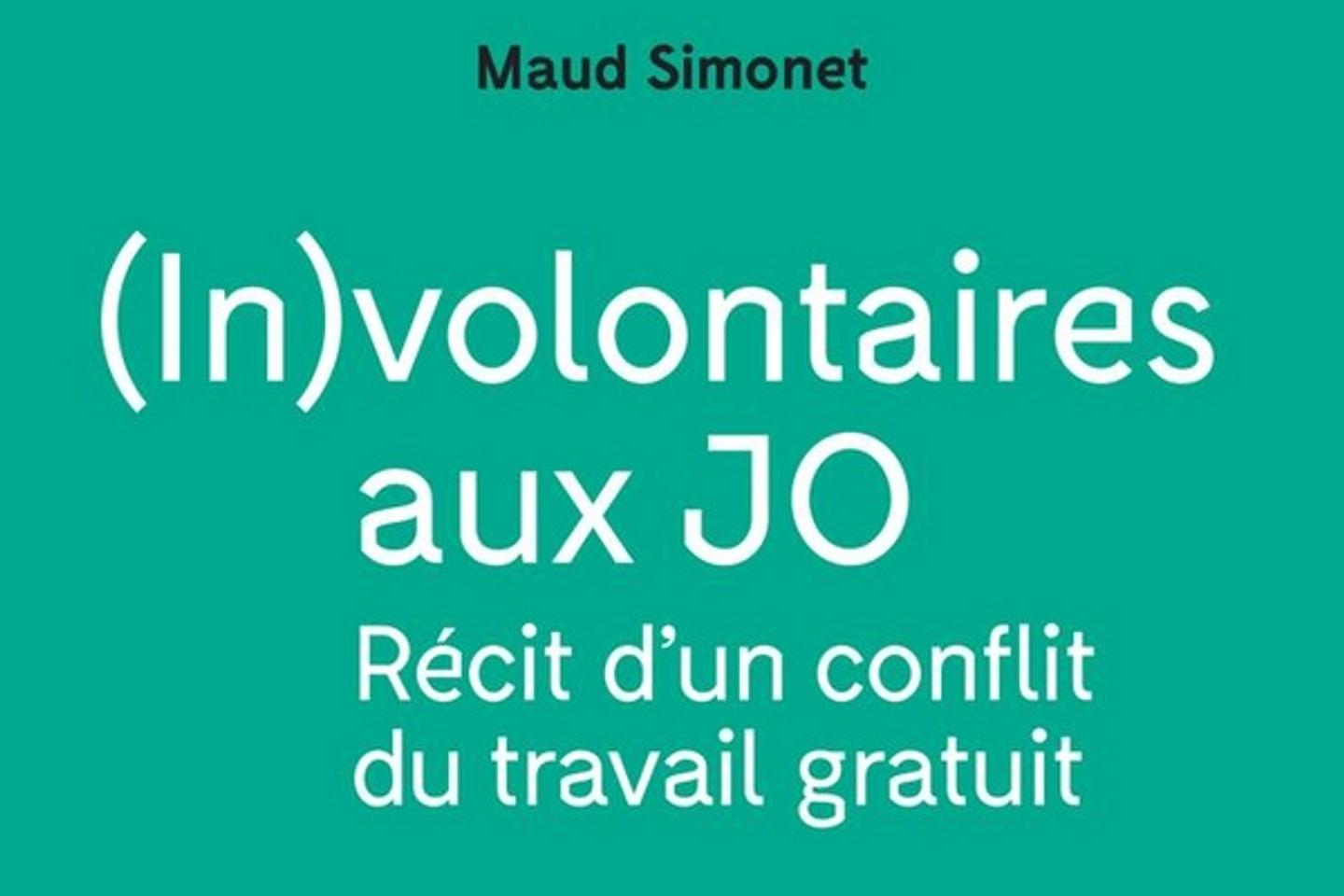Le vieillissement et la féminisation des actifs propices à l’absentéisme

Douze milliards d’euros : c’est le montant des indemnités journalières versées en 2024 par la branche maladie de la Sécurité sociale aux salariés absents pour cause de maladie ou d’accident du travail. Ce coût, en progression, est lié à la revalorisation des indemnités, mais aussi à la montée de l’absentéisme, supérieur à la période pré-Covid-19.
Cela dit, le phénomène se transforme. « Depuis la pandémie, on observe un basculement », a rappelé Denis Ferrand, directeur général de l’institut d’études Rexecode, lors d’un séminaire sur les causes de l’absentéisme organisé, mardi 9 novembre, au ministère de l’économie, à Paris. Si le nombre d’arrêts maladie se tasse sous l’effet de l’instauration de jours de carence non indemnisés, la durée moyenne de ces arrêts s’allonge, du fait notamment de l’augmentation de troubles de la santé mentale, plus longs à soigner.
De nombreux facteurs expliquent l’absentéisme : durée du travail excessive, manque d’autonomie et de reconnaissance, insécurité de l’emploi, management toxique… Il affecte davantage certains profils : du fait de la pénibilité et de la dangerosité de leur métier, les ouvriers sont plus absents que les cadres.
Parce qu’elles supportent une plus grande part des tâches domestiques et d’aidance de leur entourage (enfants ou parents malades ou dépendants), sont surreprésentées dans des métiers exigeants et peu gratifiants (soins aux personnes, ménage…), endurent des problèmes spécifiques de santé, les femmes le sont davantage que les hommes. Les seniors, enfin, s’arrêtent plus souvent que les jeunes, du fait de l’usure professionnelle quand il s’agit de métiers éprouvants, ou simplement du vieillissement, qui fragilise leur santé.
En France, la féminisation et le vieillissement de la population active, mais aussi la persistance d’un management vertical réputé de moindre qualité, expliqueraient une bonne partie de la hausse, ces facteurs l’ayant manifestement emporté sur les tendances inverses (déclin du nombre d’ouvriers au profit des cadres). Membre CFDT du Comité économique et social européen de 2015 à 2025, Franca Salis-Madinier émet, pour sa part, une hypothèse complémentaire : la hausse de l’absentéisme pourrait aussi relever d’une forme silencieuse de protestation individuelle, qui se substituerait aux moyens collectifs, comme la grève, dont la pratique s’est effondrée avec l’affaiblissement des syndicats.
Il vous reste 47.02% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.