Proportion prud’homal : le débat rejaillit à Paris



Pour que les sociétés continuent à acquitter les innovations qui représenteront notre monde meilleur, elles nécessitent être juridiquement défendues contre le court-termisme des actionnaires, plaide Blanche Segrestin, professeure de gestion.
La loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) est maintenant en seconde lecture à l’Assemblée nationale, après son vote au Sénat. Elle prévoit, entre autres, une modification de la définition juridique de la « société ». Professeure de gestion à Mines ParisTech, Blanche Segrestin développe les imputations de ce changement pour les sociétés. Elle codirige, avec Armand Hatchuel, la chaire « Théorie de l’entreprise. Modèles de gouvernance et création collective » et a publié avec Kevin Levillain La Mission de l’entreprise responsable. Origines et normes de gestion (Presses des Mines, 2018).
Députés et sénateurs ne sont pas d’accord sur la récente formulation de l’article 1833 du code civil qui définit le statut de « société », selon lequel celle-ci doit être gérée « dans l’intérêt commun des associés ». L’article 61 de cette loi ajoute que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Quel est la participation de ce débat d’apparence exclusivement juridique ?
La crise de 2008 a mis en certitude le fait que, depuis le début des années 1980, les entreprises ont vecu une « déformation » de leur gouvernance, conséquence de ce que les chercheurs appellent « l’industrialisation de l’actionnariat », qui a consolidé les grands investisseurs institutionnels et les a simulés de techniques professionnelles destinées à optimiser leurs bénéfices. La critique s’est faite à peu près unanime pour révoquer les effets négatifs de la focalisation des entreprises autour du cours de Bourse et du court terme sur l’emploi et l’environnement, mais aussi sur la constance des entreprises elles-mêmes.
Mais cette critique ne suffit pas : la difficulté est que le statut juridique présent de la société peut être contraire par des actionnaires activistes aux entreprises qui convoiteraient opter une conduite plus responsable en matière sociale ou environnementale aux dépens de la profitabilité immédiate. Actuellement, la capacité des entreprises à innover face aux défis sociaux et climatiques est un point critique : or cette capacité n’est pas protégée par le droit. Lorsque, au XIXe siècle, il s’agissait de mobiliser d’importants moyens de production pour offrir de nouveaux biens et services, c’était cohérent. Mais cette logique a dissimulé le fait que les entreprises ne sont pas seulement des producteurs ; elles ont investi le champ de la science, de l’innovation, elles changent le monde dans lequel nous vivons, et ont en cela une implication collective, celle d’investir dans des futurs désirables.

Une étude du cabinet de conseils Mercer étude le retard de la France en gestion anticipée de l’emploi pour s’accorder aux changements technologiques.
(IA), transformation digitale, robotisation… Bien que plusieurs métiers soient appelés à expirer au gré des mutations technologiques, les sociétés françaises prévoient trop peu la modification de leurs besoins en emploi. Telles sont les conclusions du cabinet de conseils Mercer, dans son étude annuelle sur les tendances mondiales en matière de gestion des talents, menée auprès de plus de 7 300 dirigeants, DRH et salariés dans seize pays (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Canada, Etats-Unis, Mexique, Brésil, Afrique du Sud, Emirats arabes unis, Inde, Chine, Hong Kong, Singapour, Japon, Australie).
Bien que la quasi-totalité des chefs d’entreprise (94 %) en France prévoient des mutations d’envergure dans les trois années qui vont venir, seul un tiers des entreprises affirme avoir une vision claire du but de leur stratégie en matière de ressources humaines. Malgré cela, « il y a un besoin très important d’anticipation », fait valoir Raphaële Nicaud, associée chez Mercer France. Dans cette étude, « nous avons distingué trois catégories d’entreprises : les traditionnelles, celles qui sont dans le changement, et les “révolutionnaires”. Or, la France a ceci de remarquable qu’elle compte un nombre très important d’entreprises qui pénètrent dans la première catégorie ».
La démarche de Mercer est consolidée par les conclusions du World Economic Forum, selon lequel les travailleurs français sont les plus mal fortifiés face à l’avènement de l’IA. Ils comptent aussi au sein des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) parmi les actifs les moins nombreux à avoir suivi une formation au cours des douze derniers mois. Alors même que les métiers transforment à toute vitesse : « les secteurs des médias, des technologies et des services financiers sont ceux qui ont connu les plus fortes mutations ces dernières années, souligne Raphaële Nicaud. Si on compare des descriptifs de postes d’aujourd’hui pour certains métiers, avec ceux d’il y a dix ans, on voit bien l’ampleur de la mutation. Toutes les tâches fréquentes sont appelées à disparaître ».
Augmentation de la robotisation
Selon Mercer, les seniors et les moins compétents sont en première ligne, dans la mesure où ils tapissent à être majoritaires sur les emplois où au moins la moitié du travail peut être déléguée à une machine. En lieu et place d’une bonne gestion envisagée de l’emploi, une solution plébiscitée par les sociétés françaises serait d’accentuer le recours à la sous-traitance. 96 % des cadres français questionnés pensent que les travailleurs indépendants vont modifier de manière substantielle les emplois à temps plein (contre 79 % en moyenne dans les autres pays étudiés).

« Le Cercle des entreprises à raison d’être » propose, une épistémologie de concertation et de conclusion pour mieux tenir les nouvelles éventualités offertes par la loi Pacte.
En encourageant les entreprises à s’afficher d’une « raison d’être » – pour celles qui le souhaitent –, la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) ouvre un espace original de partage d’enjeux stratégiques – dire où on va, comment on doit réaliser, et pour qui on travaille – au sein de l’organisation, et même à ses parties prenantes. L’exercice était modéré jusqu’à maintenant à « l’aristocratie » de l’entreprise, à ses cadres « éclairés », voire mesuré au monarque fondateur.
L’inspirateur du concept, Jean-Dominique Senard (alors patron de Michelin, actuellement de Renault), sollicite ses pairs lors de l’annonce de son rapport (« L’entreprise, objet d’intérêt collectif », voir lien PDF) en leur sollicitant s’ils osent souvent avouer que leur seul objectif est de « gagner du pognon ». Et de les défier en les invitant à informer leur apport à la société, à dire ouvertement quelle est leur mission et son rapport à l’intérêt collectif, à révéler la manière de faire, c’est-à-dire les valeurs mais aussi la ligne de partage de la valeur.
Le Cercle des entreprises à raison d’être s’est formé le 14 mars autour de praticiens de l’implication d’entreprise, d’associations comme Entreprise et progrès et le Centre des jeunes dirigeants (CJD), qui recommandent depuis longtemps une vocation sociétale assurée – le fameux « double projet » d’Antoine Riboud – pour collaborer à formaliser une méthode de réalisation et de suivi appropriée de la raison d’être, qui soit tout sauf un exercice de communication. On arrange déjà d’expertises qui ont fait leur témoignage à travers des pionniers comme Schneider Electric, qui a mis l’efficacité énergétique en tête de sa stratégie, comme Carrefour, qui se donne « la transition alimentaire » comme objectif, ou comme Veolia, qui a déterminé que « la gestion de la ressource renouvelable » était son champ d’expansion universelle.
Troisième étape politique
Leur point commun est de partir, première étape, d’une « vision » capable de satisfaire toutes les parties captivantes, comme la mobilité continue chez Michelin qui l’affecte à ses clients, à ses travailleurs et aux acteurs publics.
Des conversations très limités et un pouvoir trop généralement levé sur les lieux de travail participent à la sensation de dépossession de la décision politique, observe Martin Richer, consultant en management.
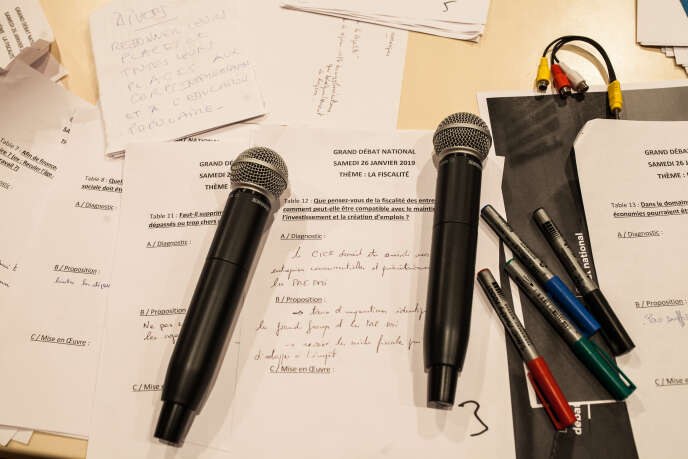
La crise des « gilets jaunes » et le déroulement du grand débat national nous confrontent une nouvelle fois aux empêchements de la délibération. La France est un pays dans lequel la délibération, c’est-à-dire un dialogue adouci et construit, ne va pas de soi. Les pénuries de la concertation au sein de la nation, des collectivités territoriales, mais aussi de l’entreprise, font système (« Délibérer en politique, participer au travail : répondre à la crise démocratique », Danielle Kaisergruber, Gilles-Laurent Rayssac, Martin Richer, rapport Terra Nova, 26 février).
La nécessité des possibilités de communication et de dialogue là où l’on travaille ajoute aux frustrations des citoyens là où ils vivent. Dans la vie politique comme dans l’entreprise, les termes sont trop souvent pris sans que les personnes qu’elles concernent ne se sentent effectivement compromises. Dans les deux cas, une culture de l’autorité fondée sur la hiérarchie et la verticalité prend fréquemment le pas sur une volonté partagée, fondée sur la compétence, la confiance et l’adhésion.
Dans son exposé, publié en 1982, Jean Auroux livrait la logique à l’origine des textes de loi qui portent son nom et qui tentaient à élargir les droits d’expression des salariés : « Citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l’être aussi dans l’entreprise. » Le travailleur et le citoyen sont indissociablement liés et leurs attitudes s’affermissent réciproquement.
L’éloignement entre les citoyens et les politiques, les premiers considérant que les seconds ne les écoutent pas et ne vivent pas comme eux, trouve sa correspondance dans l’entreprise sous la forme d’une véritable crise de défiance entre dirigeants et salariés. Le 10e baromètre de la confiance du Cevipof (janvier) montre que 72 % des Français sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle « l’économie actuelle profite aux patrons aux dépens de ceux qui travaillent ». En politique comme dans l’entreprise, la délibération réclame de la confiance.
La démocratie participative est actuellement plus une injonction qu’une pratique établie
Les enquêtes d’Eurofound, un organisation d’étude lié à la Commission européenne, exposent que la France est très mal installée dans la mise en place d’organisations du travail participatives (dénommées « high involvement working organizations »), c’est-à-dire des aménagements du travail qui dégagent aux salariés des espaces d’implication, de collaboration directe, de capacité d’influence et de décision sur leur travail, ce que certains indiquent par l’expression « entreprise libérée » ou par la notion de travail responsabilisant.
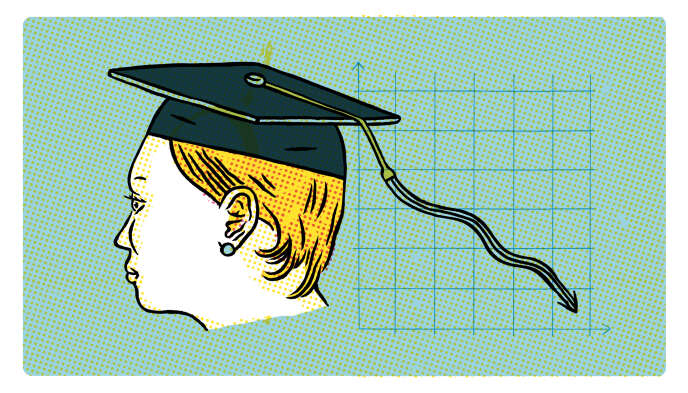
Après des années d’accroissement, l’illustre formation de Master of Business Administration subit un désintéressement remarquable aux Etats-Unis, particulièrement de la part des étudiants étrangers, au profit de l’Asie et de l’Europe.Amy Nelson a vécu dans une petite ville perdue du Midwest, près de Saint-Louis (Missouri), éduquée seule par sa mère. Mais elle a abandonné l’Amérique profonde : après des études en Californie et un début de carrière dans des ONG, la jeune femme a fait un Master Business of Administration (MBA) à la prestigieuse New York University (NYU), à Manhattan, en 2011 et 2012.
Rêve américain
Amy Nelson exprime ce rêve américain que l’on dit moribond. Malgré cela, elle pousse un coup de gueule contre le système qui lui a autorisé de s’en sortir. Six ans après son diplôme, endettée à hauteur de 250 000 dollars (soit plus de 220 000 euros), elle s’en prend au système des MBA.
Bien sûr, elle a eu droit à une bourse la première année, de 40 000 dollars approximativement. Mais elle n’a pas réussi à le décrocher pour la seconde année, alors que les frais de scolarité sont de 70 000 dollars par an. Il a fallu payer le loyer à Brooklyn, la garde de ses deux enfants, qu’elle élevait seule à l’époque, et voilà comment elle s’est perçue serrée jusqu’au cou.
250 000 dollars, c’est énorme, mais pas rare. La carrière d’Amy Nelson a bien amélioré : entrée en 2013 avec un salaire de 90 000 dollars annuel dans une ONG de 35 salariés, Venture for America, qui aide les entrepreneurs à se jeter dans les zones désavantagées des Etats-Unis, comme Detroit et La Nouvelle-Orléans, elle en est changée directrice générale et touche 200 000 dollars par an.
Un rémunération important qui ne lui permet pas pour autant de payer sa dette et qui est sans commune mesure avec les salaires de ceux qui ont choisi la voie royale après les MBA, entrant chez Goldman Sachs (finance), McKinsey (stratégie), Procter & Gamble (marketing) ou Amazon (technologie), des entreprises qui recrutent sur les campus, quelquefois même avant la rentrée scolaire.
L’un des chefs du mouvement parisien de grèves scolaires nous montre comment il s’écarte de plus en plus de cette « société aliénante et basée sur la destruction de l’environnement ».
Antoine Soulas est à un carrefour. Devant lui s’ouvre la voie royale, qu’il trace depuis qu’il rêve, gamin, de faire de l’observation scientifique : le prodigieux lycée Montaigne de Bordeaux, l’illustre Ecole normale supérieure, un cursus de mathématiques, de physique et de philosophie qui devrait déboucher, espère-t-il, sur une thèse en cosmologie ou en informatique quantique. Et finalement un poste de chercheur.
A moins que le jeune homme de 22 ans, l’un des responsables du mouvement parisien de grèves scolaires pour le climat, n’emprunte un tout autre chemin, assurément moins battu et possiblement plus tortueux : « tout plaquer » pour vivre dans une communauté locale, autonome et résiliente, au plus près de la nature.
Ce retour aux origines, Antoine Soulas en caresse l’idée depuis quelques mois actuellement. Une « crise de sens » qu’il partage, assure-t-il, avec beaucoup d’autres amis. « On se bourre le crâne pendant nos études, pour découvrir un travail et surconsommer toute sa vie, déclare-t-il. La finalité qui nous est offerte, c’est de participer à une société troublante et basée sur la dégradation de l’environnement. »
Or le Bordelais, qui vit actuellement dans une capitale « étouffante », s’est toujours senti proche de la nature. Il s’appelle comme si c’était hier ce jour où ses parents, lui charpentier devenu architecte et elles factrice passée comptable, lui ont parlé du réchauffement climatique. Il avait 6 ans ; la conscience de la « gravité de la situation » ne l’a plus quitté depuis.
D’abord, Antoine Soulas a changé son mode de vie. Il ne prend plus l’avion, est végétarien, se nourrit par le biais d’une AMAP (association pour la conservation d’une agriculture de proximité), sélectionne des produits bio, si possible en vrac, et n’achète plus de textiles ni d’appareils électroménagers neufs. Il ne détient pas de smartphone qui, comme la voiture, « nous dispense de rencontrer des gens ».
Puis le jeune homme a entrepris de verdir son école. Transformé le président de l’association EcoCampus ENS de 2016 à 2017, il a mis en place un tri des déchets, érigé un potager et des ruches sur les toits et même conçu une centrale solaire qui sera installée à la fin de l’année. Convoitant s’engager encore davantage, à une échelle plus large, il est nommé trésorier du collectif des jeunes pour le pacte finance-climat, une initiative signée par 600 personnalités, qui propose particulièrement la création d’une banque européenne du climat.

Sur un canapé, dans un TGV, dans un café : les agents du tertiaire œuvrent sans lieux fixes. En sont-ils plus libres ? Pas certainement, examine dans sa chronique le journaliste Nicolas Santolaria. Selon lui, le prix à renvoyer pour cette alléguée liberté est exorbitant.
Comme l’assure le philosophe Bruno Latour, nous sommes changés « des migrants de l’intérieur », pas seulement dans notre pays, mais aussi dans nos entreprises, dans nos open spaces, au cœur même de ce qui aménageait nos géographies intimement structurantes. « Si l’angoisse est si profonde, c’est parce que chacun d’entre nous commence à sentir le sol se dérober sous ses pieds. Nous découvrons plus ou moins obscurément que nous sommes tous en migration vers des territoires à redécouvrir et à réoccuper », écrit le philosophe dans Où atterrir ? (La Découverte, 2017).
Travail sous influence
Il n’est qu’à observer l’errance des salariés déambulant dans leur propre boîte à la recherche d’une salle de réunion ad hoc pour comprendre que c’est la sédentarité qui est actuellement devenue problématique. Afin de ne pas être délogé par les utilisateurs pressants de ces espaces mutualisés (« Ah désolé, mais on avait tempéré à 13 h 30 ! »), on en vient souvent à s’installer sur un coin de table à la cafétéria, comme des « Touareg du tertiaire ». D’une certaine manière, la métaphore du nomadisme qui structure aussitôt notre vision du travail sous influence numérique a trop bien fonctionné.
SELON le baromètre Paris Workplace 2018, exécuté par l’IFOP et la Société foncière lyonnaise, 34 % des salariés travaillent désormais au moins une fois par mois en dehors de leur boîte. A cette mobilité externe s’ajoute une mobilité interne, puisque 35 % des personnes interrogées ne restent pas fixées à leur poste, mais s’installent à deux endroits ou plus dans l’entreprise au cours d’une journée type. Entièrement adapté à la « société liquide », le nomade est cet individu qui, tel un agglomérat de 0 et de 1, n’est plus lié à un territoire mais peut se concrétiser, à tout instant, en n’importe quel point de la carte. Le nomade peut soudain apparaître sur la banquette d’un café Starbuck, derrière les canisses d’une paillote corse ou dans le fauteuil d’un TGV lancé à 300 km/h, continuant vaillamment à conduire de front ses activités professionnelles grâce à la portabilité des nouveaux outils de production.
Éternelle migration
Emprisonné à son MacBook Air, l’oreille connectée à son téléphone mobile, ce forçat du circuit de problèmes dessine les contours fatalement un peu flous (la faute à la vitesse) de ce que l’on nomme la « supermobilité ». L4essentielle figuration de cette « déterritorialisation » rendue possible par les outils numériques est sans doute l’agent Smith du film Matrix qui, surfant sur les coordonnées fluctuantes de la matrice, semble capable d’apparaître et de disparaître à l’envi, comme pour nous persuader que la matérialité du monde est un concept caduc.

Dans leur recherche, les magistrats de la rue Cambon se sont attardés sur deux points importants du régime d’indemnisation des chômeurs. Primo : le système dit de « l’activité réduite », qui admet à une personne d’être inscrite à Pôle emploi, tout en ayant un poste, et de entasser (sous certaines conditions) un salaire avec une allocation. L’autre dispositif passé au crible par la Cour s’appelle les « droits rechargeables » : il donne la possibilité, à un solliciteur d’emploi, de reconstituer son capital de droits à indemnisation, chaque fois qu’il retravaille. Le but de ces deux règles, comme le rappelle le référé, est de « sécuriser les parcours » de personnes en situation précaire et de faire en sorte que celles-ci aient continuellement intérêt « à reprendre un emploi ».
Des conséquences perverses
Exclusivement, déplore la Cour, de telles dispositions créent parfois des effets pervers. Exemple : le salarié, qui occupe plusieurs emplois simultanément et qui en perd au moins un, peut distinguer la totalité de l’allocation « correspondant à l’emploi perdu » avec la rémunération issue des activités qu’il a conservées. Ce cas de figure est susceptible « de donner lieu à des abus », notamment parce que le montant de l’indemnisation reste ferme même si les revenus tirés des activités exercées progressent de leur côté.
Pour autant, tonalité la haute juridiction, les chômeurs ont une « connaissance limitée » de tous ces mécanismes et ceux qui en tirent partie, par le biais « de stratégies d’optimisation », constituent « une minorité ».
Autre critique de la Cour des comptes : les méthodes de rémunération sont « complexes » et « trop favorables » aux individus signataires d’un contrat de moins d’un mois. Elles proposent la faculté d’entasser un salaire et une prestation de l’assurance-chômage « sans limite de durée » – ce qui tend, du même coup, à enfermer la personne dans la précarité. En outre, l’allocation est basée sur un paramètre – le salaire journalier de référence – qui peut s’avérer plus avantageux pour ceux travaillant de façon fragmentée par rapport à d’autres, employés d’une manière continue.
Pour autant, nuance la haute juridiction, les chômeurs ont une « connaissance limitée » de tous ces mécanismes et ceux qui en attirent partie, par le biais « de stratégies d’optimisation », constituent « une minorité ». Reste que le régime donne à des principes touffus, encore plus difficiles à décoder depuis l’introduction, en 2014, des droits rechargeables. Ils sont source d’« inefficience » et d’« incapacité pour les allocataires ». Dès lors, ils appellent d’« harmoniser » la réglementation adéquate aux chômeurs en activité réduite, ce qui est de nature à remettre en cause le niveau de la prestation octroyée à des salariés mal payés (les assistantes maternelles, en particulier).
Les magistrats de la rue Cambon adressent par ailleurs des remontrances à Pôle emploi, qui propose un accompagnement « distant », voire « inexistant », pour les personnes en activité réduite. Son « offre de services (…) demeure inadaptée », regrette la Cour. De telles lacunes devront être corrigées, dans la convention que l’opérateur public est en train de commercer avec l’État et les partenaires sociaux.
Enfin, il y a une masse de données sur les « trajectoires professionnelles » des chômeurs : fichiers de Pôle emploi, proclamation antérieur à l’embauche, proclamation sociale nominative… Mais toutes ces indications ne sont pas assez unies et croisées, ce « qui limite la capacité d’évaluation ». Ils appellent de les échanger de façon « plus large et plus systématique », afin d’étudier les transformations du marché du travail et l’impact des « politiques d’indemnisation ».
Autant de recommandations qui tombent à point dénommé pour l’exécutif : elles vont dans le sens des transmutations qu’il entend dicter à l’assurance-chômage, après l’échec des négociations entre le patronat et les syndicats, sur ce dossier, en février. Une concertation a été engagée, il y a deux semaines, avec de multiples acteurs (parlementaires, associations, clubs d’entrepreneurs, partenaires sociaux…). Elle ouvrira sur des mesures qui nécessiteraient être publiées durant le printemps pour une mise en œuvre d’ici à l’été prochain.

A l’Insead, l’association des «alumni » arrange des meetings ou des « dîners mystère » durant lesquels un ancien convoque chez lui d’autres diplômés inconnus. A l’heure de LinkedIn, la puissance de ces associations ne semble pas remise en cause.
Paris 7e, 20 heures pétantes, prêt de la tour Eiffel. Rory Wheeler et sa femme ont passé l’après-midi à cuisiner. Le jeune couple est un peu tendu : ce samedi de février, ils ont invité à dîner dans leur appartement quatre personnes qu’ils n’ont jamais aperçues. A part les noms et les adresses courriel des convives, envoyés par l’Association des anciens élèves de l’Institut européen d’administration des affaires (Insead), ils ne savent rien d’eux. Leur point commun : être diplômés de ce business school très célèbre cachée dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), qui a enseigné des générations de cadres dirigeants.
Aimeront-ils le poulet rôti sauce aigre-douce, le côtes-du-rhône ? « Quand ils ont su qu’on recevait des inconnus, mes beaux-parents, qui ont passé l’après-midi à la maison, nous ont examinés comme des extraterrestres », plaisante Rory, 33 ans. Tout le monde arrive à l’heure. On installe les invités, âgés de 28 à 69 ans, qui font des métiers très différents : ancien assistant parlementaire en recherche d’emploi, journaliste, créatrice d’une entreprise dans l’événementiel et docteur en physique des matériaux.
Tous s’étaient inscrits pour collaborer à un random dinner (« dîner mystère »), une initiative de l’association des anciens. Depuis le début de l’année, vingt-six dîners ont déjà eu lieu, dont deux à Lyon. « Assez vite, on a échangé des idées, parlé de politique, d’entrepreneuriat, évoque Rory. C’était très festif. Nous avons passé une bonne soirée et nous le referons. » Ils s’abandonnent en se promettant de rester en contact.
Les « bonnes » personnes
Pourquoi préparer à manger pour des inconnus ? « C’est du réseautage », dit Rory Wheeler. Rien de plus normal dans ce monde des très grandes écoles, qui dissolvent particulièrement leur pouvoir sur ces liens. Lorsqu’il s’est inscrit dans le Master of Business Administration (MBA) de l’Insead, Rory venait y chercher ce qui manquait à sa carrière : un carnet d’adresses. Originaire du Zimbabwe, passé par une fac de droit, à Toulouse, il n’éprouvait qu’une personne lorsqu’il a débarqué à Paris pour passer l’examen d’entrée à l’école d’avocats. Epuisé par le rythme abusif du cabinet dans lequel il travaille toujours, il a décidé il y a deux ans de reprendre les études à Fontainebleau – et convaincu sa hiérarchie de prendre une partie des frais de scolarité (80 000 euros) à sa charge. « Avant l’Insead, j’ai eu un mal fou à rencontrer les “bonnes” personnes, c’est-à-dire les grands cadres dirigeants. Ils étaient inabordables, je ne les voyais même pas. »
Dans cet affrontement, il y a un équilibre emblématique des ordonnances de 2017 sur la réécriture du code du travail : le plafonnement des révisions prud’homales. Les écrits envisagent désormais une grille de dommages-intérêts à allouer aux salariés victimes d’une résiliation infondée – avec des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté dans la société
Existant dans le programme de campagne d’Emmanuel Macron, cette modération était considérée par le patronat car elle rend plus prévisible les décisions prud’homales. Mais la gauche et plusieurs centrales syndicales – dont la CGT – la désapprouvent, au motif qu’elle ne permet pas, à leurs yeux, une juste rétractation du préjudice subi par le laborieux congédié.
Paiement d’une « indemnité adéquate »
Bien qu’il soit entré en service, le dispositif poursuit d’être contesté, sur le terrain judiciaire. Ainsi, lors de plusieurs assistances, des avocats de salariés ont fait valoir que l’échelle était contraire à deux textes : la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Charte sociale européenne. Celles-ci prévoient qu’une juridiction doit pouvoir ordonner le versement d’une « indemnité adéquate » ou toute autre forme de rétablissement « appropriée » en cas de licenciement infondé.
Depuis la mi-décembre 2018, six conseils de prud’hommes ont apprécié que cet argumentaire fût pertinent et qu’il fallait, de ce fait, permettre des dommages-intérêts supérieurs à ceux fixés dans les ordonnances Macron. Dans quelques cas, les juges se sont formulés dans ce sens, sans même y être conviés par le conseil du salarié, durant les débats au tribunal.
Jusqu’à maintenant, les prud’hommes de Paris étaient demeurés à l’écart de ce déplacement de rébellion. Mais mercredi 13 mars, les esprits ont débuté à s’échauffer, Après la notification, très récente, d’une affaire rendu, fin novembre 2018, par cette juridiction. Le terme est, de prime abord, surprenante : elle alloue à une salariée des dommages-intérêts dont le montant correspond à la grille adoptée en 2017 mais elle cite pareillement la Charte sociale européenne et la Convention n°158 de l’OIT.
Pourquoi faire référence à ces deux textes sans en déduire, comme dans les six autres conseils de prud’hommes, que le barème Macron doit être écarté ? Selon nos informations, il s’agit d’une initiative prise par la juge prud’homale CGT, qui présidait l’audience ce jour-là. Lors du délibéré, auquel elle a collaboré avec trois collègues (une pour le collège salarié, deux pour la partie patronale), un accord avait été aperçu sur le sens général de la décision et sur le niveau de l’indemnisation.
Quand elle a consigné, seule, le jugement, la présidente CGT a fait le choix de citer la Charte sociale européenne et la convention de l’OIT. Or, « les conseillers employeurs, présents lors de l’audience, disent que cela n’avait pas été abordé en délibéré », rapporte Jacques-Frédéric Sauvage, vice-président (Medef) des prud’hommes de Paris. L’affaire éveille un émoi important, du côté des juges patronaux : ils y voient la manifestation d’une « malhonnêteté intellectuelle », qui pourrait justifier des sanctions.
« Rappel général des bonnes pratiques »
Comment développer la démarche de la conseillère CGT ? Elle n’a pas souhaité s’exprimer. Il semble qu’elle ait voulu évoquer les deux conventions internationales, de manière à convoquer que le barème Macron peut être éloigné. Une geste militant, en somme, mais dont la pertinence juridique s’avère éventuelle.
Pour l’heure, les juges employeurs se sont bornés à affirmer, sans escompter la moindre procédure. « Nous attendons de savoir quelles mesures seront envisagées par les responsables du collège salarié, confie M. Sauvage. Pour moi, il y a une question de confiance mutuelle qui se pose. Il n’est plus possible de se fier à elle. »
De son côté, le président (CFDT) des prud’hommes de Paris, Etienne Colas, favorise temporiser : « Je ne peux pas me prononcer sur les faits, n’ayant pas une connaissance précise de ce qui s’est passé. Mais à cette étape, ils me semblent tenir du non-incident et ne me semblent pas graves. » Il a l’intention d’adresser à l’ensemble de ses pairs un « rappel général des bonnes pratiques, notamment en matière de déontologie et de loyauté ». « Ce que dénonce la partie patronale, aujourd’hui, s’est déjà produit, avec des collègues du collège employeur qui s’écartaient un peu de ce qui avait été avoué au moment du délibéré, relate-t-il. Il faut donc que chacun balaye devant sa porte. »