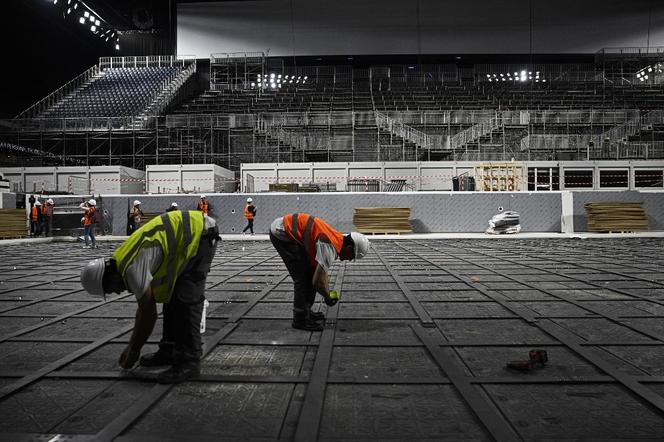85 % des actifs européens ont une bonne visibilité sur leurs revenus à court terme

Que l’on soit salarié ou indépendant, l’incertitude sur le montant de ses revenus à venir engendre « un impact négatif sur la santé physique et mentale », apprend-on dans l’étude 2024 d’Eurofound, la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail en Europe. Les travailleurs concernés sont davantage susceptibles de souffrir de dépression, de stress ou de conflits familiaux liés au travail.
Ce sentiment d’insécurité nourrirait, en outre, l’absentéisme et dissuaderait les actifs concernés d’innover ou de prendre des initiatives. Ce qui n’étonne pas Nicolas Bourgeois, expert RH et rémunération du cabinet PwC, et enseignant à Paris-Dauphine : « Le fait que l’insécurité motive est un mythe. Elle détruit l’engagement, car le mécanisme contribution-rétribution est mis à mal. »
La grande majorité des actifs de l’Union européenne y échappent : dans l’étude Eurofound, 85 % d’entre eux affirment savoir précisément ou approximativement combien ils gagneront durant les trois prochains mois. A l’inverse, 15 % disent qu’ils ne peuvent pas estimer leurs revenus à venir. Les hommes pâtissent davantage de cette incertitude, surtout quand ils sont jeunes : 26 % des travailleurs (contre 21 % des travailleuses) de moins de 24 ans affirment être concernés.
Des écarts importants se constatent par ailleurs entre pays. En Autriche ou Allemagne, plus de 90 % des actifs connaissent précisément ou approximativement le montant de leurs gains futurs. La France occupe une position intermédiaire : 14,2 % des actifs affirment ne disposer d’aucune visibilité. En bas du classement, plus de 25 % des actifs roumains et grecs affirment ignorer ce qu’ils vont gagner dans les trois mois. Se dessine donc une Europe à deux vitesses sur ce critère.
Tendance à l’amélioration
Mais les écarts entre pays tiennent aussi à la part des indépendants dans la population active, car ceux-ci subissent plus d’incertitude que les salariés, relève l’étude Eurofound : « La difficulté à prédire son revenu reste très principalement le sujet des artisans, commerçants, professions libérales, microentrepreneurs. Ils sont environ 4,5 millions en France et représentent 13 % des personnes en emploi. En Italie ou en Grèce, on est plus proche des 20 %-25 % », confirme Nicolas Bourgeois.
Il vous reste 37.46% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.