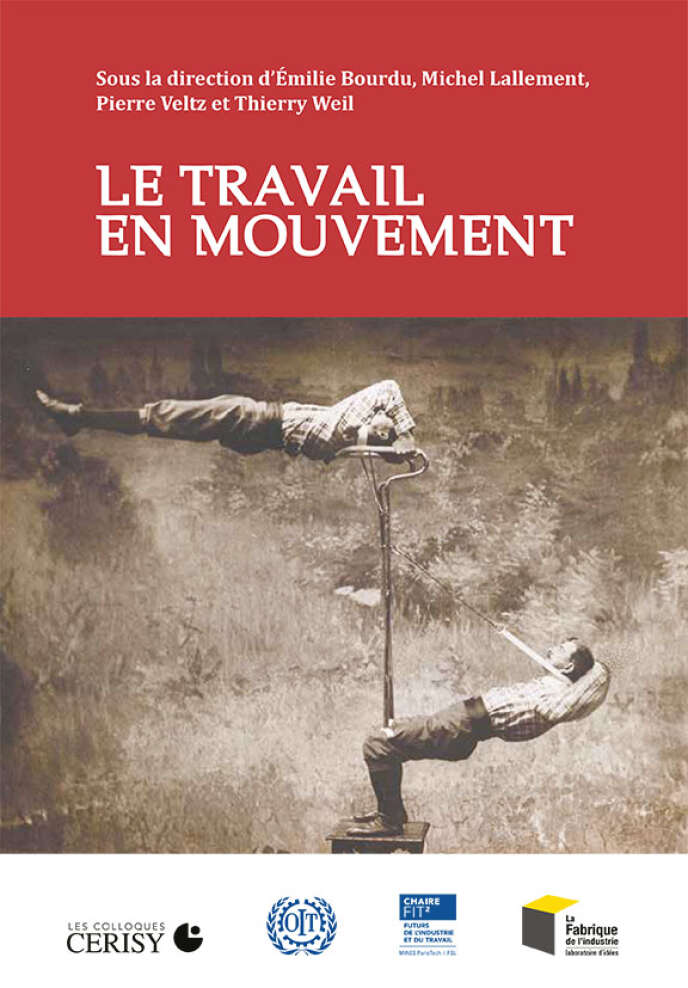Protéger les salariés contre l’incendie et le risque terroriste

Des conformités incompatibles ou difficilement compatibles entre elles ne sont pas rares en droit du travail. Ainsi en est-il des règles sur la sécurité en matière d’incendie et de celles sur la sûreté. Les deux dispositifs relèvent de l’obligation de l’employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », inscrite à l’article L.4121-1 du code du travail. Mais vu que l’un aide à fluidifier la circulation des travailleurs, l’autre en organise surtout le confinement.
Dans le code du travail, la protection des personnes contre le risque d’incendie s’organise d’une part par des dispositions à destination des maîtres d’ouvrage qui s’appliquent lors de la construction de lieux de travail ou de leurs modifications et, d’autre part, par celles concernant la prévention et la protection des travailleurs sur leur lieu de travail.
Le maître-mot en est l’évacuation de la totalité des personnes présentes : soit immédiate, soit différée, mais dans des conditions de sécurité maximale, surtout par la désignation d’un référent. La désignation d’une personne chargée de l’évacuation des salariés est obligatoire dans les entreprises de plus de cinquante personnes et, quelle que soit leur taille, dans celles « où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables ».
Une taille minimale doit aussi être fixée pour les dégagements qui doivent toujours être libres et « les portes doivent être susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation, de s’ouvrir facilement et d’être manœuvrables de l’intérieur si elles sont verrouillées » (article R. 4227-6 du code du travail).
Silos indépendants
La protection des travailleurs contre le risque terroriste n’est pas régie par des textes aussi précis. Actuellement, seules des bonnes pratiques non contraignantes ont été diffusées. Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et certains services ministériels ont émis des recommandations et publié des guides sectoriels. « L’évacuation si possible des personnes par des itinéraires sûrs à distance des assaillants » est évoquée, mais il s’agit pour l’essentiel de mesures de confinement.
La consigne est de mettre en sécurité le personnel et le public en les isolant des intrus malveillants, ou encore d’avertir les occupants d’un bâtiment en leur intimant l’ordre de se cloîtrer dans les locaux. Il y est évidemment conseillé de distinguer le système d’alerte attaque terroriste du système d’alerte incendie.