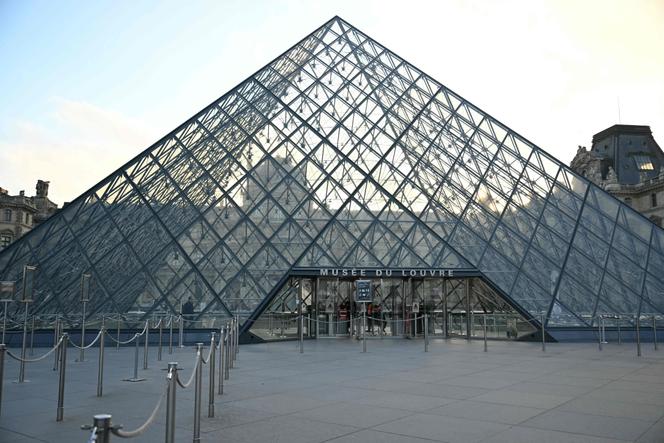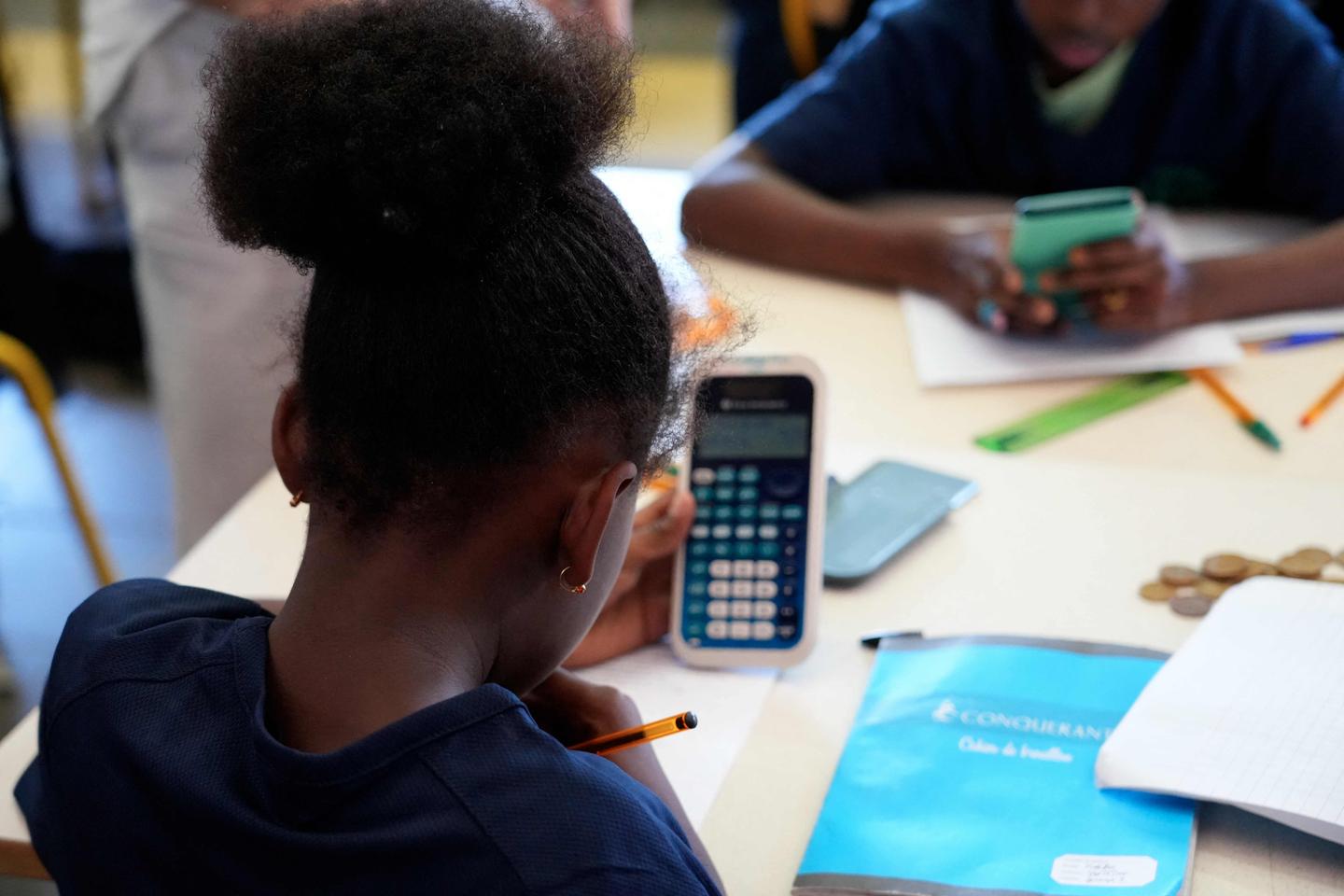La présidente de la librairie L’Ecume des pages démissionne après des désaccords avec Vivendi

Félicité Herzog, qui fut de septembre 2019 à juin 2025 directrice de la stratégie de l’innovation de Vivendi, quitte définitivement le groupe de Vincent Bolloré : elle a démissionné de ses fonctions de PDG de la librairie parisienne L’Ecume des pages. Dans une lettre datée du vendredi 13 février à Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi, et à François Laroze, directeur financier du groupe, que Le Monde a pu consulter, elle informe de sa décision, qui prend effet le jour même. Elle part parce que « le respect, l’indépendance et la capacité de délibération sont mis à mal ». Pour elle, « le mélange des genres entre influence politique et conduite des affaires constitue un motif d’alerte majeur ».
Véritable institution du boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris, cette librairie était entrée dans le giron de Vivendi fin 2023, quand le groupe avait surenchéri, à hauteur de 4,5 millions d’euros, pour acheter le fonds de commerce aux quatre héritiers de la famille Besançon.
Félicité Herzog avait alors signé avec Vivendi une charte d’indépendance pour « défendre l’intégrité de la libraire », écrit-elle. « Je suis notamment parvenue à neutraliser certaines interventions extérieures susceptibles de porter atteinte à cette indépendance, qu’il s’agisse de demandes de Vincent Bolloré visant le lancement de l’ouvrage de [la journaliste russe] Xenia Fedorova, ancienne responsable de Russia Today – média interdit dans toute l’Union européenne pour faits de propagande – ou de sollicitations tendant à une mise en avant privilégiée d’ouvrages politiquement marqués chez Fayard, alors même que la librairie en assurait déjà la présentation dans le respect de son pluralisme », décrit-elle.
Il vous reste 44.84% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.