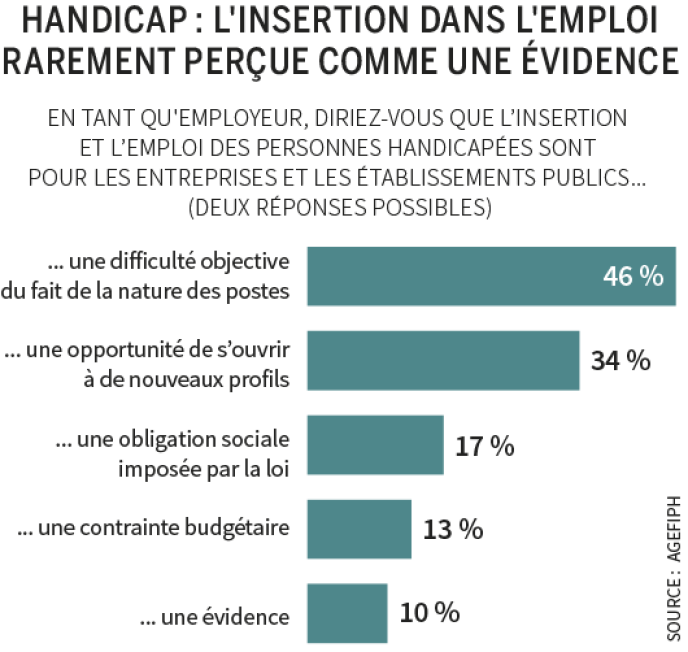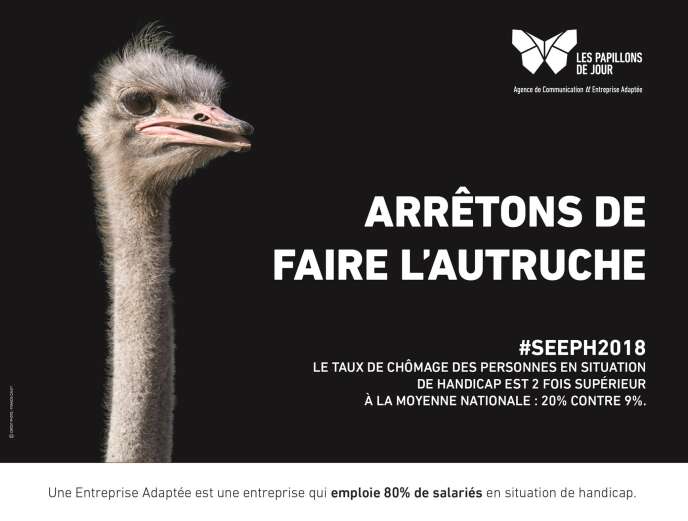Changement du travail : les différents profils de l’IA

Que l’intelligence artificielle (IA) s’apprête à changer le monde du travail, nul n’en doute. Mais personne ne connaît encore la réalité de cette révolution technologique. Donnera-t-elle naissance à un homme « remplacé », comme le craignaient, au XIXe siècle, les luddites anglais qui détruisaient les métiers à tisser ? Un homme « dominé » qui perdra le contrôle de son destin, comme le suggérait, en 1818, le Frankenstein de Mary Shelley ? Un homme « augmenté », comme en rêvent aujourd’hui les transhumanistes ? Ou un homme « réhumanisé » valorisant son intuition et son imaginaire, comme l’espère le cofondateur de Microsoft, Bill Gates ?
Parce qu’il estime que ce « momentum technologique » est avant tout un « momentum anthropologique », le sociologue Yann Ferguson, enseignant-chercheur à l’Institut catholique d’arts et métiers de Toulouse, explore ces quatre figures du travailleur à l’âge de l’IA en convoquant les sciences sociales, la littérature et la philosophie. Il les confronte ensuite à une enquête de terrain réalisée dans une entreprise étatisée de plus de 100 000 salariés qui a mis en place des « modules techniques » d’intelligence artificielle. « Il va de soi que ces quatre scénarios peuvent se conjuguer », souligne le sociologue François Dubet.
L’homme remplacé
Dans sa parabole de la manivelle, l’économiste Sismondi (1773-1842) redoute, dès le XIXe siècle, la disparition du travail : qu’adviendrait-il si le « machinisme arriv[e] à un tel degré de perfection que le roi d’Angleterre [peut], en tournant une manivelle, produire tout ce qui [est] nécessaire aux besoins de la population » ? Une crainte d’autant plus forte, aujourd’hui, que l’humanité entre dans le « deuxième âge » des machines. « Celles du premier âge produisaient un surcroît de puissance sans toucher au monopole humain de la décision, note Yann Ferguson. Celles du deuxième âge se révèlent capables de prendre de meilleures décisions que des humains. »
Contrairement aux idées reçues, le progrès technologiques ne détruisent pas le travail, qu’il soit manuel ou intellectuel : en se fondant sur l’analyse de seize études rétrospectives publiées entre 2009 et 2016, le Conseil d’orientation sur l’emploi montre que les créations d’emploi l’emportent sur les disparitions. Un phénomène confirmé en 2016 par les économistes Melanie Arntz,Terry Gregory et Ulrich Zierahn : l’analyse, de 1990 à 2012, de 18 Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont la France, montre que les nouvelles technologies n’ont pas d’effets néfastes sur l’emploi en raison des phénomènes de compensations.