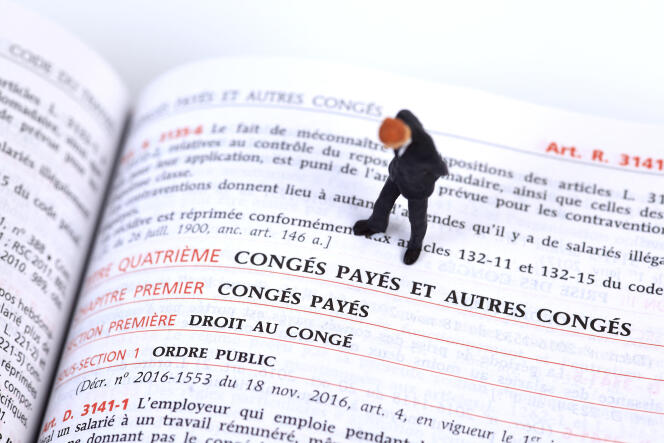L’emploi rebondit au 3e trimestre, mais l’année s’annonce sombre

C’est un soulagement pour le gouvernement. Après le tsunami du premier confinement qui a conduit à la destruction de 687 100 emplois, la reprise de l’activité au printemps et durant l’été a permis de recréer 401 100 emplois salariés au cours du troisième trimestre (+ 1,6 %), indique l’Insee dans une note parue mardi 8 décembre. Des chiffres légèrement meilleurs que l’estimation donnée le 8 septembre, avec 11 000 emplois supplémentaires créés. Et qui témoignent, s’il en était encore besoin, des évolutions erratiques du marché du travail, au gré de l’évolution de la situation sanitaire, de confinement en déconfinement.
Le rebond exceptionnel de l’activité au troisième trimestre (+ 18,7 %), pour autant, ne s’accompagne pas d’une reprise des embauches de même ampleur. « Le rebond de l’emploi est beaucoup moins spectaculaire que celui du PIB, décrypte Hélène Baudchon, économiste France chez BNP Paribas. On s’y attendait, car déjà la baisse au printemps avait été moins impressionnante que celle de l’activité économique : il faut y voir l’effet du recours massif au chômage partiel. »
Malgré cet effet « amortisseur », l’emploi salarié en France a retrouvé selon l’Insee un niveau « comparable à celui de fin 2018 ». Il reste inférieur à celui de fin 2019 – 295 900 emplois manquent encore à l’appel pour retrouver la même situation – mais il est vrai qu’il s’agissait d’une année particulièrement faste pour le marché du travail. Cela ne préjuge toutefois en rien du bilan qui pourra être fait à la fin de l’année 2020. Le second confinement, débuté le vendredi 30 octobre, « a produit un nouveau choc sur l’activité d’environ 10 % », rappelle Mathieu Plane, économiste à l’OFCE.
Eléments inquiétants
« A priori, on pourrait penser que l’impact sera moins important, puisque la baisse d’activité est plus faible », décrypte l’économiste. « Mais c’est oublier le fait que les effets du second confinement sont plus durs dans certains secteurs, comme le tourisme, l’hôtellerie, la restauration… qui sont durablement pénalisés », poursuit-il. Après avoir opéré un ajustement de court terme au printemps, ces entreprises vont peut-être procéder à un ajustement plus durable en supprimant non pas des contrats courts (CDD, missions d’intérim) comme lors du premier confinement, mais plutôt des CDI. « Le risque est donc, résume M. Plane, que les contrats courts se substituent à l’emploi à durée indéterminée. »
Il vous reste 43.87% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.