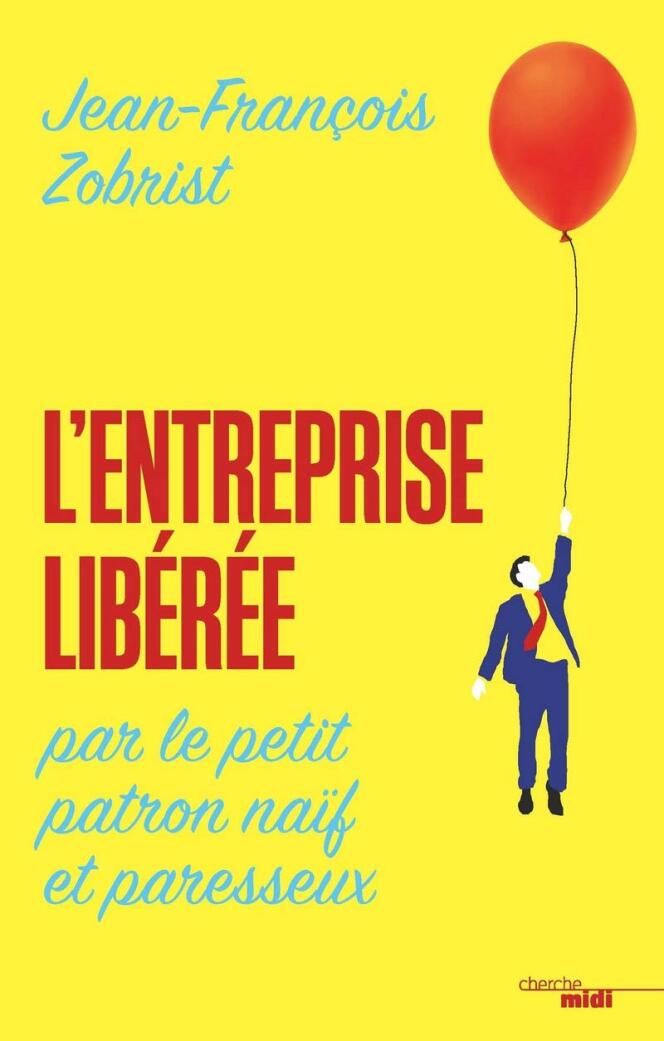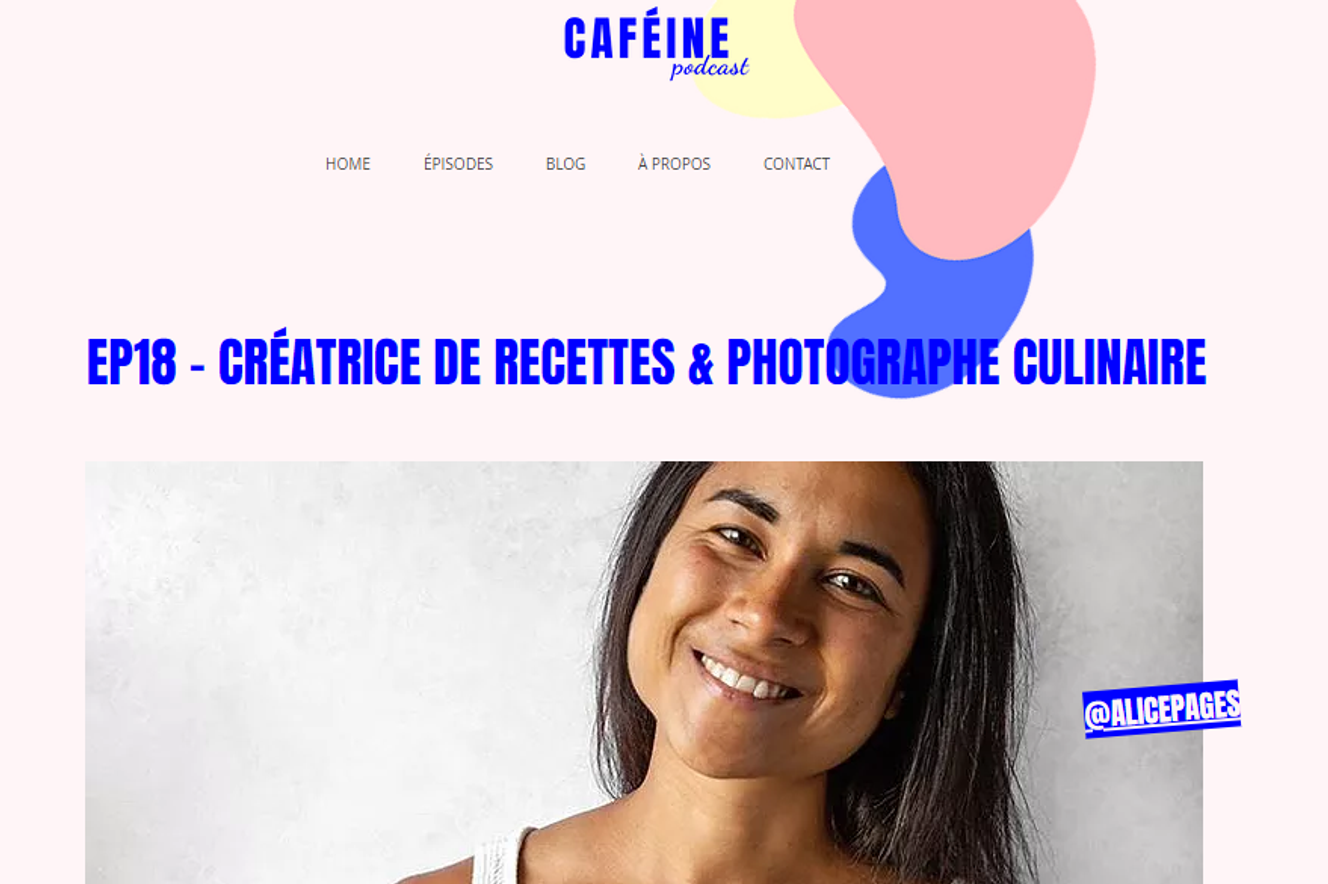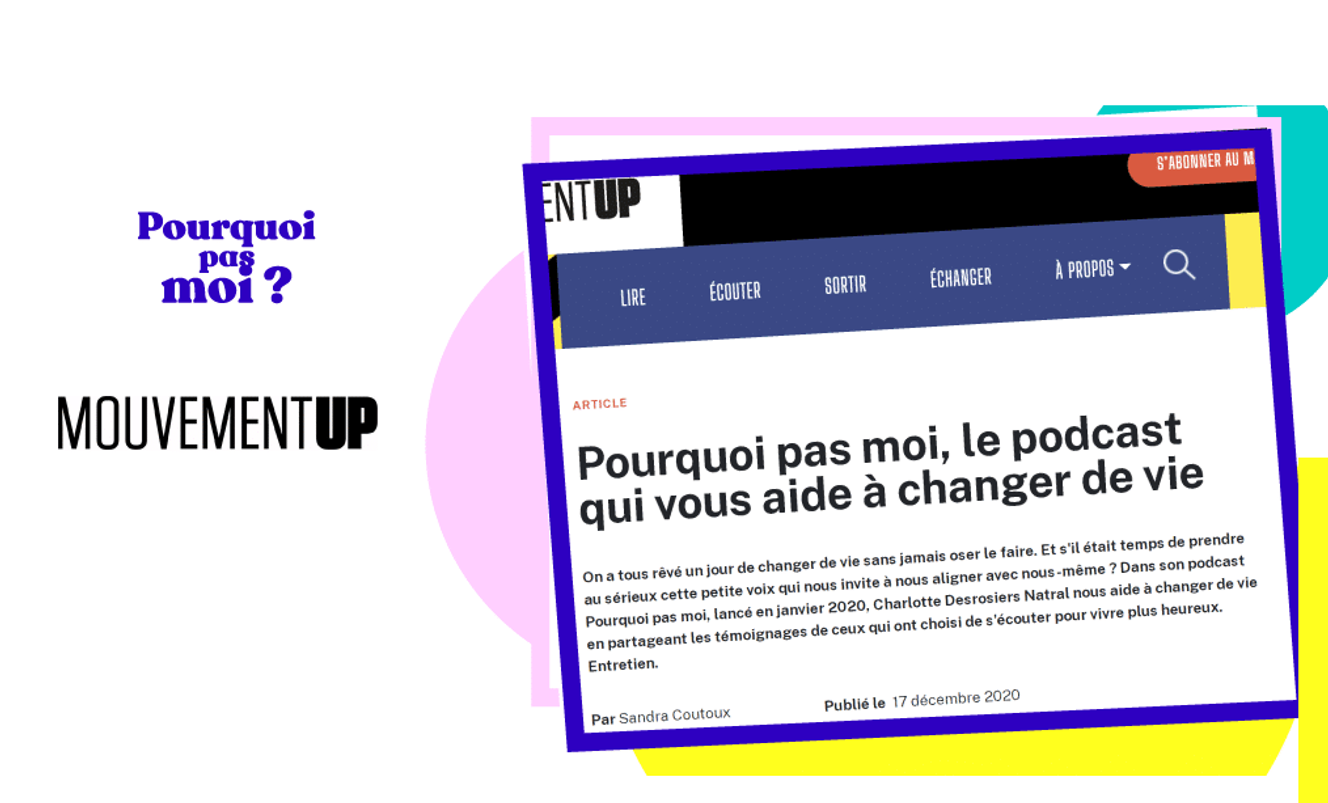Aux Etats-Unis, le retour au bureau se fait progressivement

Les quarante employés de 1Huddle Inc. ont découvert leurs nouveaux bureaux à Newark, près de New York en septembre 2020. « Les jeunes employés de la génération Z avaient besoin de rencontrer leurs chefs, explique Sam Caucci, le fondateur de cette start-up technologique, experte en formations par le jeu. Ils venaient juste de sortir de l’université. Certains vivaient encore chez leurs parents, ce qui n’est pas l’idéal pour travailler chez soi. Et ils avaient du mal à gérer leur temps, ils n’ont pas encore la discipline des salariés plus matures. » M. Caucci a donc organisé le retour au bureau, dans un espace plus grand, différent de ce qu’il avait imaginé au départ.
Pour rassurer ses troupes, la climatisation a été doublée, le nettoyage s’est intensifié et les grandes salles de réunion ont été remplacées par des lieux de rencontre pour deux à trois personnes, disposant de télé, caméra et microphone dernier cri. Le design des meubles a changé. Initialement, M.Caucci avait commandé des petites tables rondes. Elles ont été remplacées par de longues tables de pique-nique où l’on s’assoit loin les uns des autres. Et les canapés ont laissé la place à des fauteuils mobiles. L’esprit start-up est toujours là. On boit et l’on mange ensemble souvent. Mais on utilise des tasses jetables et des snacks sous cellophane.
Les longs mois de vie au temps du coronavirus ont forcé les entreprises en tous genres à revoir leur approche du travail collectif. Le bureau est toujours nécessaire pour les médias, l’édition, certaines industries high tech dont les équipements essentiels ne peuvent être rangés dans le cloud. En plus, « la collaboration à distance est difficile », souligne la consultante Carrie Duarte, experte en travail du futur chez PwC. Et de citer un sondage réalisé en juin, selon lequel 39 % des salariés avouent avoir du mal à travailler en équipe, loin de leurs collègues. « C’est la raison numéro un invoquée pour aller au bureau », assure-t-elle.
Convaincre le plus possible
Mais ce retour se fait à petits pas. L’enquête menée en octobre 2020 par l’agence Partnership for New York City auprès des grands employeurs de Manhattan montre qu’à l’été 2020, seulement 8 % des salariés avaient retrouvé leurs locaux, 10 % à l’automne. Et l’on espère 48 % en juillet 2021. Pour convaincre, il faut employer un gant de velours. Bank of America (211 000 employés) prévient ainsi ses employés d’un éventuel retour un mois à l’avance et leur promet toutes les précautions sanitaires.
Il vous reste 56.56% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.