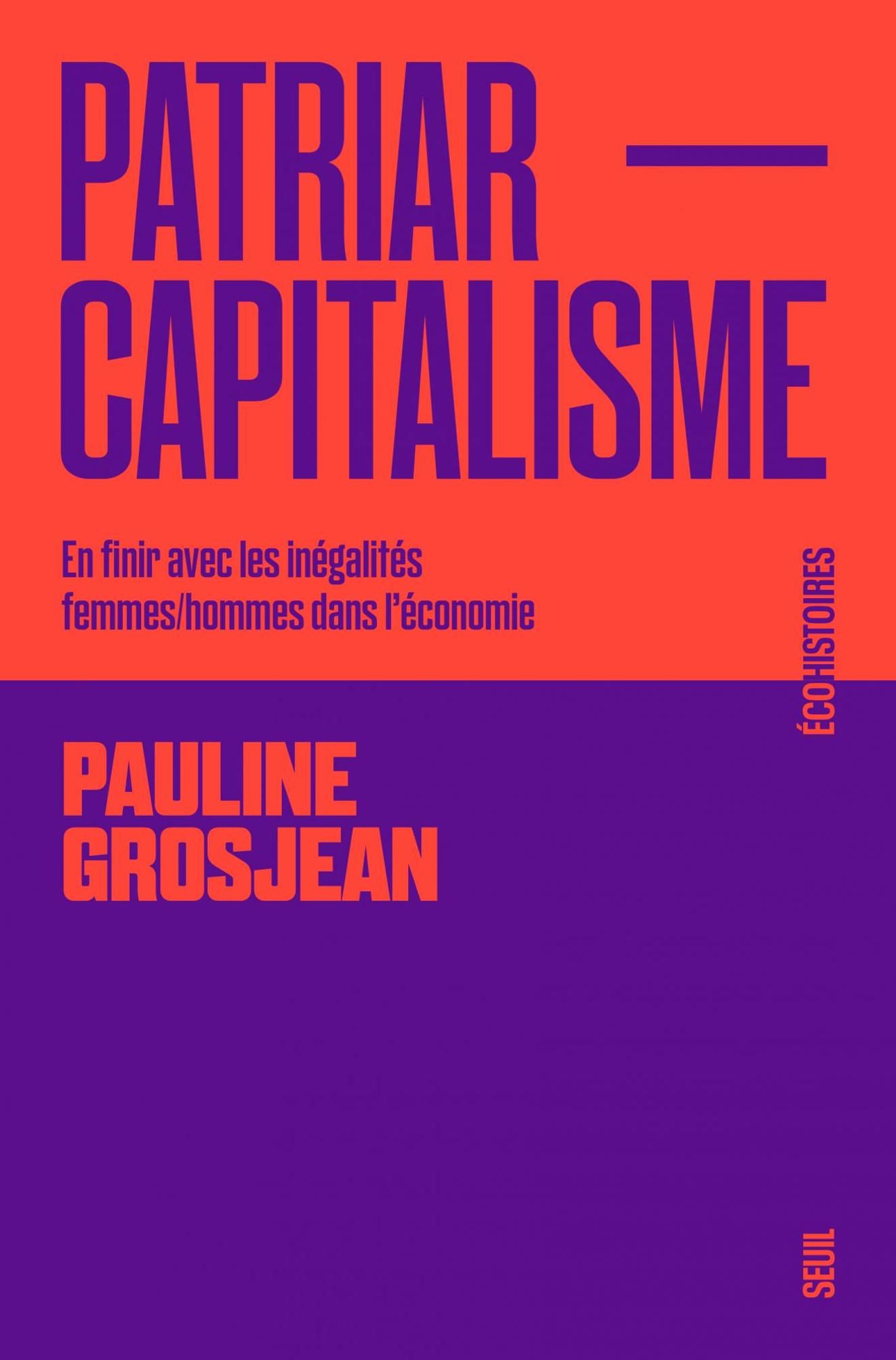Carrière des femmes : « Défaire le patriarcapitalisme dans nos mentalités est possible »
Professeure d’économie à l’université de Nouvelle-Galles-du-Sud à Sydney (Australie) et chroniqueuse du « Monde », Pauline Grosjean conceptualise, dans un livre paru au Seuil, le « patriarcapitalisme », ou comment la structure de domination, la culture et l’identité de genre interagissent avec le système économique pour faire obstacle à l’égalité femmes-hommes.
Les années 1980 furent le témoin de progrès économiques fulgurants pour les femmes. Que s’est-il passé depuis ?
A la fin des années 1980, les femmes sont en moyenne plus éduquées que les hommes dans les pays occidentaux, n’interrompent plus ou très peu leur carrière pour s’occuper de leur famille, et accèdent à des professions, notamment la médecine ou la magistrature, qui auparavant étaient réservées aux hommes. Mais l’explosion des inégalités de revenus depuis s’est marquée par un creusement des inégalités économiques entre les femmes et les hommes.
Cet écart s’explique par les différences systématiques en termes de choix de métier et d’industrie, différences dictées par des injonctions à satisfaire des identités de genre, et par des considérations sociales de qualités naturelles supposées féminines ou masculines : c’est ce que j’appelle le patriarcapitalisme.
L’Australie, où je réside depuis 2011, est un cas particulièrement intéressant en raison d’une expérience historique particulière qui a laissé des traces indélébiles sur les normes de genre. Le pays a longtemps été caractérisé par un déséquilibre démographique très important, avec un surcroît du nombre d’hommes par rapport aux femmes, aussi bien en raison de son statut de colonie pénale que d’une immigration volontaire majoritairement masculine. Cette expérience historique permet de mieux comprendre la formation des normes sociétales de genre, leurs impacts économiques et leur persistance à long terme.
La robotisation a-t-elle rendu la conciliation entre vie professionnelle et privée plus aisée ?
Contrairement aux attentes, non : on travaille encore plus, notamment dans les postes à responsabilité. On parle alors de « opt-out revolution » : certaines femmes, mères et très diplômées, se rendent compte que leur travail est incompatible avec la maternité. Dans le milieu académique, si une femme a du succès, son statut nullipare va être mis en avant. On dira : « Elle est prof à Harvard, mais elle n’a pas d’enfants. » On n’aura jamais la même remarque pour un homme.
Comment lutter contre les inégalités de genre en entreprise ?
Les grandes entreprises doivent publier leurs comptes financiers plusieurs fois par an, mais presque rien ne les oblige à dévoiler quoi que ce soit sur les problématiques de diversité. Peu de données publiques existent sur la répartition des différents postes hiérarchiques entre les femmes et les hommes. Les entreprises ne sont même pas contraintes de rendre publics les cas de harcèlement sexuel.
La France n’a que très récemment fait des progrès dans ce sens : depuis 2020, les entreprises doivent publier un index global d’égalité femmes-hommes à partir de quatre ou cinq indicateurs selon leur taille – écart de rémunération, écart de répartition des augmentations, nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité, parité parmi les dix plus hautes rémunérations. Un progrès donc, mais loin d’une mesure systématique et détaillée de la culture d’entreprise en termes d’égalité femmes-hommes.
L’arrivée de femmes aux conseils de direction sous l’effet de quotas s’est-elle répercutée sur le reste de l’entreprise ?
Les progrès des femmes en haut de la hiérarchie n’ont pas bénéficié aux autres employées : on ne constate pas d’augmentation des embauches des femmes en général, ni de mise en place de politiques plus favorables pour elles dans l’entreprise. Les femmes qui se hissent tout en haut de l’échelle n’ont pas la même expérience de vie que les autres. Elles ont fait des sacrifices importants vis-à-vis de leur famille : elles sont moins mariées et ont moins d’enfants par rapport aux autres femmes dans l’entreprise. Elles sont donc moins bien placées pour identifier les obstacles qu’on rencontre lorsqu’on essaie de concilier carrière et enfants.
Quel a été l’impact de la pandémie sur les inégalités de genre ?
Le Covid a touché des secteurs d’activité plus féminins, en contact avec le client. Il s’agit de la récession la plus inégalitaire qu’on ait jamais connue en termes de genre. Dans les pays où les écoles ont fermé, ce sont les femmes qui se sont majoritairement occupées des enfants à la maison. Même quand, dans le couple, la femme comme l’homme ont doublé le temps passé avec les enfants, comme les femmes y consacraient déjà plus d’heures auparavant, en valeur absolue l’écart s’est creusé.
Pourtant, devinez à qui profite l’argent mobilisé dans les plans de relance ? Aux emplois majoritairement masculins, dans les secteurs des infrastructures et de la rénovation énergétique.
Aujourd’hui, les scandales #metoo incarnent une demande renouvelée d’égalité. Une nouvelle ère s’ouvre-t-elle ?
Je suis assez optimiste. Mes étudiantes de 20 ans ne sont pas comme moi au même âge. Elles n’admettent plus les choses qui moi me faisaient rire nerveusement pour ensuite me sentir mal pendant des jours. On met des mots sur le harcèlement sexuel.
Mais il existe encore des comportements sur lesquels la lumière n’a pas été faite. Sur le retour de congé maternité par exemple, qui fut le vrai obstacle à mon épanouissement professionnel : on m’a piqué des données, viré des papiers.
Quand j’ai commencé ma carrière, le congé maternité, je m’en moquais, cela ne me concernait pas du tout. Si on m’avait alertée, qu’on m’avait dit que c’est précisément à ce moment qu’autant de femmes tombent de l’échelle, j’aurais été davantage vigilante. Défaire le patriarcapitalisme dans nos mentalités est possible. La législation et une politique ambitieuse d’égalité femmes-hommes peuvent changer les normes de façon durable et robuste.
« Patriarcapitalisme », de Pauline Grosjean. Seuil, 224 pages, 20 euros.