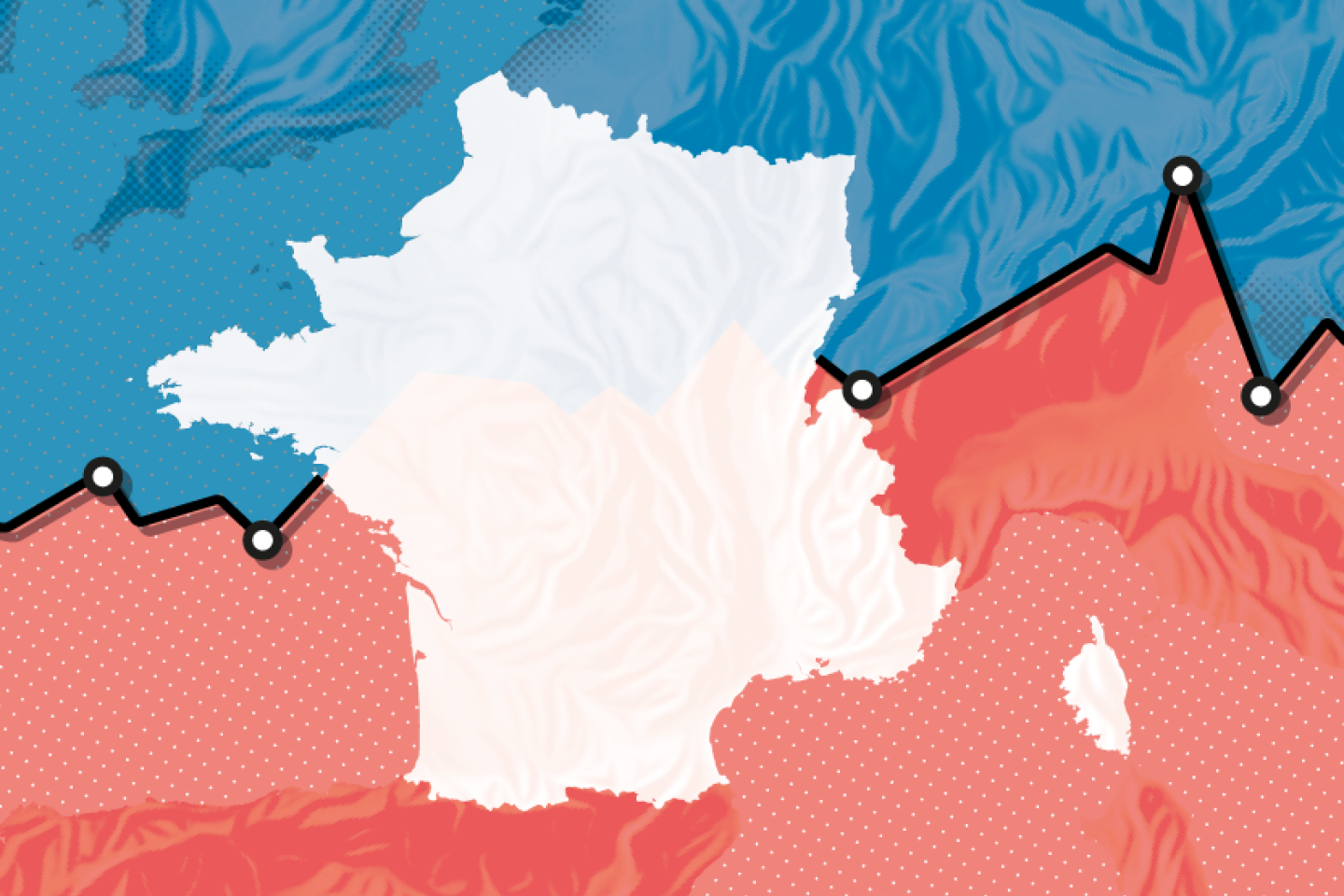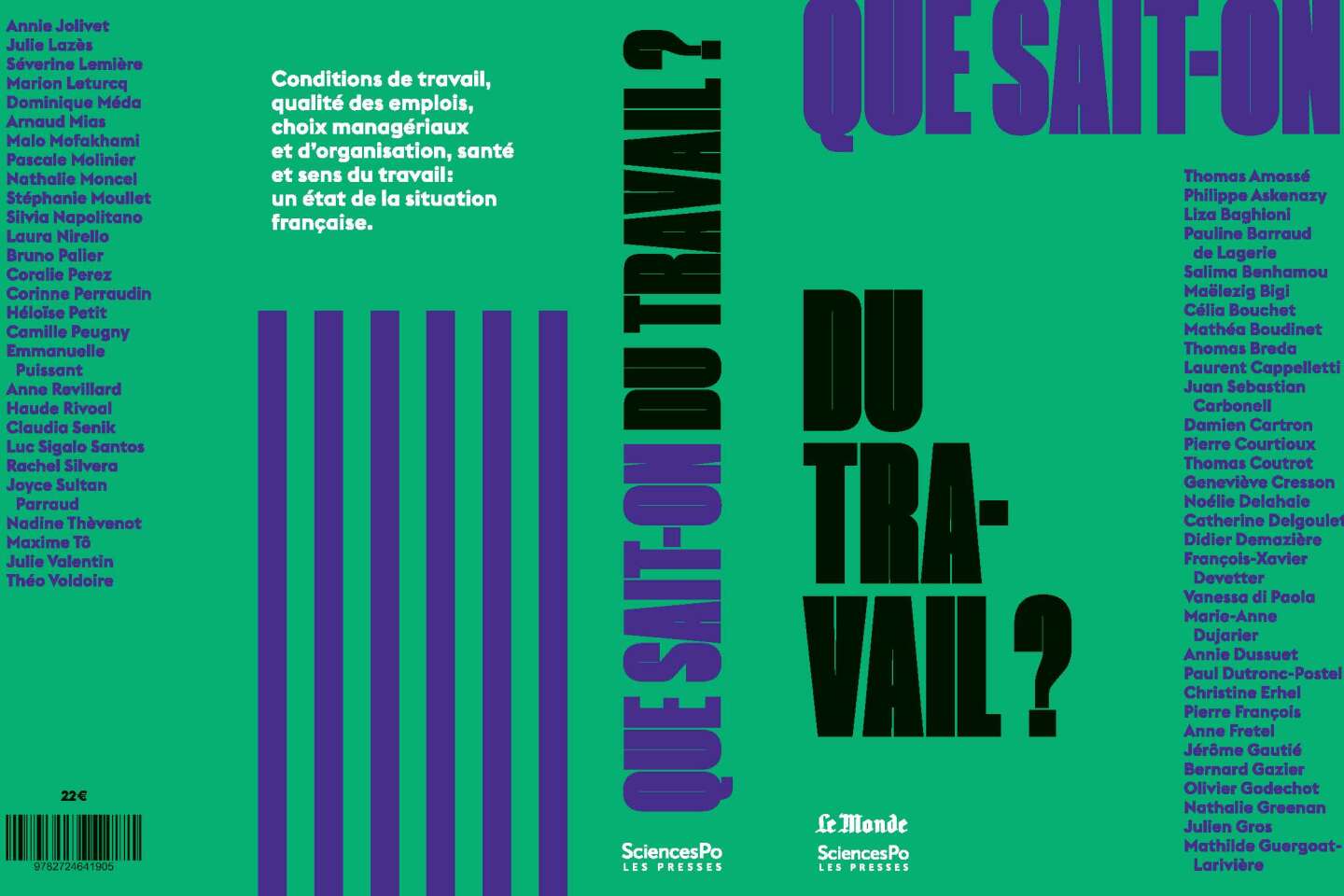Quand les entreprises laissent partir leurs salariés pour mieux les retenir

Jeanne (le prénom a été modifié), 36 ans, y songeait depuis longtemps. Larguer les amarres, se reconnecter à la nature, prendre le temps de vivre à deux. Non pas que sa vie lui pesait – cette diplômée d’une école de commerce, cadre dans l’industrie, heureuse en amour, « adorait son travail et son équipe » –, mais il lui semblait que le moment était venu « d’accorder du temps à [sa] vie personnelle pour mieux revenir ensuite ».
Jeanne et son compagnon sont donc partis à l’automne 2023 pour un an : direction l’Asie, la Nouvelle-Zélande et l’Amérique latine. « On avait déjà beaucoup voyagé dans notre vie, donc cette fois, l’idée était de visiter un nombre modéré de pays, mais des pays lointains et vastes, impossibles à sillonner pendant de simples vacances », explique la jeune femme jointe par téléphone depuis la Nouvelle-Zélande.
A mi-parcours de cette année de pause, Jeanne ne regrette rien, savoure et a bien conscience de vivre quelque chose « d’extraordinaire ». « Le plus dur est de prendre la décision. Lâcher son boulot, son logement, entendre les inquiétudes de l’entourage… Ça a un côté un peu vertigineux, mais une fois que tu es partie, tu vis l’expérience à fond. »
« Moment de recul »
Pour s’offrir cette parenthèse, Jeanne devait convaincre son entreprise de la laisser (provisoirement) partir et elle n’a eu aucun mal à le faire. « Je leur en ai parlé au printemps 2023 et six mois plus tard, on décollait ! Pourquoi ont-ils accepté ? C’est une entreprise humaine, ouverte aux histoires personnelles. Et le fait que certains, au sein de la direction, aient déjà fait ce genre de choses, a sûrement joué en ma faveur, estime la jeune femme. Plus généralement, je pense que les salariés qui veulent partir le feront de toute façon, donc en acceptant un congé sabbatique, les entreprises se donnent une chance de les garder. »
Si l’employeur de Jeanne lui a donné sa bénédiction et l’assurance de retrouver le même niveau de poste après son congé, d’autres vont encore plus loin. « Congé de respiration » chez Orange, « congé pour priorité personnelle » chez Accenture, « Mazars break » pour le cabinet de conseil du même nom : ces dernières années, certaines entreprises ont mis en place de nouveaux dispositifs permettant à leurs employés de faire une « pause » dans leur carrière, tout en continuant de toucher une part significative de leur salaire.
L’exemple le plus médiatisé est certainement celui d’Orange. Début 2022, le groupe de télécommunications a lancé son « congé de respiration » : une période de trois à douze mois pendant laquelle le salarié touche 70 % de sa rémunération pour se consacrer à du mécénat, à un projet entrepreneurial ou à une formation. Pour y prétendre, il faut avoir au moins dix ans d’ancienneté. « L’idée était de proposer un moment de recul à nos collaborateurs à travers la réalisation d’un projet qui leur tient à cœur », fait valoir Vincent Lecerf, directeur des ressources humaines du groupe Orange.
Il vous reste 71.5% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.