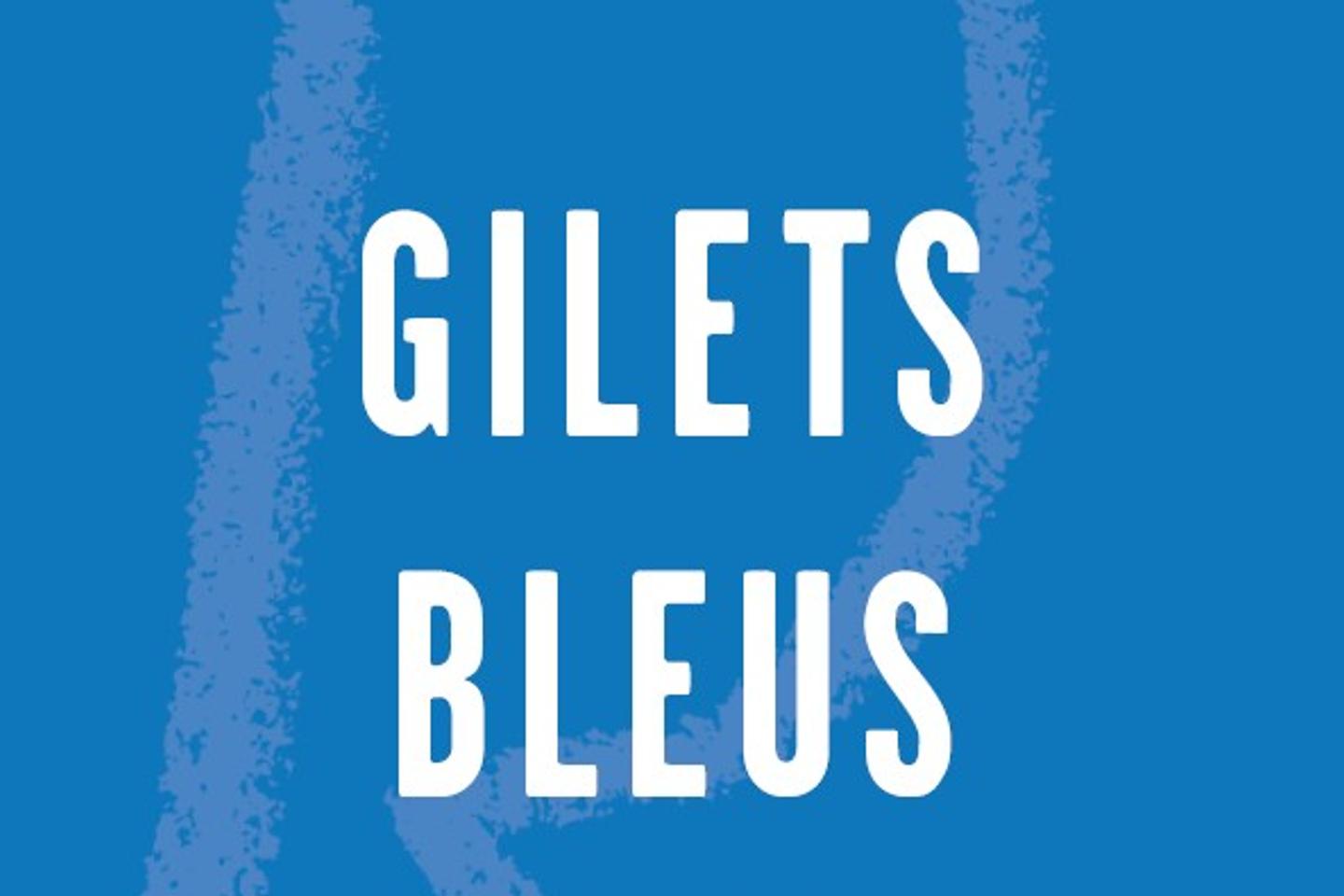La Grèce veut autoriser les journées de travail de treize heures

Après avoir instauré, en 2024, la semaine de six jours pour les salariés travaillant dans des entreprises fonctionnant en continu ou ayant une « charge de travail exceptionnelle », le gouvernement conservateur veut autoriser les employés à travailler jusqu’à treitreize heures jour. Actuellement, les salariés grecs peuvent travailler jusqu’à treize heures par jour, mais uniquement s’ils ont deux employeurs ou plus, tandis que l’horaire légal de travail journalier est de huit heures, avec la possibilité d’effectuer jusqu’à deux heures supplémentaires. En consultation publique jusqu’au 19 septembre, le texte, qui doit être voté dans la foulée, suscite l’inquiétude des syndicats et de l’opposition de gauche.
Apostolis Stergiopoulos, enseignant, a battu le pavé, lundi 8 septembre, à Athènes, devant Parlement, avec des centaines d’autres manifestants. « Avec les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle, nous devrions travailler moins d’heures et profiter de notre famille et de nos amis. Au lieu de cela, je vois des enfants tous les jours en classe qui sont tristes, qui ne voient pas leurs parents car ils enchaînent les petits boulots pour survivre », se désole le trentenaire.
Il vous reste 73.75% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.