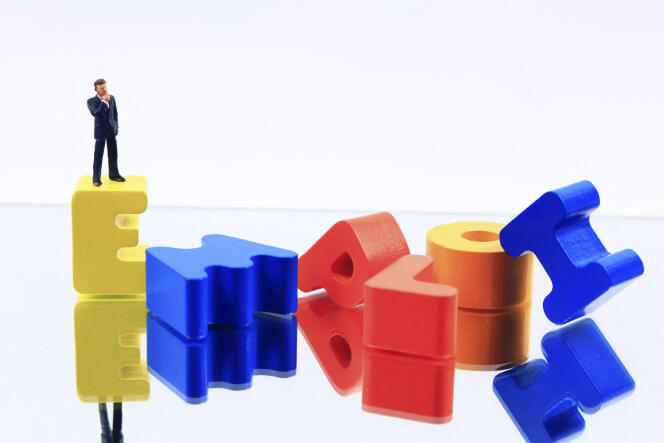Les entreprises sans seniors, une spécificité française

A quoi ressemble une société qui écarte les plus de 50 ans du monde de l’entreprise ? Depuis juin 2020, quelque vingt-deux plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) ont été déclarés chaque semaine à l’administration, auxquels s’ajoutent d’autres vagues de départs de toute nature. Il est difficile de chiffrer précisément la part de seniors dans les myriades de plans de départs plus ou moins volontaires lancés depuis le Covid-19. Les seniors n’ont pas tous le même âge selon les entreprises et la « cible » n’est pas quantifiée dans les accords négociés.
Les mesures d’âge permettent néanmoins, sans jouer les Cassandre, d’anticiper un phénomène d’ampleur. Les plus de 50 ans sont « prioritaires » pour quitter l’entreprise. Les exemples sont légion. Chez Airbus, 60 % des départs volontaires seraient des départs en retraite ou préretraite. Michelin, qui envisage 2 300 suppressions de postes d’ici à 2023, prévoit un plan de départs volontaires « comprenant en priorité des mesures de préretraite ». La SNCF réduira ses effectifs de 2 % en 2021 « en jouant sur les départs à la retraite ». A bien moindre échelle, pour Renault Trucks, en décembre 2020, sur les 290 départs prévus, 189 souhaitaient partir à la retraite ou en préretraite.
Après un an de Covid-19, Pôle emploi confirme la tendance. Depuis le 1er mars 2020, les plus de 50 ans inscrits au chômage (en catégories A, B et C) sont 50 100 de plus. Dans le même temps, quelque 70 000 postes étaient supprimés dans le cadre des PSE. Les seniors (50 ans et plus) nouvellement inscrits à Pôle emploi représentent donc deux tiers du volume des ruptures de contrat des PSE 2020. Quelles conséquences sociales et économiques en attendre ?
Nouvelle catégorie de déclassés
Le risque macroéconomique pour la société est bien moindre que dans les années 1980, assure l’économiste Antoine Bozio. « Le choc pétrolier avait alors pénalisé l’activité pour vingt ans, dans une période de forte inflation, où l’Etat avait une faible capacité d’endettement, rappelle-t-il. Aujourd’hui, l’activité a fortement ralenti mais la crise est provisoire. L’endettement est efficace face à une crise temporaire. Quels que soient les dispositifs qui ciblent les seniors, la grosse différence est qu’on est en capacité de les financer. Les taux d’intérêt sont à un niveau très faible et, pour l’instant, on ne voit pas d’inflation qui arrive. Donc aucun élément factuel n’indique que l’endettement est un risque pour l’économie. » Par le passé, le coût des vagues de préretraites a été considérable : il a fallu les indemniser plus de cinq ans. « De 1979 à 1983, le nombre de départs à partir de 55 ans est passé de 160 000 à 700 000 par an et n’est redescendu en dessous des 500 000 qu’en 1992, pour un coût annuel qui a atteint jusqu’à 9 milliards de francs [1,35 milliard d’euros] en 1985. »
Il vous reste 77.49% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.