Les gouvernants européens qui doivent se rassembler, jeudi 9 mai à Sibiu (Roumanie), pour exprimer de l’avenir de l’Union européenne (UE), posséderaient sans doute préféré partir avec des prévisions économiques de meilleur augure. Celles que la Commission européenne a montrées, mardi 7 mai, n’ont rien de tranquillisant.
Elles témoignent une diminution très nettement perceptible, surtout en Allemagne, et l’ascension des périls. Pour la deuxième fois successive, l’institution communautaire abaisse ses perspectives d’accroissement du produit intérieur brut (PIB) pour 2019 à 1,4 % désormais pour l’ensemble de l’UE, et à 1,2 % pour la zone euro. En février, elle prédisait encore 1,5 % de croissance pour l’UE et 1,3 % pour la zone euro.
Distensions entre Pékin et Washington
En cause, principalement, le retard de la croissance chinoise et les anxiétés liées au commerce mondial, à débuter par les risques d’escalade protectionniste entre la Chine et les Etats-Unis. Le Brexit, qui n’a continuellement pas eu lieu faute de majorité politique au Royaume-Uni sur un traité de séparation, n’arrange rien. « Les risques qui entourent [nos] perspectives restent élevés », précède Valdis Dombrovskis, le vice-président de la Commission pour l’euro et le dialogue social.
« Sur le plan externe, ils ont trait à une augmentation des conflits commerciaux ainsi qu’à la faiblesse des marchés émergents, surtout la Chine. En Europe, nous devrions demeurer attentifs à l’éventualité d’un “Brexit sans accord”, aux anxiétés politiques et à un possible retour du cercle vicieux entre emprunteurs souverains et banques », déclare le politique letton.
Depuis Washington, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a elle aussi tranché « impératif » mardi que les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis s’adoucissent : « Elles représentent une menace sur l’économie mondiale », a-t-elle évalué.
La situation allemande effraye notamment à Bruxelles. Le modèle de la première économie européenne est sous pression : tournée vers l’exportation, et encore très dépendante de son industrie automobile en pleine mutation, elle n’a cessé de ralentir ces derniers mois. Mardi, la Commission a réaffirmé qu’outre-Rhin, le PIB ne pourrait croître que d’un tout petit 0,5 % en 2019. Berlin découvrait encore le double en janvier, presque quatre fois plus en octobre 2018 (1,8 %).
L’Italie, le « maillon faible »
L’Italie reste examinée comme le « maillon faible » de la zone euro, avec une croissance atone (+ 0,1 % en 2019), un défaut public bien au-delà des recommandations liées au Pacte de stabilité et de croissance (- 2,5 % du PIB en 2019 et même – 3,5 % en 2020) et, principalement, une dette publique continuellement étendu (133,7 % du PIB), la plus forte de la zone euro après celle de la Grèce (174,9 % du PIB). Bruxelles avait réussi à apaiser le jeu avec le gouvernement populiste (du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue, d’extrême droite) à l’automne 2018, mais les tensions domineraient reprendre juste après les élections européennes, début juin, quand la Commission éditera ses « recommandations » pays par pays.
Lundi 6 mai, Sebastian Kurz, le chancelier autrichien, n’a pas délibéré à présenter du doigt la situation transalpine, dans un entretien à la Stampa : « L’Italie risque de menacer l’ensemble de la zone euro si l’Union européenne ne durcit pas ses règles en matière d’endettement public excessif. »
Est-ce un moyen, pour le jeune dirigeant, qui gouverne en alliance avec le parti d’extrême droite FPÖ, de mettre en garde contre une coalition des populistes (italiens, autrichiens, hongrois….), à droite de sa famille politique européenne, les conservateurs du PPE ? Des sanctions pour les pays européens surendettés « empêcheront l’Italie, par exemple, de finir comme une deuxième Grèce à cause de politiques d’endettement irresponsables », a fait valoir le chancelier au quotidien italien. C’est le seul moyen « d’éviter que l’Italie ne mette toute la zone euro en danger », a-t-il dclaré.
« Nouvelles réformes propices à la croissance »
En rapprochement, la situation française paraît clairement plus désirable, avec une croissance dans la moyenne haute cette année (1,3 % du PIB). Une prévision pratiquement équivalente à celle de la Banque de France, qui table sur une hausse de 1,4 % en 2019. En revanche, l’Hexagone reste en queue de peloton européen pour son déficit public (encore 3,1 % du PIB prévu en 2019), ce qui laisse peu de marges de manœuvre au gouvernement Philippe pour accomplir la promesse du président Macron de réduire l’impôt sur le revenu des Français. Quant à la dette publique, elle devrait poursuivre à se rapprocher gravement des 100 % du PIB, à 99 % cette année.
Ce tableau général absorbant donnera-t-il des références aux tenants des réformes en zone euro ?
« L’économie européenne tient bon face à une conjoncture mondiale moins convenable et à des anxiétés persistantes. Nous devrions toutefois nous tenir prêts à porter plus de soutien à l’économie si nécessaire, en parallèle avec de nouvelles réformes propices à la croissance », a prévenu le commissaire à l’économie Pierre Moscovici.
Le Conseil européen de fin juin aurait à cet égard aménagé un rendez-vous important : les dirigeants de l’Union devraient enfin y décider des modalités adoptes pour l’embryon de budget de la zone euro homologué fin 2018. A condition que les Pays-Bas et la dizaine de petits pays qu’ils allient ne poursuivent pas à torpiller ce projet porté par la Commission Juncker et le président Macron.
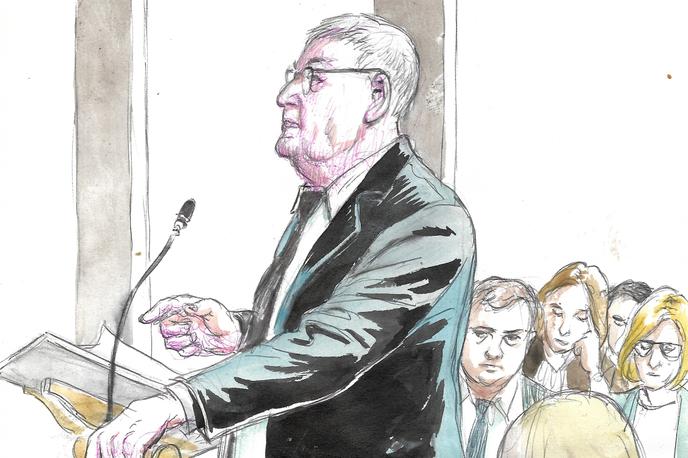









La Camif, commerçante en ligne de meubles et de linge de maison, est des premières « entreprises à mission ». Déterminé par la loi Pacte, ce statut dédie la notion d’intérêt social et ouvre la voie à une récente vision de l’entreprise. Son PDG, Emery Jacquillat, a prévenu tout le monde en faisant transformer les statuts de son entreprise dès novembre 2017.
Le capitalisme tel qu’on l’a connu vit-il ses dernières heures ?
Je ne peux pas le découvrir, mais il est vrai qu’il y a un modèle qui doit naître, et vite : un modèle d’entreprise plus participative avec une économie plus locale, plus inclusive, plus circulaire. Le chantier est énorme, il faut tout réinventer : le management, le modèle d’affaire, le cœur de l’offre… Nous n’avons plus le choix, il faut rendre nos activités acceptables sur le plan social et environnemental.
Est-ce que le passage sera doux ? Je ne le crois pas. Il y a aura des sociétés, des territoires et des régions qui seront incapables de s’assembler. Seules les entreprises les plus agiles et qui sauront utiliser le digital seront encore là dans vingt-cinq ou cinquante ans. Les actionnaires visionnaires auront vite compris que pour continuer à faire du profit il faudra miser sur des entreprises à impact positif. Le capitalisme responsable, c’est le capitalisme qui a tout compris.
Est-ce que vous restez optimiste pour la suite ?
Oui. Il y a chez de nombreux chefs d’entreprise et les collaborateurs cette soif de donner du sens. La prise de conscience collective s’est opérée dans les deux dernières années avec l’arrivée de Trump au pouvoir et la sortie des Etats-Unis de l’accord de Paris, la reproduction des rapports scientifiques alarmistes et plus récemment la démission de Nicolas Hulot. Les politiques ne savent plus faire ; c’est à nous de faire. L’entreprise « à mission » arrive à ce moment de notre histoire, pour arriver à encourager les entreprises à prendre des promesses qui se traduisent par des objectifs concrets et mesurables sur les enjeux sociaux et environnementaux.
Comment le digital peut-il aider les entreprises à prendre ce tournant ?
Tous les deux ans, on double le nombre de publications, de consciences abordables partageables par l’humanité. La donnée et l’intelligence sont aussitôt accessibles à toutes les entreprises. Je prends l’exemple de l’application Yuka, qui admet de scanner les produits alimentaires et d’estimer leur impact sur la santé. L’application utilise la base de données Open Food Facts. Demain l’IA sera accessible de la même manière. Tout l’enjeu est de s’obtenir de cette richesse d’informations pour la traduire en valeur économique, sociale et environnementale pour adoucir les défis.
La Camif est l’une des deux premières entreprises françaises à s’être affectées dans leurs statuts d’un « objet social étendu », « au bénéfice de l’homme et de la planète ». Comment y parvenir quand on vend des meubles et des objets de décoration ?
Demain on attirera mieux mais moins. Nous devons octroyer de la valeur aux objets qui nous terminent. En 2017, quand nous avons défini nos objectifs, nous avons acceptés qu’on n’y arrive pas en posant clairement notre cahier des charges sur la table des fabricants. Nous avons organisé un « Camifathon » pour assembler designers, consommateurs, fabricants et experts en économie circulaire.
De ces trois jours d’ateliers participatifs sont nées des collaborations, parfois entre des entreprises compétitrices, pour créer notre propre marque d’objets fabriqués à partir de déchets (canapés en tissus recyclés, matelas en matières recyclées, etc.). Pour nous, c’est une modification complete de métier. Nous passons de dispensateur à éditeur de meubles. Les chefs de produit deviennent des chefs de projets. C’est passionnant pour les équipes.
« Ce qu’on est en train de faire, je pense qu’on peut le faire dans tous les métiers »
Le digital permet aussi une meilleure information du client. Sur chaque fiche produit nous donnons le pays de fabrication, la liste des composants, des informations sur le fabricant… Nos recherches montrent que les clients veulent en savoir plus. Est-ce que les salariés sont heureux ? Est-ce que l’entreprise paye ses impôts en France ?
Cette clarté de l’information et la traçabilité des produits sont essentiels pour restituer la confiance dans les marques et permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé. Cette révolution, on la mène à notre petite échelle. Quand on contient de fermer notre site le jour du Black Friday, cela a un impact fort dans notre écosystème. Ce qu’on est en train de faire, je pense qu’on peut le faire dans tous les métiers.