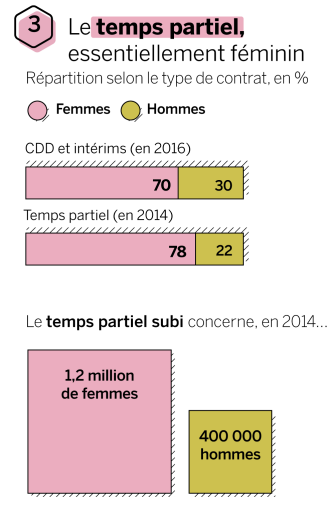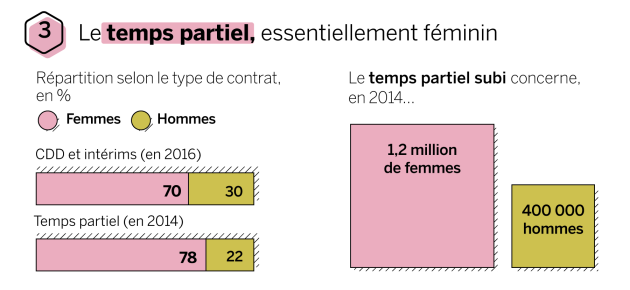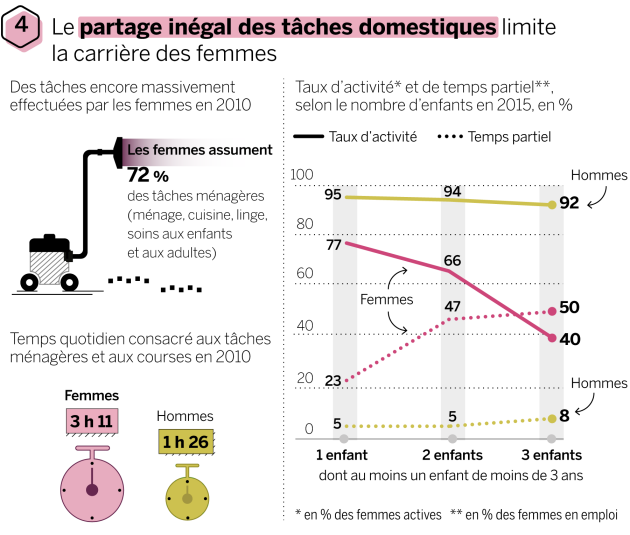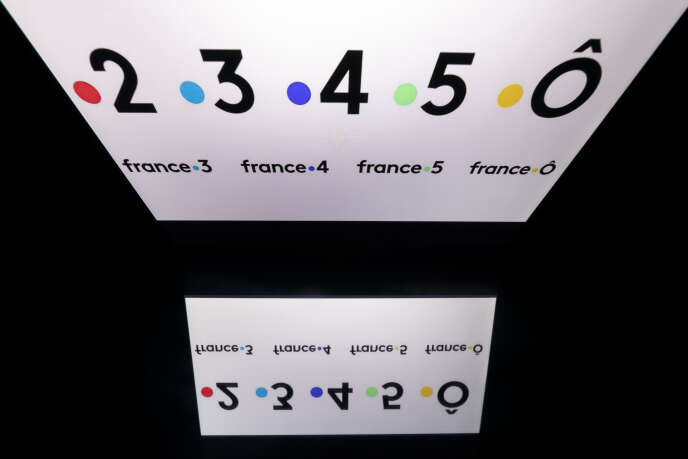Employées chez Google et activistes anti-harcèlement sexuel, elles dénoncent des représailles en interne

« Google mène des représailles contre plusieurs organisateurs » d’une protestation interne contre le harcèlement sexuel et pour l’égalité chez le géant du numérique, ont dénoncé, dans un e-mail interne envoyé lundi 22 avril, deux des figures du mouvement, révèle le site Wired.
Les auteures, Meredith Whittaker et Claire Stapleton, font partie des sept salariés qui ont lancé le Google Walkout for Real Change, une manifestation au cours de laquelle près de 20 000 employés sont descendus dans la rue, en novembre 2018, devant les bureaux de Google à Mountain View, en Californie, mais aussi à New York, Singapour, Londres, Dublin, Zurich, Toronto ou Chicago.
« On m’a dit que je serais rétrogradée »
Meredith Whittaker écrit que Google lui a annoncé que son rôle allait « changer énormément », peu après la dissolution, le 4 avril, du tout nouveau conseil d’éthique sur l’intelligence artificielle de l’entreprise. Ce démantèlement avait été décidé sous la pression d’une autre fronde en interne : près de 2 000 employés avaient protesté contre la présence dans ce comité d’une représentante conservatrice considérée comme « antitrans, anti-LGBTQ et anti-immigrants ». Meredith Whittaker – qui a notamment fondé l’AI Now Institute, une structure externe à Google destinée à la promotion de l’éthique dans l’intelligence artificielle – avait fait partie des protestataires, qualifiant sur Twitter la nomination d’« épouvantable ».
« On me dit que, pour rester dans l’entreprise, je vais devoir abandonner mon travail sur l’éthique de l’intelligence artificielle et l’AI Now Institute (qui est hébergé par l’université de New York) », écrit-elle dans l’e-mail envoyé à des employés de Google. « J’ai pris des risques pour pousser en faveur d’un Google plus éthique, bien que cela soit moins confortable », ajoute Mme Whittaker.
« Après cinq ans comme employée très performante au marketing de YouTube (et près de douze chez Google), deux mois après le Google Walkout, on m’a dit que je serais rétrogradée (…) et qu’un projet qui avait été approuvé n’était plus d’actualité », raconte, de son côté, Claire Stapleton. Celle-ci dit qu’après qu’elle a alerté les ressources humaines son supérieur « a commencé à [l]’ignorer », à donner son travail à d’autres et lui a conseillé de se mettre en arrêt maladie. « Ce n’est qu’après que j’ai engagé un avocat que la direction a mené une enquête et annulé ma rétrogradation, sur le papier. J’ai retrouvé mon travail, mais l’environnement reste hostile. Je réfléchis à démissionner presque chaque jour. »
De son côté, Google, dans une réaction officielle obtenue par Wired, nie les « représailles » :
« Nous interdisons les représailles sur le lieu de travail et menons des enquêtes en cas de soupçons. Les employés et les équipes se voient régulièrement assigner de nouvelles missions ou sont réorganisés, afin de s’adapter aux changements des besoins de l’entreprise. Il n’y a pas eu de représailles dans ce cas. »
Vague de mobilisations dans les entreprises de « tech »
L’e-mail des deux employées crée une forte réaction, car les grandes entreprises de technologie de la Silicon Valley connaissent, depuis plus d’un an, une vague de mobilisations internes : chez Google, des employés ont demandé la fin du contrat Maven, qui visait à aider l’armée américaine à analyser des images de drones grâce à l’intelligence artificielle. Une pétition a aussi dénoncé le projet de Google de créer un moteur de recherche adapté à la Chine et partiellement censuré. Chez Microsoft, des salariés se sont élevés contre une collaboration avec l’armée ou contre le traitement réservé aux femmes. Chez Amazon, une pétition demande une « vraie » politique de lutte contre le changement climatique.
Les représailles dénoncées lundi peuvent d’autant plus surprendre les employés que, dans plusieurs cas, comme le comité d’éthique de Google ou le contrat Maven, la direction avait publiquement soutenu leurs revendications, en arrêtant les projets critiqués. Après le Google Walkout, le PDG, Sundar Pichai, avait annoncé la fin du recours systématique à une « clause d’arbitrage » en cas d’accusation de harcèlement sexuel. Ainsi visé, Andy Rubin, le créateur du système d’exploitation mobile Android, avait quitté le groupe avec un chèque de 90 millions de dollars (80 millions d’euros au cours actuel) grâce à ce système de médiation discrète.
Une réunion de protestation annoncée pour vendredi
Mme Whittaker et Mme Stapleton, très actives dans la mobilisation chez Google, ne comptent pas en rester là et leur e-mail interne a aussi pour but d’appeler à la résistance : elles annoncent pour vendredi une grande réunion ouverte en interne et retransmise en vidéo en direct.
« Si nous voulons mettre fin à la discrimination, au harcèlement et aux décisions non éthiques, nous devons mettre fin aux représailles contre les gens qui s’expriment honnêtement sur ces problèmes », justifie Mme Stapleton.
« Les représailles contre les travailleurs qui organisent des protestations internes sont illégales, mais cela arrête rarement les dirigeants, a réagi sur Twitter le syndicat Tech Workers Coalition, qui mobilise les employés des entreprises numériques. Les manifestations fortes de solidarité, à l’intérieur et à l’extérieur de Google, peuvent aider. Il faut signifier clairement que les chefs ne s’en tireront pas comme cela avec ces abus. »