Les nouvelles limites du travail
« Le travail en mouvement » aborde des nouvelles pratiques productives et formes d’arrangement du travail ainsi que des implications pour les modes de reconnaissance au travail, du travail et par le travail.
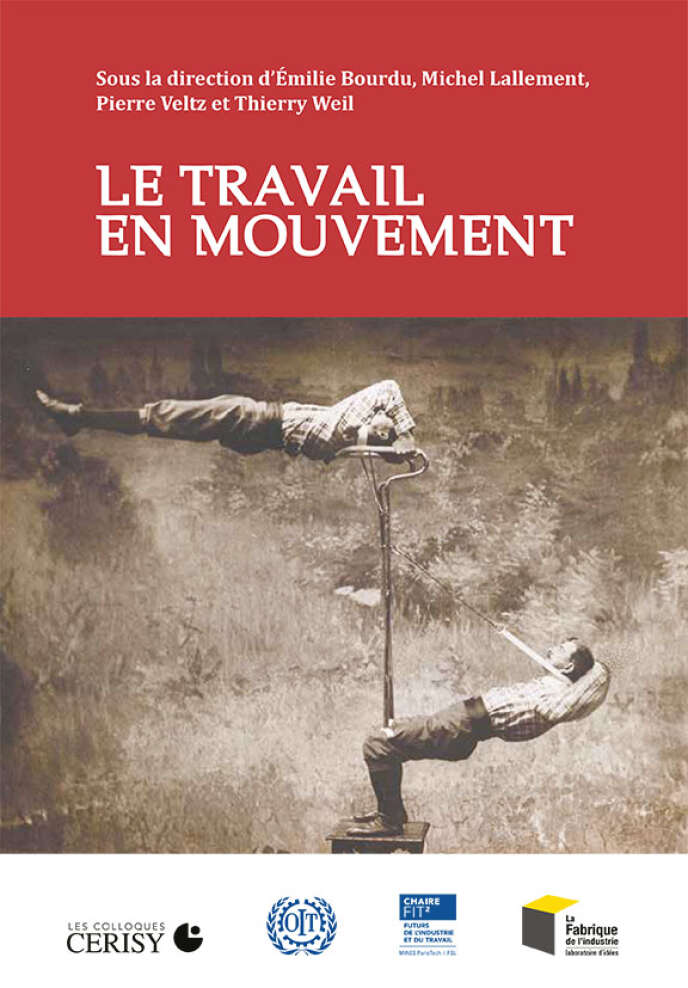
Révolution numérique, nouvelles tendance de gestion des activités productives : les indices d’une vaste recomposition du travail ne cessent de se multiplier. « A l’image des transformations qui affectent les lieux comme les temps des pratiques professionnelles, ce sont les frontières mêmes du travail qui sont aujourd’hui en train de bouger », estiment Emilie Bourdu, Michel Lallement, Pierre Veltz et Thierry Weil. L’ouvrage qu’ils dirigent, Le Travail en mouvement (Presse des Mines), « a pour ambition d’entrer dans le vif des débats et des pratiques, de repérer des constantes et des innovations, de porter attention à des expérimentations locales comme aux enjeux mondiaux. »
Quelles nouvelles pratiques productives et quelles nouvelles formes d’organisation du travail observe-t-on actuellement? Comment se transforment les frontières du travail ? Quelles sont les implications pour les modes de reconnaissance au travail, du travail et par le travail ? Ces trois axes principaux structurent l’ensemble des contributions recueillies dans l’ouvrage.
L’accent est mis sur les changements contemporaines du travail, « en organisant des va-et-vient constants entre enjeux analytiques et prise en compte d’expérimentations pratiques ».
Statistiques, bilans d’expériences dans les ateliers comme sur les territoires, représentation imagée que nous offrent la littérature et le cinéma, régulations sociales et normalisation des normes juridiques… Les entrées thématiques sont diversifiées, tout comme les approches disciplinaires et les expertises professionnelles, de façon à appréhender le travail « d’une manière peu coutumière mais particulièrement heuristique ».
Défis et incertitudes
Les effets pathologiques, non uniquement de l’intensification du travail mais aussi de son envahissement progressif dans tous les temps et les sphères de la vie personnelle, sont au cœur de plusieurs romans récents, comme le montre la contribution de Laurence Decréau, agrégée de lettres classiques.
Les frontières entre types d’activité et statuts professionnels sont à tels points chahutées que la norme semble dans la suite être celle de l’entre-deux : statut de salarié et d’indépendant, d’actif et d’inactif… Le débat sur l’opportunité d’instaurer, ou non, un revenu universel mérite alors attention. Les réponses faitepar Yannick Vanderborght, professeur de sciences politiques à l’université Saint-Louis-Bruxelles, et Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances honoraire, divergent radicalement. Une même préoccupation émerge néanmoins, et concerne directement le statut du travail. Est-ce un quasi-invariant anthropologique qui appelle une contrepartie monétaire en lien direct avec l’activité effectuée ? Ou doit-on jouer la carte de la solidarité au risque de brouiller les frontières entre travail et non-travail ?








