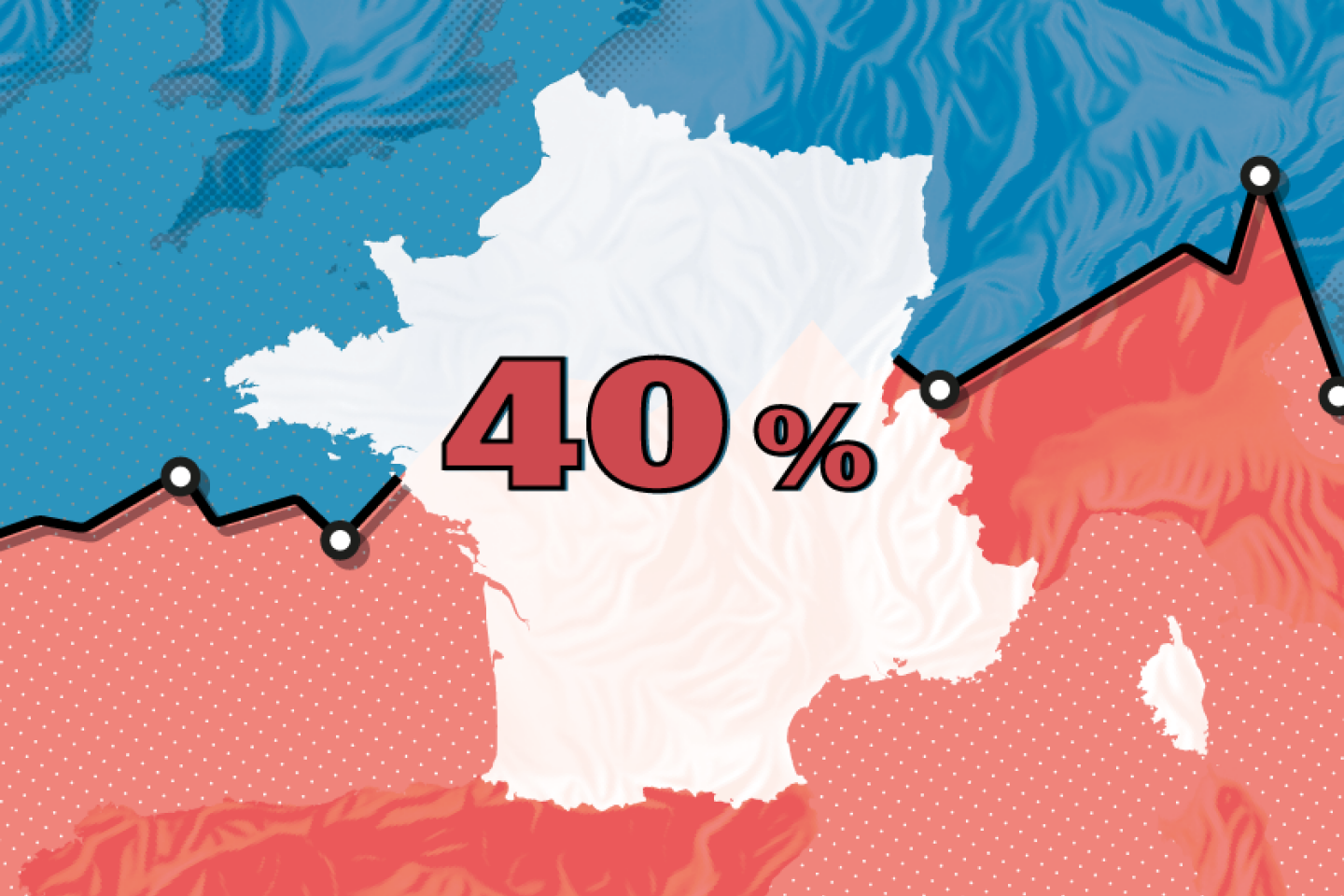« Il ne peut y avoir de responsabilité sociale et environnementale digne de ce nom sans achats responsables »

Les achats responsables sont une dimension essentielle et de mieux en mieux reconnue de la performance sociale et environnementale des entreprises. A force d’externalisation, la part des achats dans le chiffre d’affaires a augmenté de façon considérable ces dernières années, jusqu’à en représenter de 70 à 80 % dans des secteurs comme l’aéronautique ou l’automobile, et 60 % en moyenne tous secteurs confondus.
De tels pourcentages ont conduit les dirigeants à prendre conscience du fait qu’il ne peut y avoir de responsabilité sociale et environnementale (RSE) digne de ce nom sans achats responsables.
Il est révélateur de constater quel’étude 2023 sur les « Performances RSE des entreprises françaises et européennes – comparatif OCDE et BICS », réalisée par EcoVadis et le Médiateur des entreprises, propose pour la deuxième fois un point spécifique sur le thème des achats responsables, alors que les études antérieures restaient centrées sur l’environnement, la dimension sociale et l’éthique.
Les performances des pays nordiques
L’étude porte sur un important échantillon de 25 699 entreprises de l’Union européenne (UE), dont 13 % de plus de 1 000 salariés (les entreprises de moins de 25 salariés sont exclues de l’étude). Les trois pratiques d’achats responsables le plus souvent observées sont l’évaluation RSE régulière des fournisseurs et/ou le recours aux audits sur site (52 %), l’existence d’un code de conduite imposé aux fournisseurs (34 %) et l’insertion de clauses contractuelles RSE (25 %).
Les performances des pays nordiques ont justifié la création par les auteurs de l’étude d’une nouvelle catégorie géographique, « Nordics », dont il est particulièrement instructif d’observer les pratiques d’achats responsables. On peut, par exemple, noter le recours plus fréquent à la réalisation de cartographie des risques RSE (20 %, contre 14 % en France).
D’autres études ou baromètres comme ceux de l’Observatoire des achats responsables (Obsar) ou le Peak Collaborative Index montrent que l’intérêt des achats responsables est de mieux en mieux compris au sein des organisations.
Des marges de progrès
Dans les plus de 7 000 entreprises françaises évaluées par l’étude citée plus haut, le thème des achats responsables est évoqué par 48 % des répondants contre 45,5 % en 2018, un score supérieur à ceux observés en moyenne dans l’UE (44,9 %), dans l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 42,9 %) ou chez les BICS (Brésil-Inde-Chine-Afrique du sud, 33 % en 2022), mais inférieurs à ceux des autres thèmes (environnement, social, éthique).
Il vous reste 30% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.