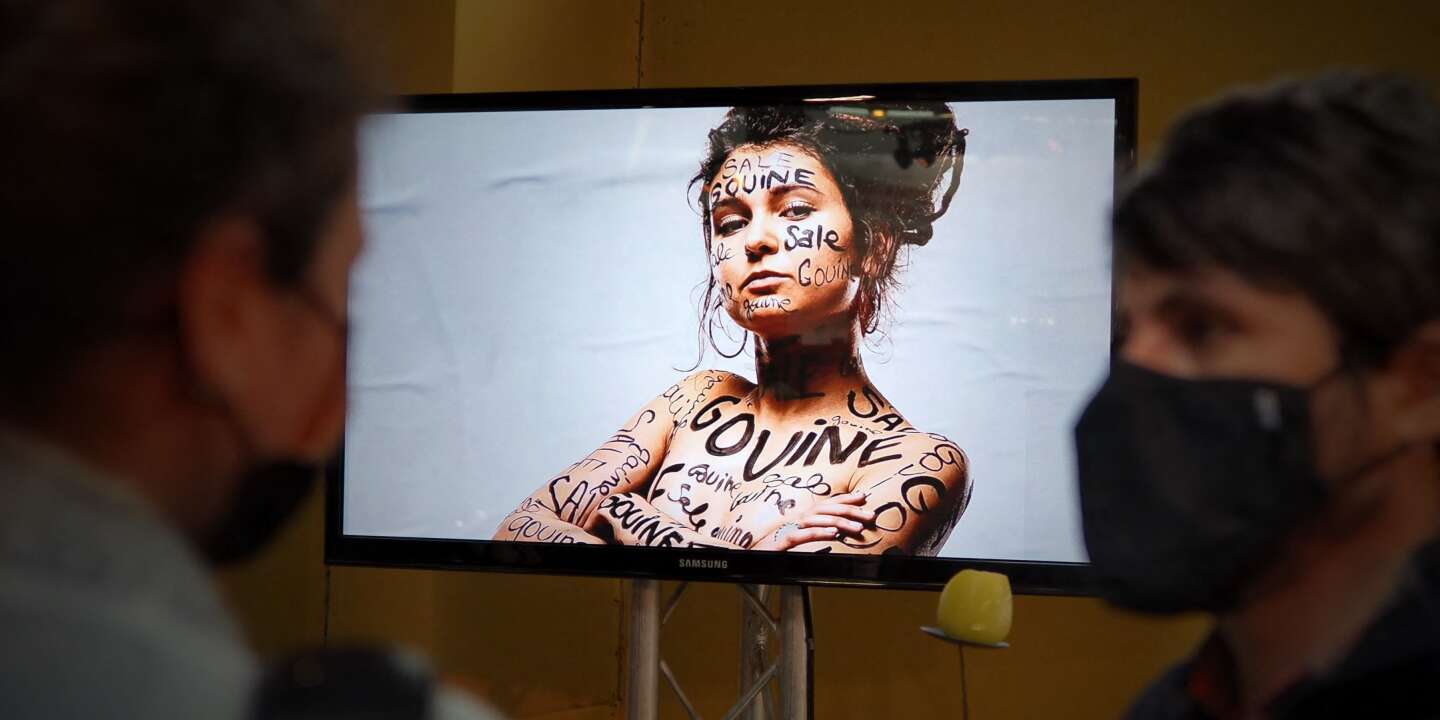Passe sanitaire : polémique autour de la question des licenciements

La volonté de consensus n’aura duré que quelques heures. Après avoir trouvé un terrain d’entente sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, l’exécutif et la majorité sénatoriale s’affrontent de nouveau sur ce texte, définitivement adopté, dimanche 25 juillet, par le Parlement. Dans un communiqué commun, les groupes Les Républicains (LR) et Union centriste au Palais du Luxembourg ont fustigé, mercredi 28 juillet, les déclarations « inopportunes » et « sans aucun fondement juridique » de deux membres du gouvernement : la ministre du travail, Elisabeth Borne, et sa collègue chargée de l’industrie, Agnès Pannier-Runacher. Une polémique qui alimente la confusion sur la portée réelle de certaines mesures.
La querelle concerne les « salariés récalcitrants », un vocable qui a émergé à la faveur des débats pour désigner les travailleurs dépourvus de passe sanitaire alors qu’ils sont tenus d’en avoir un. Le projet de loi, voté en première lecture à l’Assemblée nationale, permettait aux patrons de licencier leurs collaborateurs dans cette situation, passé un délai de deux mois. Mais les sénateurs, en particulier de la droite et du centre, se sont opposés à une telle disposition, la jugeant excessivement punitive. Après d’âpres discussions, un compromis a été trouvé sur des règles un peu moins dures. Pour les personnes employées en CDI qui ne fournissent pas le justificatif requis, le contrat de travail sera suspendu, tout comme le versement de la rémunération. La possibilité de les congédier, initialement envisagée, a été supprimée à l’issue des tractations en commission mixte paritaire.
Mais cette solution n’est pas aussi protectrice que ce que disent les sénateurs, selon Mme Borne. Sur BFM-TV, la ministre du travail a mis les pieds dans le plat, mardi, en indiquant : « Je crois qu’il faut être clair. Ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir de licenciement. Cela veut dire qu’il sera moins encadré, peut-être qu’il pourra intervenir plus tôt. » En d’autres termes, les entreprises conserveraient la faculté de se séparer de leurs salariés récalcitrants. Elles pourraient, qui plus est, rompre la relation de travail plus rapidement que dans le dispositif imaginé à l’Assemblée nationale puisque celui-ci prévoyait un délai de deux mois, finalement abandonné. Mme Pannier-Runacher a abondé dans le même sens en affirmant, mercredi, sur LCI, que les sénateurs « n’ont pas du tout interdit le licenciement ». « Ils ont enlevé les protections que nous avions tenues à mettre (…) pour rendre ce licenciement très difficile à mettre en œuvre », a-t-elle ajouté.
Il vous reste 43.48% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.