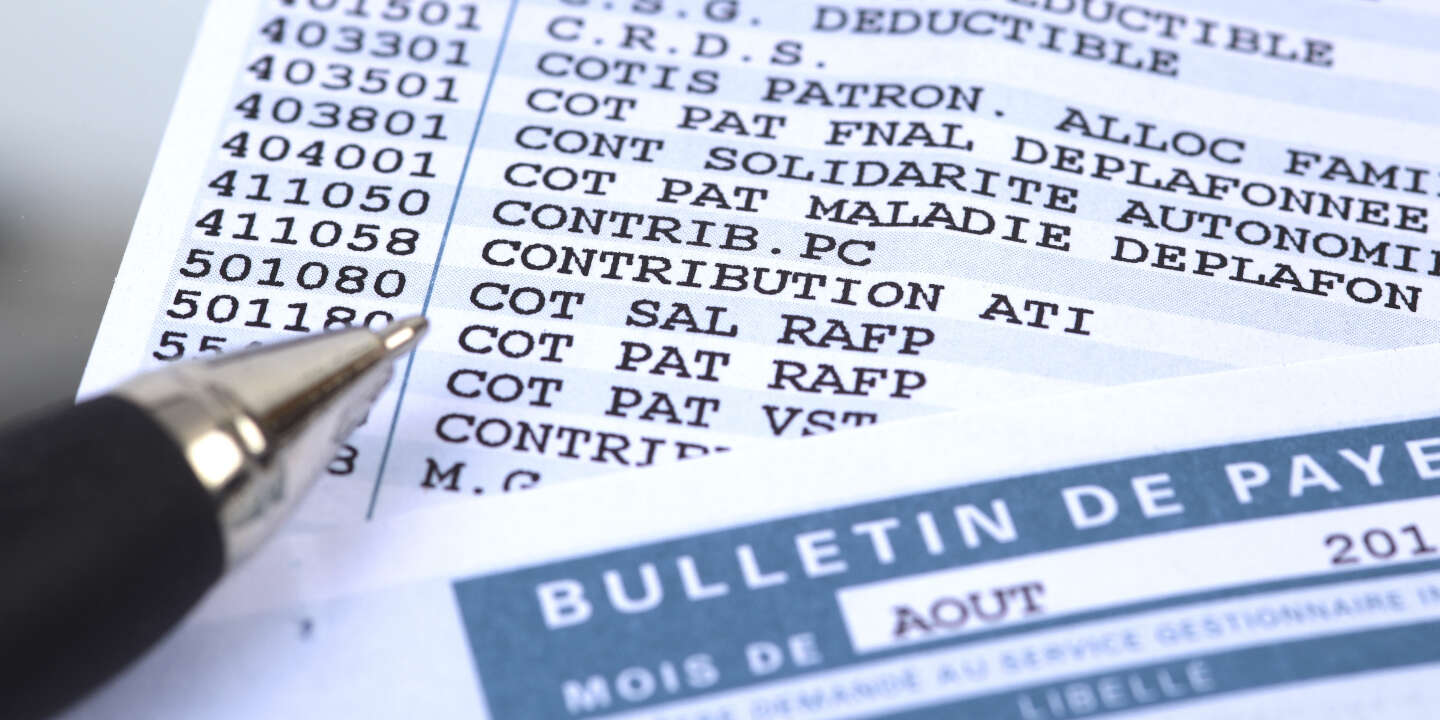A 33 ans, Soazig fait partie de ces « nouveaux milliardaires » que le Cantal à déterminer de mettre en avant. Après deux ans passés en Guyane, la jeune femme a aperçu, il y a un an, un emploi de responsable de la planification et des achats dans une entreprise de probiotiques. S’établir dans un département très rural quand on n’y a pas d’attaches ?
« Au départ, j’étais très réticente, mais tous mes stéréotypes sur ce département sont tombés », explique-t-elle en exposant les dix petites minutes de trajet entre son domicile et son travail – ici, on rentre chez soi pour déjeuner ! – l’entourage de la crèche et de l’école, et la possibilité de se loger à des prix défiant toute concurrence. Et c’est sans adapter la facilité d’apercevoir un emploi dans un département où le taux de chômage – 5,5 % au troisième trimestre 2018 – est l’un des plus bas de France.
« Le taux de chômage est souvent traduit comme un baromètre de la santé économique, mais celle-ci ne peut se diminuer à cette seule analyse »
Le Cantal, un vrai pays de cocagne ? Voire. En réalité, les chiffres de l’emploi dissimulent une situation difficile. « Le taux de chômage est souvent expliqué comme un baromètre de la santé économique, mais celle-ci ne peut se réduire à cette seule analyse, prévient l’Insee dans une note de janvier. Dans le Cantal, le chômage bas reflète plutôt un manque de dynamisme. »
Affecté de plein fouet par la « déprise démographique », la population active recule d’année en année. Au point d’exposer le développement des entreprises. « Nous avons des difficultés à profiter de la reprise économique parce que nous manquons de main-d’œuvre, explique Bernard Villaret, le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Cantal. Aujourd’hui, les territoires sont en concurrence, et nous avons décidé de nous différencier pour faire venir des actifs d’autres régions. »
D’où l’initiative des « nouveaux milliardaires », une série de petits films postés sur Facebook pour vanter une qualité de vie digne des plus fortunés. La CCI a également lancé des salons de recrutement virtuels nommés « Le Cantal et vous, ça matche ! ». A la fin de l’année dernière, 150 offres d’emploi ont été publiées, occasionnant 6 000 connexions. Cette expérience réussie doit s’ouvrir sur la création d’une plate-forme permanente. Elle doit escorter la mise en œuvre de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l’échelle des bassins d’emploi du département. « Nos entreprises n’ont souvent pas de direction des ressources humaines, et les patrons ont le nez dans le guidon, constate Bernard Villaret. Il faut les aider à faire le point sur leur besoins, organiser les recrutements et développer des formations. »
Chantiers de réhabilitation
A Vichy, dans l’Allier, la problématique du marché de l’emploi est tout autre. « Vichy est connu pour le thermalisme, mais c’est avant tout un bassin industriel », note Olivier Laffont, le directeur de l’agence Pôle emploi. Avec un tiers des emplois dans l’industrie, Vichy est très au-dessus de la moyenne de la France métropolitaine qui plafonne à 13 %. « Cette année et l’année prochaine, entre 400 et 500 nouveaux emplois industriels vont être créés », poursuit Olivier Laffont. Ce qui se traduit par de réelles pénuries de recrutement. Le constat a débouché sur l’opération « Objectif industrie », qui vise à valoriser les métiers de ce secteur et surtout à développer la formation continue et initiale. « Nous allons travailler avec l’éducation nationale et la communauté d’agglomération pour créer une plate-forme industrielle au lycée Albert-Londres », déclare Olivier Laffont.
Montluçon Habitat, l’organisme HLM de la ville, a décidé de soutenir sa pierre au développement de l’emploi
C’est encore une autre vérité qui sort à Montluçon, toujours dans l’Allier. Avec un taux de chômage de 10,5 % et un chômage de longue durée de plus de 50 %, la zone d’emploi affiche les plus mauvais chiffres de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est dans ce contexte difficile que Montluçon Habitat, l’organisme HLM de la ville, a déterminé d’apporter sa pierre au développement de l’emploi. Pour deux chantiers de réhabilitation de logements qui ont commencé en octobre 2018, les entreprises ont dû recruter des personnes des quartiers concernés pour l’équivalent de huit postes. Ce dispositif est prévu par le code des marchés publics qui autorise l’intégration de clauses sociales dans les appels d’offres.
L’objectif est de conserver une partie des heures de travail engendrées par la commande publique à des actions d’insertion. Dans les cinq prochaines années, les opérations de renouvellement urbain (240 logements démolis et 188 réhabilités) conduites avec Montluçon Communauté, solliciteront 15 000 heures de travail qui seront réservées aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« Pour les entreprises, c’est une contrainte parce qu’elles doivent assimiler et recruter du personnel supplémentaire », reconnaît Roselyne Delivet-Vavra, la directrice générale de Montluçon Habitat. Pour les aider, elle a fédéré tous les acteurs locaux de l’insertion : « En définitive, chacun y trouve son compte. Les entreprises peuvent borner de futurs salariés qui vont éventuellement pouvoir bénéficier de formations. » Sans compter que le dispositif est aussi très « positif humainement et socialement ».
A Thiers, l’objectif zéro chômeur
C’est un jour de Fête du travail, le 1er mai 2017, qui a été emblématiquement choisi pour la création d’Actypoles, à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. A l’approche de son deuxième anniversaire, cette entreprise d’un type nouveau a déjà recruté 69 chômeurs de longue durée et a développé toute une série d’activité, allant de la mécanique auto à l’entretien des espaces verts en passant par la collecte des encombrants ou le reconditionnement informatique.
« Il y a une centaine de personnes qui sont sur liste d’attente mais nous ne souhaitons pas que notre effectif dépasse les 80 ou 90 personnes, pour soutenir une dimension humaine », explique la directrice d’Actypoles, Laure Descoubès. Mais pas question pour autant de baisser les bras : une deuxième « entreprise à but d’emploi » (EBE), guidée vers les services à la personne, doit voir le jour, d’ici à l’été, dans la capitale française de la coutellerie.
Actypoles fait partie des dix applications françaises « territoire zéro chômeur de longue durée ». Le modèle économique, défini par la loi de février 2016, consiste à réaffecter les coûts et les manques à gagner dus à la privation d’emploi (RSA, CMU etc.) à la rétribution d’activités qui ne sont ni dans le champ de l’activité concurrentielle ni dans celui des services publics. « Pour chacun de nos CDI au smic, nous percevons 18 000 euros par an, ce qui correspond environ aux trois quarts du coût d’un emploi », détaille Laure Escoubès.
L’entreprise, qui a aisé un chiffre d’affaires de 200 000 euros en 2018, finance le complément. Selon un rapport d’étape du Fonds d’application territoriale contre le chômage de longue durée, présidé par l’ancien patron de la SNCF Louis Gallois, ce modèle d’activation des dépenses sociale est « neutre » pour les finances publiques.
Le plan « pauvreté » exposé en septembre 2018 par Emmanuel Macron prédit une deuxième loi pour étendre l’expérimentation à d’autres territoires. Plus d’une centaine ont d’ores et déjà exprimé leur intérêt.




![« Un sondage de 2 000 employés, réalisé par l’institut de sondages Civic Science, montre que 54 % d’entre eux [Américains] poursuivent leur activité lorsqu’ils sont malades. »](https://img.lemde.fr/2019/04/02/0/0/5616/3744/688/0/60/0/c0a06ae_z2V6Gpm-IHE6yz3u-v9A0IR6.jpg)