ADP-General Electric : « La droite se rapproche de la gauche au sein d’alliances factices »
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
Les employés du magasin accusent le coup, après l’annonce, lundi, d’un plan social visant 1 900 postes dans le groupe en France. Le comité central d’entreprise doit détailler jeudi le plan de restructuration
Article réservé aux abonnés

« Dix-neuf ans passés au Conforama de Vitry-sur-Seine [Val-de-Marne] et on apprend par la télévision que le magasin va fermer, c’est dur. J’ai 46 ans, que vais-je faire ? », déclare, amer, Zenagui – toutes les personnes citées dont le nom n’apparaît pas ont souhaité garder l’anonymat. Le 1er juillet, ce vendeur a « pris une claque » en découvrant l’ampleur de la restructuration du groupe d’ameublement. Certes, les difficultés financières de l’entreprise étaient connues – en six ans, elle a cumulé 480 millions d’euros de pertes –, tout comme le scandale financier dans lequel est empêtré son principal actionnaire, le groupe sud-africain Steinhoff.
« Il n’empêche, on ne s’attendait pas à autant de licenciements », explique Nadia Nattiez, déléguée CGT du Conforama de Vitry, qui a noué à son bras un foulard noir, « en signe de deuil ». Pas moins de trente-deux magasins vont fermer leurs portes, auxquels s’ajoutent dix boutiques du réseau Maison Dépôt, qui disparaîtra. Le siège social et d’autres services sont aussi touchés. Au total, 1 900 postes sont supprimés, sur les 9 000 employés dans l’Hexagone.
Rencontrés à quelques jours du comité central d’entreprise, qui doit se tenir jeudi 11 juillet, durant lequel la direction va détailler son plan de réorganisation, les salariés sont encore sous le choc. « Je ne dors plus depuis une semaine. Comment vais-je faire avec mes trois enfants à charge ? », raconte Aliya (le prénom a été modifié), mère célibataire de 36 ans, en CDI à Vitry depuis dix ans. L’éviction surprise du directeur général du groupe, mardi 9 juillet, a renforcé les inquiétudes des salariés, qui, à l’image de Nadia, ne se font guère d’illusion sur d’éventuels reclassements. Contactée, la direction du magasin n’a pas souhaité faire de commentaires.
Devant le magasin, qui emploie 87 personnes, le sujet est évidemment au cœur de toutes les discussions. Un à un, les employés livrent leur histoire. Tous ont l’impression d’appartenir à la « famille Conforama ». A 36 ans, Samir y travaille depuis treize ans. Enfant de Vitry, il n’a jamais voulu quitter sa ville natale. Ni Conforama. « J’y ai même rencontré ma femme. Elle est à Conforama depuis dix ans, et nous attendons un enfant pour janvier ». Au moment où les premières lettres de licenciement sont censées arriver.
Des difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité, comme l’informatique ou le conseil, renversent le rapport de forces en faveur des stagiaires pour accéder au monde du travail.
Article réservé aux abonnés

Axel est un stagiaire heureux. Etudiant à l’Edhec et actuellement en année de césure, il s’apprête à quitter l’entreprise Red Bull, où il a passé plusieurs mois. Des responsabilités, beaucoup de connaissances acquises : il est ravi. « Mon manageur a vraiment pris du temps pour moi, nous avons eu de nombreux échanges ! » Dans l’unité chargée des partenariats où il a travaillé, il a eu, au fond, le sentiment de « ne jamais avoir été considéré comme un stagiaire ». Youssef, lui, est serein. Etudiant en mastère spécialisé cybersécurité à Télécom Paris, il a pu choisir son entreprise parmi plusieurs propositions pour son stage de fin d’études. « Et la plupart des sociétés qui prennent des stagiaires proposent un CDI dans la foulée », dit-il.
Satisfaits de leur situation, ces stagiaires précisent toutefois que l’ère du « stage photocopie » n’est pas révolue pour tout le monde. « Il y a encore des entreprises où les stagiaires travaillent énormément sans apprendre grand-chose », témoigne un étudiant en management. Pour autant, dans des secteurs comme ceux où évoluent Axel et Youssef, une nouvelle musique se fait entendre, un air de revanche pour la communauté des stagiaires.
Un nouveau rapport de forces leur est aujourd’hui favorable. Certains domaines d’activité (informatique, conseil…) connaissent d’importantes difficultés de recrutement. Les stagiaires y deviennent un vivier stratégique. « Tout l’enjeu pour les entreprises est de les retenir à l’issue du stage, confirme Jérôme Chemin, secrétaire général adjoint de la CFDT Cadres. Dans le secteur du conseil, un stage devient désormais une véritable pré-embauche. »
Manuelle Malot, directrice de l’Edhec NewGen Talent Centre, parle de « relation de mariage à l’essai, où la séduction a toute sa place. Les entreprises ont besoin que les stages se passent bien pour faire ensuite une offre ferme d’embauche ». Financièrement, « les rémunérations mensuelles proposées pour certains stages peuvent atteindre les 2 000 euros net », indique Mme Malot.
La nouvelle donne n’a pas échappé aux étudiants, qui se montrent parfois plus exigeants. Ils peuvent y être encouragés par les organismes de formation : « Nous leur expliquons qu’un entretien pour un stage ne doit pas être à sens unique, poursuit Mme Malot. Ils doivent poser les bonnes questions pour mesurer s’ils ont envie de travailler dans l’entreprise : quel est le contenu de la mission, la façon dont ils seront managés…, des éléments qui étaient auparavant davantage évoqués lors d’un entretien d’embauche. »
Avis d’expert. Les Chèques-Vacances, qui concernent près de dix millions de personnes, obéissent à des dispositifs très stricts, aussi bien pour celui qui en bénéficie que pour les organismes qui les attribuent, comme le démontre Francis Kessler
Article réservé aux abonnés

Droit social Les départs en congé auront été ou seront payés, partiellement, par des Chèques-Vacances. Ces titres nominatifs spéciaux de paiement sont utilisables dans l’Union européenne et destinés à régler des dépenses, à savoir des transports en commun, des frais d’hébergement, des frais de repas, ainsi que des « frais de culture » et « de loisirs » de vacances.
Selon le dernier bilan annuel disponible de l’Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), l’établissement public chargé de la politique en la matière, 10 millions de personnes en ont bénéficié, pour 1,6 milliard d’euros directement remis par chaque bénéficiaire aux collectivités publiques et aux prestataires agréés, soit à 202 000 professionnels du tourisme et du loisir.
Les mécanismes juridiques de cette « solvabilisation » de touristes, principale réalisation, en 1982, de l’éphémère ministère du temps libre, sur le modèle des chèques Reka émis depuis 1939 par la Caisse suisse de voyage, sont peu connus et peuvent se révéler parfois délicats à manier.
Il existe deux grands types de diffuseurs de Chèques-Vacances. D’une part, des organismes sociaux, notamment les caisses d’allocations familiales, celles de la MSA (Mutualité sociale agricole), les centres communaux d’action sociale, les caisses de retraite, les établissements et services d’aide par le travail, les mutuelles, les services sociaux de l’Etat, des collectivités publiques ainsi que les organismes paritaires de gestion d’activités sociales créés par accord collectif de branche ou territorial.
D’autre part, le Comité social et économique (CSE), qui peut également les attribuer à des salariés au titre des activités sociales et culturelles. Il s’agit de permettre aux personnes les plus défavorisées de pouvoir partir en vacances, autrement dit de lutter contre la « fracture touristique », selon la terminologie de la convention d’objectifs et de performance 2017-2021 Etat-ANCV.
Les carnets de chèques en coupures de 10, 20, 25 et 50 euros, ou les tout récents e-Chèques-Vacances de 60 euros utilisables exclusivement sur Internet, émis par l’ANCV, peuvent être cofinancés par les employeurs et les salariés et, le cas échéant, le CSE.
En l’absence de règle légale impérative, certaines conventions collectives de branche ou d’entreprise imposent cette forme de rémunération non salariale. Mais le plus souvent, l’entreprise décide seule de ce dispositif. C’est là que les choses se compliquent, car l’Etat subventionne ces chèques à la fois dans le cadre de son budget et au moyen d’exonérations partielles de cotisations sociales, donc avec les finances du régime général de la Sécurité sociale et la non-prise en compte partielle de la contribution patronale dans le calcul de l’impôt sur le revenu du salarié.
Dans cette étude sur le chômage les auteurs expliquent la manière de lutter contre en montrant à travers de nombreux exemples comment les territoires peuvent intervenir et redonner espoir et dignité à ceux et celles écarter de l’emploi.
Article réservé aux abonnés
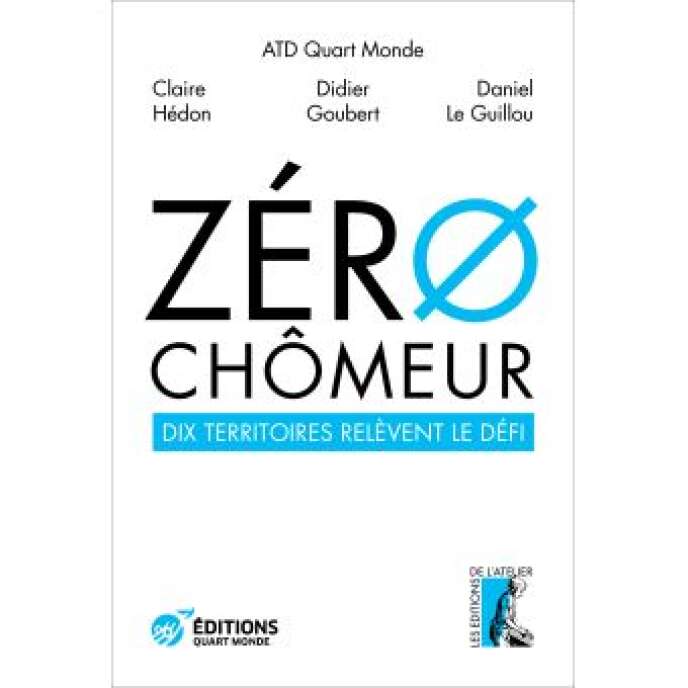
Le livre. Eradiquer le chômage, c’est le défi que raconte Zéro chômeur, le livre de Claire Hédon, Didier Goubert et Daniel Le Guillou. Respectivement présidente du mouvement ATD Quart-Monde France, dirigeant de Travailler et apprendre ensemble et vice-président de l’entreprise à but d’emploi Actypoles-Thiers, ils sont les trois acteurs de premier rang de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » lancée en 2016 à l’initiative de ATD Quart-Monde, est menée depuis janvier 2017 dans dix communes de France.
Leur base de travail est que personne n’est inemployable, que le travail ne manque pas et l’argent non plus, si l’on considère les 45 milliards d’euros d’indemnisation chômage. Les auteurs rejettent la notion de « chômage », trop exclusive, pour adopter celle de « privation d’emploi ».
L’enjeu est de taille, « au niveau de la société, la privation durable d’emploi est tout simplement une aberration économique », rappellent les auteurs. Le coût en 2017 pour les seuls deniers publics de chaque personne privée durablement d’emploi était « au minimum de 16 000 euros par an ». Après deux ans d’expérimentation, ils évaluent à 18 000 euros par an et par emploi à plein temps le gain de l’opération « Territoires zéro chômeur » pour les finances publiques.
L’ouvrage revient aux sources du projet « Territoires zéro chômeur », à savoir l’analyse de l’évolution du marché du travail et du poids de la précarité. « Près de 50 % des personnes privées d’emploi le sont depuis plus d’un an. » Alors que le taux de chômage est à la baisse, la part des chômeurs de longue durée poursuit sa hausse : 2,6 millions de chômeurs de longue durée fin 2018, contre 1 million en 2008. Même chez les cadres, quasiment au plein-emploi (3,8 %), on compte 100 000 chômeurs de longue durée. Mais le chômage ne se résume pas à un équilibre entre l’offre et la demande, il touche les personnes « en fonction de leur niveau de qualification et de leur localisation ».
D’où l’idée de concevoir une approche qualitative appliquée à un territoire pour répondre aux besoins. Après deux ans d’expérimentation, 800 emplois ont ainsi été créés. L’efficacité passe par une construction entre acteurs qui « se connaissent » et qui partagent un présent et un avenir commun. « A l’échelle du territoire est proposé à toutes les personnes privées durablement d’emploi et qui le souhaitent un emploi en CDI au smic, à temps choisi et adapté à leurs compétences », expliquent les auteurs. Deux conditions sont posées : la domiciliation sur la commune depuis au moins six mois et la recherche active d’emploi.
Pour sa dernière chronique au « Monde » à l’heure de son départ à la retraite, qui sera active, la journaliste Annie Kahn rappelle l’importance de ce moment pour le salarié, mais aussi pour ceux qui restent et pour l’entreprise.
Article réservé aux abonnés

Ma vie en boîte. L’entreprise a ses rituels. Le pot de départ d’un collaborateur en est un, et non des moindres. Surtout lorsqu’il célèbre la fin d’une vie professionnelle, le mal nommé « départ à la retraite ». Des pans entiers de l’histoire de l’entreprise y sont évoqués, des anecdotes donnent un aperçu impressionniste de la culture maison et de son évolution, complétant les présentations officielles désincarnées.
L’orateur fait son deuil de cette tranche de sa vie, tout en transmettant son expérience aux plus jeunes. Les plus anciens évoquent leurs souvenirs. Ce qui ne fait que renforcer leur sentiment d’appartenance à cette communauté professionnelle. On pourrait ironiser en disant que cela n’est que de la mascarade, durant laquelle chacun avance encore plus masqué que d’habitude. Seuls les bons souvenirs s’échangent.
On passe un voile pudique sur les peaux de banane que les uns ou les autres ont pu déposer sous les pieds de la personne fêtée. Certes. Mais le moment est aussi propice à des échanges profonds et sincères, qui n’avaient pu être exprimés, par pudeur, timidité, ou respect des convenances. Pour le plus grand bien du partant, mais aussi pour celui ou celle qui les profère. L’authentique côtoie donc le fallacieux. Peu importe le mélange des genres. Il réconforte celui qui part, et ceux qui restent.
La numérisation, le télétravail et, surtout, le recours accru à des travailleurs indépendants vont-ils sonner le glas de ces événements essentiels ? La multiplication des espaces de cotravail prouverait plutôt le contraire : des salariés fréquentent ces tiers lieux et y « font société » avec des personnes aux parcours divers dont ils partagent les locaux. Tout est alors affaire de dosage. Une périodicité optimale leur permet de s’ouvrir à d’autres, sans couper les liens qui les unissent à leurs collègues historiques. Quand ils partiront, ils diront au revoir à tous.
Quant aux autoentrepreneurs, ils pratiquent le coworking par désir de ne pas travailler seul. On y discute autour de la machine à café, comme ailleurs. Une communauté de travail s’y recrée avec ses propres rituels. Il n’est d’ailleurs pas rare d’y croiser les mal nommés « retraités » d’hier, qui s’y refont une jeunesse. Loin d’être « des personnes retirées des affaires, éloignées du monde, vivant à la campagne », ou « se livrant à des exercices de piété », comme les qualifie le Littré, ils sont de plus en plus nombreux pour qui le pot de départ est celui d’un rebond vers de nouvelles aventures.
Le Conseil d’administration a révoqué le mandat de M. Deshayes. Le groupe a annoncé, le 2 juillet, un plan de restructuration prévoyant la suppression de 1 900 postes.

Une semaine après l’annonce d’un vaste plan social, le conseil d’administration (CA) de Conforama a révoqué mardi 9 juillet le directeur général du groupe, Frank Deshayes. Une décision qui a « décuplé » les inquiétudes des syndicats, a appris l’Agence France-Presse (AFP) auprès de représentants de Force ouvrière (FO) et de la Confédéraion générale du travail (CGT).
« On ne sait pas les raisons » de cette révocation, a précisé Mouloud Hammour de FO, secrétaire du comité central d’entreprise (CCE), confirmant une information du Parisien. Les représentants du personnel au conseil n’ont pas eu le temps d’y siéger car ils n’ont été convoqués qu’« à 11 heures » pour une réunion « à midi pour débarquer M. Deshayes », a précisé Abdelaziz Boucherit de la CGT.
Cette révocation « est un camouflet pour lui et pour nous car c’était l’un des seuls interlocuteurs encore loyaux pour les salariés. Il se démenait pour nous », a regretté M. Hammour.
Désormais, « il n’y a plus au CA que des représentants des créanciers », juge M. Boucherit, car ce départ « ne va pas dans le sens d’une reprise de la marche de l’entreprise ». « On ne croit pas vraiment à un plan de relance. Conforama est plutôt dans une optique d’économies à faire sur la masse salariale. »
Conforama, détenu par le groupe sud-africain Steinhoff, avait annoncé le 2 juillet le lancement d’un plan de restructuration prévoyant la suppression de 1 900 postes (sur 9 000 environ actuellement), ainsi que la fermeture de 32 magasins de l’enseigne Conforama et celle de 10 magasins Maison Dépôt. Ce projet doit être détaillé jeudi au CCE du groupe d’ameublement et d’électroménager.
Interrogée par l’AFP, la direction a seulement souligné qu’« il n’y a qu’un seul plan », celui « annoncé le 2 juillet », pour permettre que « l’entreprise ne perde plus d’argent à horizon deux ans ». Par ailleurs, les syndicats ont été reçus mardi par le délégué interministériel aux restructurations, a-t-on appris auprès du ministère de l’économie.
« Toutes les organisations syndicales représentatives ont été reçues » mardi à Bercy, après la direction lundi, a déclaré M. Hammour. « On leur a exprimé notre colère et on leur a demandé d’avoir un regard très attentif sur la mise en place du plan social et des mesures d’accompagnement », a-t-il ajouté. Cette réunion « ne nous a pas rassurés sur le rôle de l’Etat », qui dit « n’avoir aucun levier pour faire pression sur des entreprises privées », a ajouté M. Boucherit.

C’est la première fois que La Poste, poursuivie pour prêt de main-d’œuvre illicite dans la livraison des colis, est condamnée pour cette infraction. L’opérateur public s’est vu infliger, le 8 juillet, par le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) une amende de 120 000 euros pour ce fait constitué à l’agence Coliposte d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Le procureur avait demandé la « peine maximale » de 150 000 euros. Cette infraction vise à empêcher une entreprise de recourir, uniquement par souci d’économies, à un sous-traitant plutôt qu’à des embauches ou à l’intérim.
L’affaire avait été déclenchée par l’enquête de l’inspection du travail après la mort accidentelle le 8 janvier 2013 de Seydou Bagaga, un livreur malien employé par un sous-traitant, DNC. Trois semaines plus tôt, l’homme, qui avait été recruté début décembre 2012, était tombé dans la Seine en tentant d’y récupérer un colis qu’il devait livrer sur une péniche à Boulogne-Billancourt.
L’enquête avait montré que M. Bagaga n’était pas déclaré, ni payé et n’avait pas de contrat de travail, ce que Coliposte ne pouvait ignorer. Son employeur DNC avait indiqué qu’il était « en formation » et qu’il devait être déclaré si cette période avait été concluante. Une disposition illégale « préférée » pourtant par La Poste, selon cet employeur. Ce que le responsable de l’agence avait démenti lors du procès le 12 mai.
Le patron de la société de sous-traitance, DNC, ainsi que le responsable de l’agence, poursuivis tous deux pour prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage, ont été condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis. Le premier étant en outre poursuivi pour travail dissimulé.
La Poste a réagi en indiquant qu’elle « va étudier cette décision (…) en vue d’un possible appel ». Et que l’« accident tragique » de M. Bagaga « n’est aucunement représentatif ni des conditions de travail des salariés des sous-traitants ni des conditions de recours aux entreprises sous-traitantes ».
Partie civile, aux côtés de la CGT et de l’UNSA, SUD-PTT s’est réjoui de cette condamnation qui « va crédibiliser ce que nous dénonçons depuis des années », indique Thierry Lagoutte, représentant du syndicat. Celui-ci a déposé une seconde plainte avec la CGT en octobre 2017 afin d’« étendre le périmètre du dossier à toutes les agences d’Ile-de-France », où la sous-traitance représenterait en moyenne 80 % de la livraison des colis, selon la CGT. La Poste se défend en avançant un taux de 20 % de sous-traitance sur la France entière.
L’enquête à Issy-les-Moulineaux avait montré que postiers et sous-traitants accomplissaient le même travail, triaient les colis côte à côte dans l’agence, que La Poste intervenait dans la gestion quotidienne des sous-traitants. Les livraisons les plus compliquées, c’est-à-dire chez les particuliers ou dans les entreprises, étaient destinées aux sous-traitants qui pouvaient avoir 100 ou 200 colis à distribuer dans la journée, contre une centaine pour les postiers qui, eux, amenaient les colis groupés dans les bureaux de poste ou les points relais.
Les sous-traitants travaillaient six jours sur sept, réalisant dans certains cas deux tournées par jour, « de 6 heures à 18 heures, mais seules 35 heures par semaine sont déclarées », indique Romain Ung, livreur détaché comme secrétaire départemental de SUD-PTT chez Coliposte Ile-de-France. « Il faut être sportif pour monter six étages par un escalier en bois à l’ancienne en portant jusqu’à 30 kg, souligne Nassim (prénom modifié), un salarié d’un sous-traitant à l’agence d’Issy-les-Moulineaux. Si le client est absent, il faut revenir le lendemain. Pour les postiers, c’est plus facile. » Une division sociale du travail, que cependant nie La Poste : « Tous les livreurs – postiers et sous-traitants sans distinction – distribuent les colis aux particuliers. »
La situation a-t-elle évolué depuis la mort de M. Bagaga ? Les réunions, qui étaient communes aux sous-traitants et aux postiers, ne le sont plus. « Depuis environ deux ans, chaque société de sous-traitance a un référent [chef d’équipe], qui est l’interlocuteur avec La Poste quand il y a un problème avec un de ses livreurs », précise Casimir Largent, secrétaire général de la CGT-La Poste à Paris. Cette mesure étant censée garantir la non-ingérence de La Poste dans la gestion quotidienne de l’activité du sous-traitant, un des éléments importants caractérisant le prêt de main-d’œuvre illicite. Et puis, « La Poste a mis un coup de peinture au sol pour délimiter une zone pour les sous-traitants et une pour les postiers, indique M. Lagoutte. Mais tout cela n’est qu’une opération de façade. Quand on discute avec les sous-traitants, on voit bien que rien n’a changé ».
La sous-traitance est restée majoritaire à Issy-les-Moulineaux, selon SUD et la CGT. « On est quarante-trois salariés sous-traitants pour dix postiers, actuellement », précise Nassim. En 2013, ils étaient respectivement vingt-sept et six.

La plus haute juridiction judiciaire examinait lundi la régularité du plafonnement des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif.
Article réservé aux abonnés
La Cour de cassation va-t-elle bientôt sonner le glas de la fronde qui s’étend parmi des conseils de prud’hommes ? Cette question a surplombé les débats qui ont eu lieu, lundi 8 juillet, au sein de la plus haute juridiction judiciaire. Celle-ci s’est, pour la première fois, penchée sur un sujet brûlant, à l’origine de tensions pour le gouvernement comme pour le monde patronal : la régularité – contestée – du plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif.
Introduite en septembre 2017 par les ordonnances réécrivant le code du travail, cette réforme emblématique du quinquennat d’Emmanuel Macron fait, depuis des mois, l’objet d’une offensive devant les tribunaux. A plusieurs reprises, le dispositif, qui se présente sous la forme d’un barème, a été écarté par des juges au motif qu’il serait « inconventionnel » – c’est-à-dire contraire à des engagements internationaux de la France. Mais d’autres décisions sont allées dans le sens rigoureusement inverse.
Désireux d’y voir plus clair dans ce maelström, les conseils de prud’hommes de Louviers (Eure) et de Toulouse ont, chacun de leur côté, demandé à la Cour de cassation son avis, sans attendre que celle-ci soit, elle-même, saisie sur le fond. Leur but était de parvenir à une « unification rapide de la jurisprudence, (…) dans un souci de bonne administration de la justice ». Une procédure très particulière, si particulière d’ailleurs qu’il faut parler de « séance » – et non pas d’audience – à propos des débats de lundi.
Les arguments développés à cette occasion ont été de très haute volée – parfois difficiles à suivre, même, pour le profane. Mais ils n’ont pas réservé de grande surprise. Dans le camp des opposants au barème Macron, il y avait des organisations syndicales, agissant en qualité d’« intervenant volontaire ». Leur hostilité au dispositif se fonde sur plusieurs textes, parmi lesquels la Charte sociale européenne et la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Toutes deux prévoient qu’une juridiction nationale doit être en mesure d’ordonner le versement d’une « réparation appropriée » à un salarié licencié sans motif réel et sérieux.
Or, le référentiel d’indemnisation inscrit dans les ordonnances Macron (avec des maxima oscillant entre un et vingt mois de salaire en fonction de l’ancienneté de la personne dans l’entreprise) ne remplit pas cette condition, aux yeux des avocats représentant les syndicats. Les sommes allouées peuvent s’avérer « dérisoires », en particulier pour les salariés ayant travaillé peu de temps dans la société qui les a congédiés, a estimé Me Hélène Didier, pour la CGT et Solidaires. Au fond, a-t-elle observé, le barème « sécurise l’employeur fautif » en lui permettant de connaître « à l’avance » le coût de la rupture du contrat du travail : ainsi triomphe la logique de la « violation efficace du droit ».

Les numéros un des organisations patronales et syndicales, hormis la CGT, prépareraient un plan commun pour faire face au gouvernement, à la rentrée, estime Michel Noblecourt, éditorialiste au « Monde ».
Article réservé aux abonnés
Analyse. Comme ils en ont pris l’habitude, les numéros un des organisations patronales et syndicales, à l’exception de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, se sont retrouvés, mardi 2 juillet, au Conseil économique, social et environnemental, pour un échange informel. « La réunion a été plus productive que d’habitude, selon un participant, parce que la situation sociale est tendue. » A la rentrée, ce clan des sept (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, MEDEF, CPME, U2P) pourrait bâtir un agenda social commun pour affirmer l’autonomie des partenaires sociaux par rapport à l’Etat. Pour l’heure, la pièce en cours pourrait s’appeler En attendant Godot. Emmanuel Macron a laissé dire, sans utiliser l’expression, qu’il pourrait opérer un virage social. Coup de bluff ? Quant aux syndicats, ils ne décolèrent pas depuis une réforme de l’assurance-chômage qui n’a fait que des mécontents. Et ils préviennent que si le chamboule-tout en préparation sur les retraites revient sur des droits acquis, ils emprunteront le sentier de la guerre. Coup de bluff ? M. Macron et les syndicats jouent au poker menteur.
Si le chamboule-tout en préparation sur les retraites revient sur des droits acquis, les syndicats emprunteront le sentier de la guerre
Le 11 juin, devant l’Organisation internationale du travail, à Genève, le chef de l’Etat a tenu des propos alarmistes, jugeant que la crise « peut conduire à la guerre et à la désagrégation de nos démocraties ». En même temps, il a célébré avec lyrisme la justice sociale, tendant la main à des syndicats jusqu’alors négligés, voire méprisés. « Je partage en totalité le discours du président sur les risques de conflit et la violence économique, déclare François Hommeril, président de la CFE-CGC, au Monde. Mon mandat est de désamorcer la violence sociale issue de la violence économique des marchés. » Mais les propos présidentiels, salués par (presque) tous les syndicats, n’ayant pas été suivis d’effet, à l’exception d’un… recul des droits sur l’assurance-chômage, et le virage social faisant figure d’Arlésienne, M. Hommeril, au diapason de ses homologues, parle de « crise de confiance ».
Les syndicats sont faibles. La crise des « gilets jaunes » a mis en lumière, par contraste, leur impuissance. Ils n’ont pas les moyens d’engager une épreuve de force avec M. Macron, et s’alarment de l’émergence d’actions radicalisées, qu’il s’agisse d’infirmiers urgentistes qui s’injectent de l’insuline ou de gardiens de prison en colère qui refusent de nourrir des détenus. Mais au niveau des négociations nationales, faute de grain à moudre, ils peinent à démontrer leur utilité.