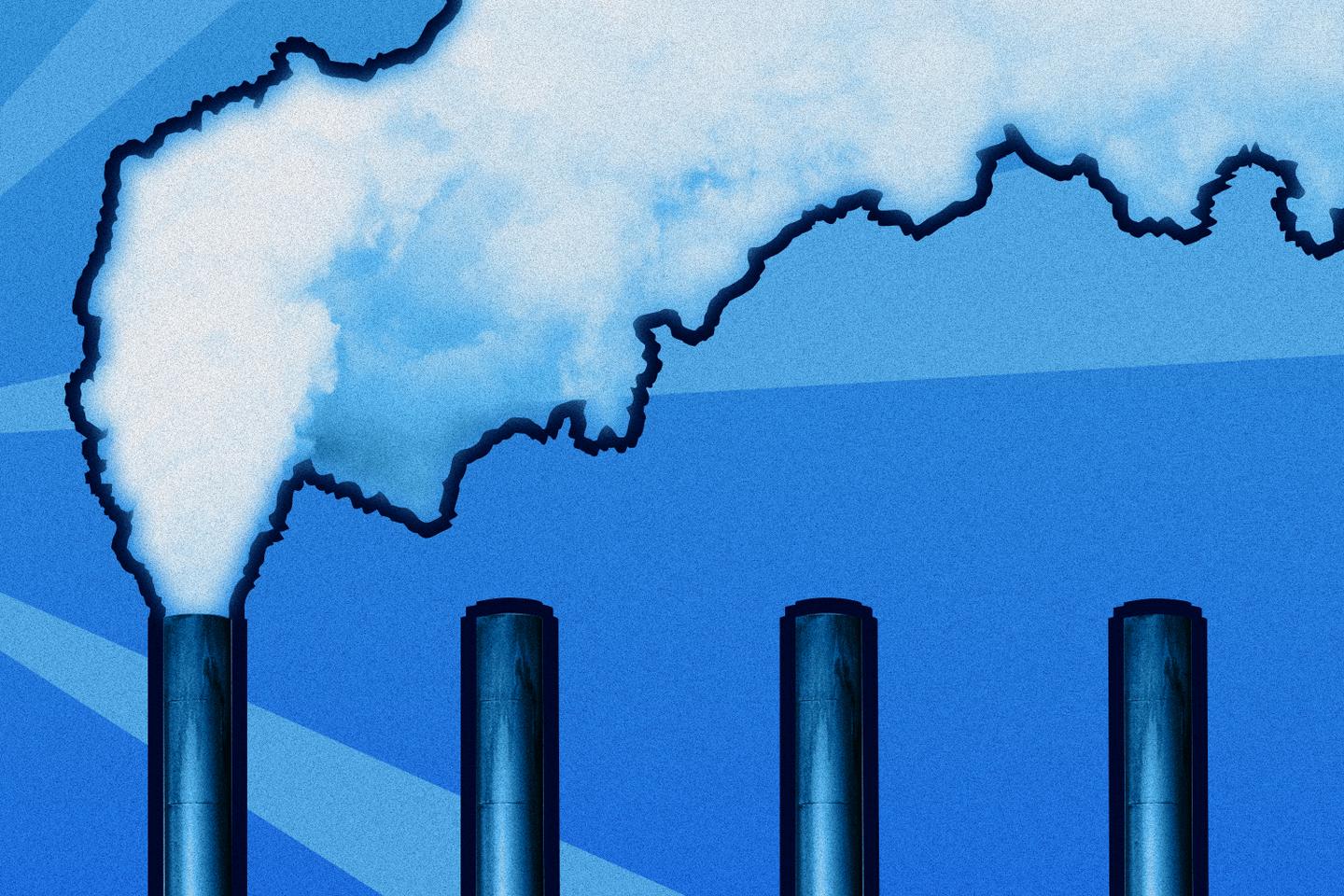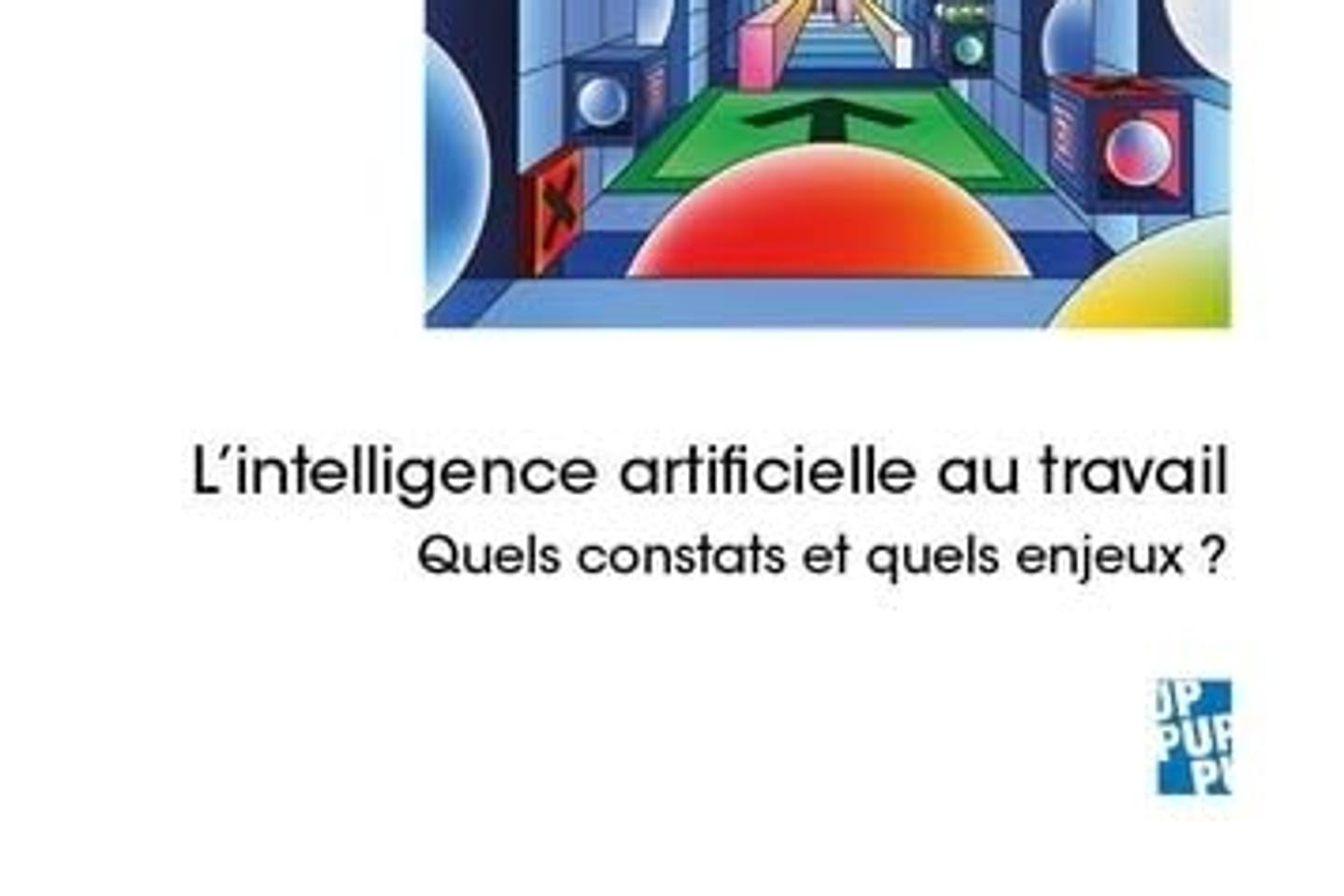Anthony Galluzzo, professeur en sciences de gestion : « Le patronat a des méthodes parfaitement rodées pour écraser une rébellion interne »
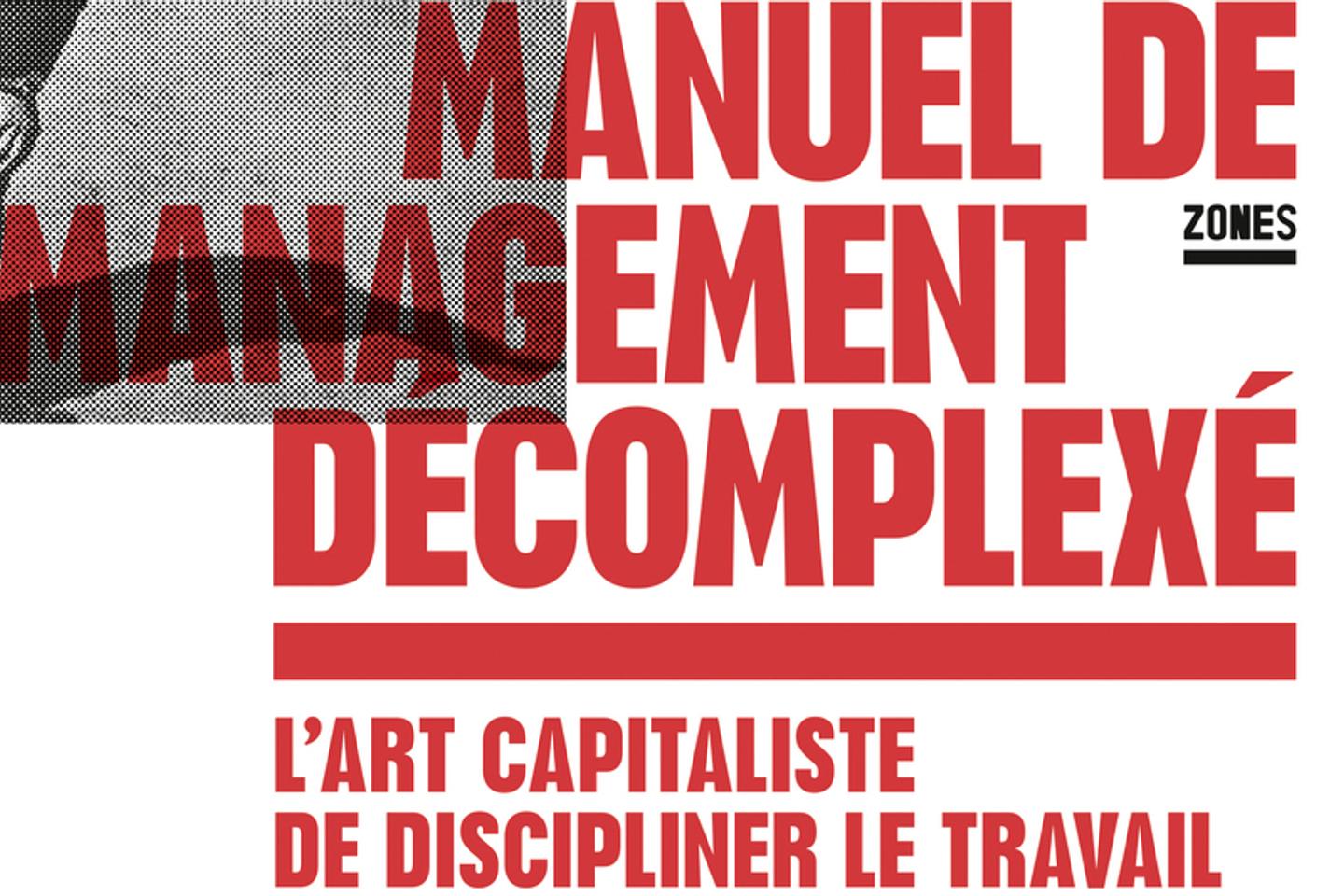
Anthony Galluzzo, professeur des universités en sciences de gestion à l’université de Saint-Etienne, estime que l’autonomie qui peut être accordée aux ouvriers est un leurre, le management cherchant ainsi à « emporter leur enthousiasme et à faire passer l’ordre imposé pour un ordre spontané ». Les travailleurs « consent[ent alors] à leur propre exploitation ».
Votre ouvrage souhaite prendre le contre-pied des manuels de management traditionnels. Que leur reprochez-vous ?
Ces manuels n’accordent pas une place centrale au travail, aux travailleurs ainsi qu’à la production. Ils égrènent bien souvent des platitudes sur le monde de l’entreprise, quand ils ne versent pas dans le développement personnel. En m’appuyant sur les observations des anthropologues du travail en usine, j’ai souhaité au contraire mettre en lumière les techniques et tactiques du management qui ont cours dans les industries à forte intensité de main-d’œuvre.
Des pratiques stratégiques pour les organisations qui doivent extraire de la valeur, mener leurs affaires et survivre face à la concurrence. J’ai mené cette démarche en prenant le point de vue du capital, le lecteur étant guidé tout au long de l’ouvrage par un consultant fictif qui prodigue ses conseils sans filtre à un destinataire patronal.
Vous montrez que le management, dans sa volonté de contrôle de la main-d’œuvre, dispose d’une grande variété de stratégies. L’une d’elles peut sembler à première vue paradoxale : la mise en autonomie des salariés. En quoi permet-elle de « discipliner le travail » ?
Cette stratégie consiste à mener un contrôle dit « hégémonique », à travers lequel les travailleurs consentent à leur propre exploitation. C’est intéressant pour les dirigeants : ils peuvent réduire leur niveau d’investissement dans l’appareil coercitif (contremaîtres à embaucher, dispositifs de surveillance à déployer…). Les ouvriers sont répartis en équipes de dix, vingt personnes, à qui l’on donne de l’autonomie. Ils reçoivent une mission, vont devoir s’organiser eux-mêmes pour atteindre les objectifs. Ils pourront élire un coordinateur, décider de la manière de réaliser le travail, des pauses qu’ils prendront…
Il vous reste 66.86% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.