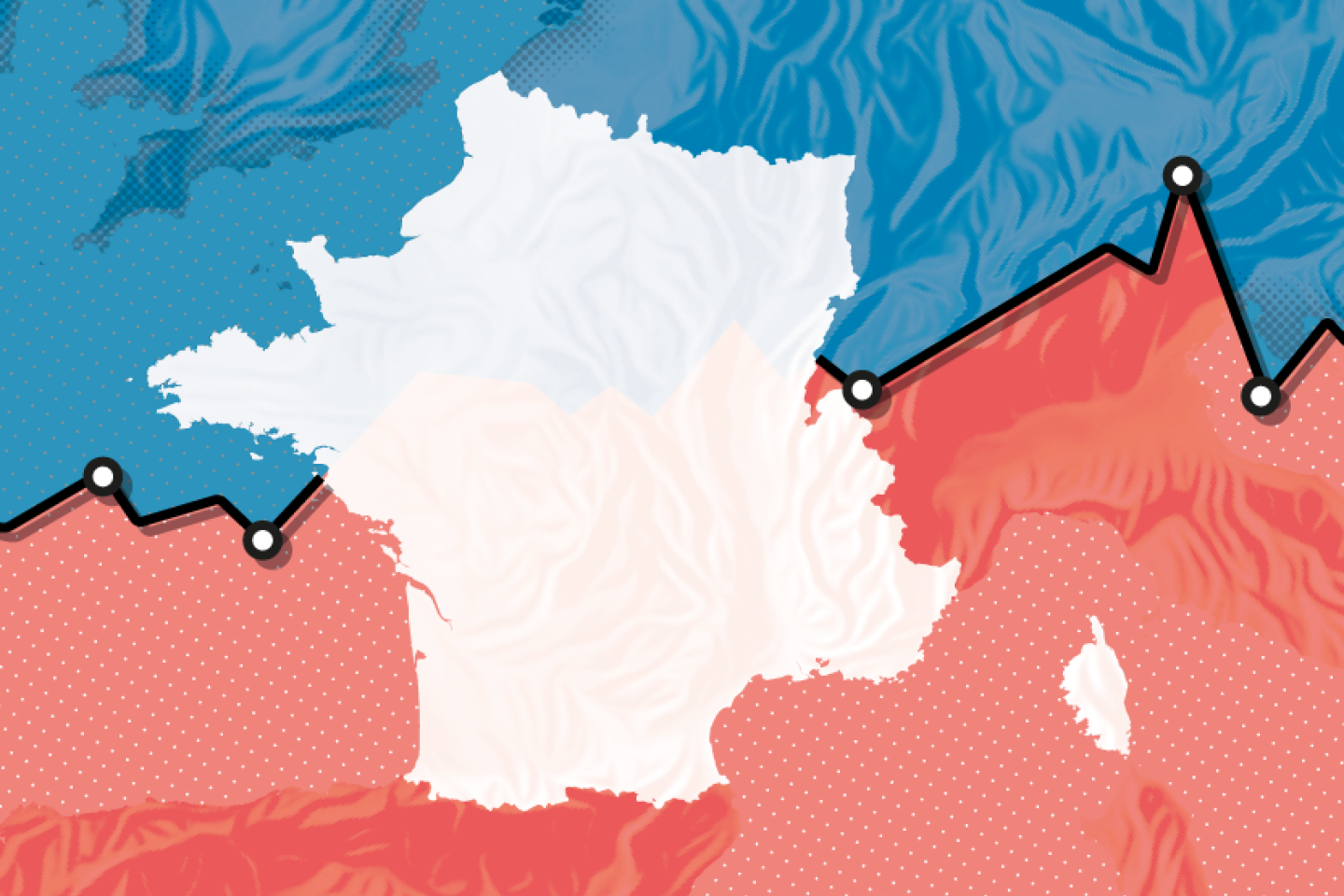Au travail, pour les cadres handicapés, mieux vaut cultiver un « mental d’acier »

Le bureau est plongé dans une demi-pénombre. Karma, chien guide d’aveugle, est assoupi aux pieds de son maître, Thomas Fauvel, 33 ans. Lunettes noires sur le nez, l’ingénieur télécoms d’Orange, non voyant à la suite d’une maladie dégénérative, pianote sur son ordinateur équipé d’un logiciel de reconnaissance de caractères et d’une synthèse vocale. Il est entré chez l’opérateur de télécommunications en 2014, dans le cadre de son master en alternance à l’université Paris-Saclay, qui lui a permis d’occuper un poste d’expert transverse réseaux mobiles. Dans la foulée, il a décroché un CDI en tant qu’architecte Internet des objets (IoT), puis, en 2021, un poste d’architecte solution IoT et convergence. « Les entreprises bataillent pour les profils en pointe sur le numérique et l’intelligence artificielle, et pourtant, il y a deux ans, quand j’ai voulu évoluer vers un nouveau poste, j’ai envoyé quarante candidatures en interne et en externe avant de décrocher mon job actuel », se souvient le trentenaire. Il poursuit : « Par comparaison, un de mes collègues, au profil similaire au mien – handicap excepté –, a envoyé une seule candidature à une boîte de high-tech, qui l’a recruté et a ajouté 20 000 euros de plus à sa rémunération annuelle ! » Thomas Fauvel en a conscience : pour satisfaire ses ambitions professionnelles, il va devoir cultiver un « mental d’acier » pour tenir bon face aux discriminations dans le monde du travail.
A l’instar du trentenaire, dans l’Hexagone, 110 000 cadres handicapés se battent au quotidien. Contre un cancer, de l’asthme, une sclérose en plaques, un handicap moteur, auditif ou psychique, etc. et contre les traitements inégalitaires. Cette catégorie socioprofessionnelle représente 10 % du total du 1,1 million de travailleurs en situation de handicap. « Soixante-sept pour cent de ces cadres ont un niveau d’études bac + 4 ou plus. Si leur niveau de satisfaction, une fois qu’ils sont en poste, est élevé, ils rencontrent néanmoins toujours de grandes difficultés pour être recrutés », regrette Véronique Bustreel, directrice de l’innovation, de l’évaluation et de la stratégie à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), en s’appuyant sur l’étude « Les cadres en situation de handicap », qu’elle a pilotée avec le cabinet de recrutement Michael Page, en novembre 2020.
Si le chômage des personnes handicapées cadres et non cadres est en baisse, il reste toujours nettement plus élevé que celui des personnes dites « valides » (12,5 % contre 7,5 %). Et le taux d’emploi direct de salariés handicapés dans les entreprises stagne à 3,5 %, en dépit de la loi de 1987, qui requiert 6 % dans les entreprises de plus de vingt salariés.
Il vous reste 71.93% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.