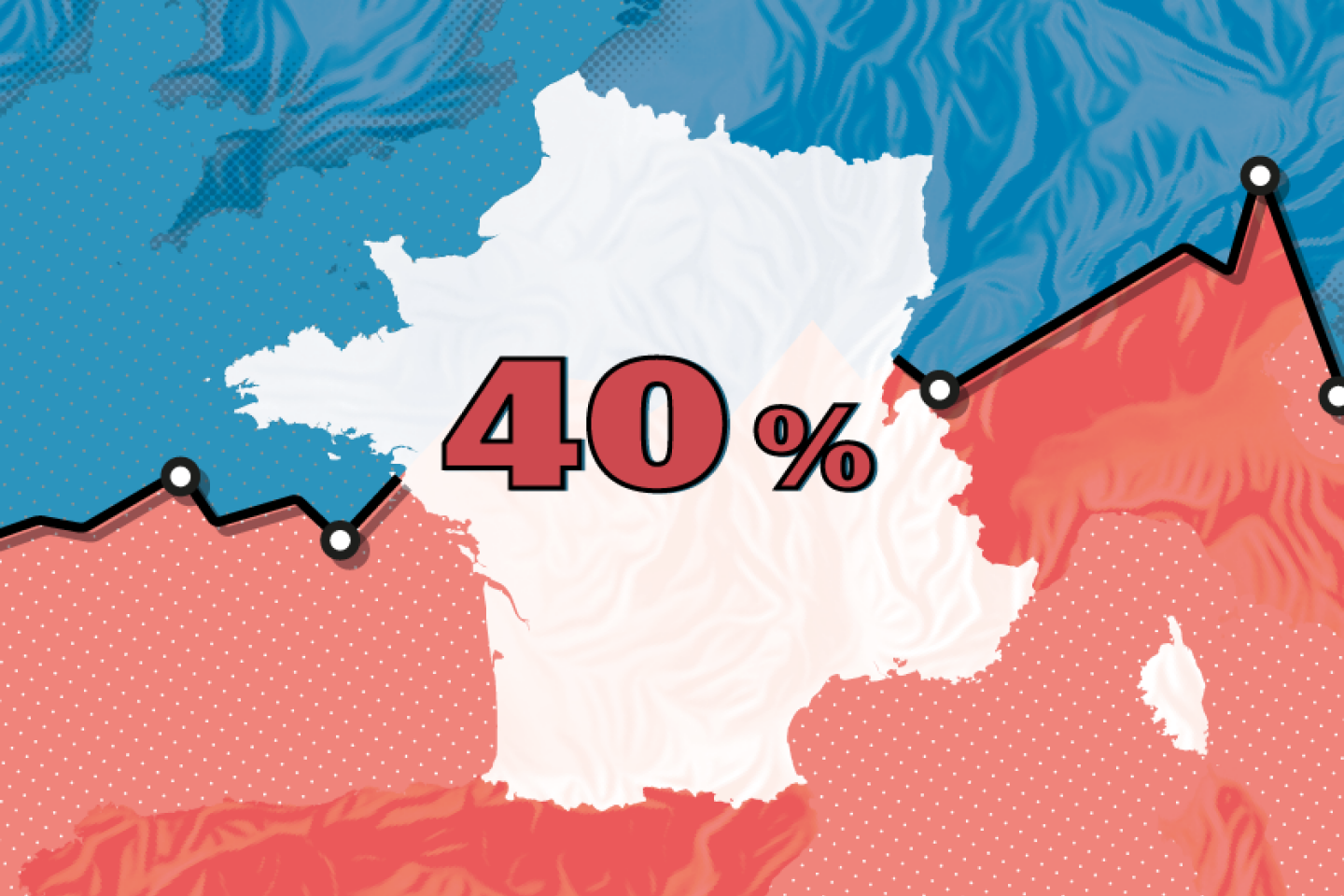Au Bangladesh, des ouvriers du textile érigent des barricades pour réclamer des salaires plus élevés

« Nous voulons un salaire décent. » Après plusieurs jours de manifestations au Bangladesh et des heurts qui ont causé la mort d’au moins deux personnes, des milliers d’ouvriers ont érigé des barricades sur des avenues de la capitale, Dacca, mercredi 1er novembre. Ils réclament des hausses de rémunérations aux usines de textile qui fournissent de grandes marques occidentales.
Selon la police, au moins 5 000 ouvriers du textile ont dressé des barrages routiers dans le quartier de Mirpur dans la capitale. Mais selon un correspondant de l’Agence France-Presse (AFP) sur place, le nombre de manifestants pourrait être nettement plus élevé.
Le commissaire adjoint de la police métropolitaine de Dacca, Omar Faruq, a déclaré qu’« aucune violence » n’avait été signalée mercredi. Cependant, environ 1 500 manifestants ont jeté des pierres sur plusieurs usines de la ville industrielle de Gazipur, a déclaré le chef régional de l’unité de police industrielle, Sarwar Alam. « Nous avons tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants », a-t-il expliqué.
Usines fournissant Gap, H&M ou encore Levi Strauss
Les ouvriers exigent un salaire mensuel minimum de 23 000 takas (190 euros), soit près de trois fois plus que les 8 300 takas (70 euros) actuels. Sabina B., une couturière de 22 ans, a dit s’être jointe aux manifestations, car elle est lasse de « lutter pour assurer la subsistance » de sa famille. « Comment pouvons-nous passer un mois avec à peine 8 300 takas quand nous devons déjà débourser de 5 000 à 6 000 takas juste pour le loyer d’une maison d’une pièce ? », interroge-t-elle.
Selon les syndicats, les conditions de salaires et de travail sont désastreuses pour une grande part des quatre millions de travailleurs du secteur. Le Bangladesh est l’un des plus grands exportateurs de vêtements au monde, avec une industrie textile forte de quelque 3 500 usines qui fournissent des marques occidentales comme Gap, H&M et Levi Strauss et représentent 85 % des 55 milliards de dollars d’exportations annuelles de ce pays d’Asie du Sud.
« Nous réclamons justice, nous voulons un salaire décent », a déclaré Nurul I., ouvrier du textile âgé de 25 ans, accusant les partisans du parti au pouvoir d’avoir attaqué les manifestants. La police n’a pas pu confirmer une telle attaque. Mais selon le journal Prothom Alo, citant des témoins oculaires, des militants du parti au pouvoir avaient fait usage d’armes à feu. « Les hommes du parti au pouvoir ont attaqué notre peuple hier », a déclaré l’ouvrier. « Les propriétaires [d’usine] ne veulent pas augmenter nos salaires. Devons-nous mourir de faim et d’injustice ? »
De grandes marques, dont Adidas, Hugo Boss, ou encore Puma, ont écrit au début du mois à la première ministre, Sheikh Hasina, ayant « remarqué » que les salaires nets mensuels moyens n’avaient « pas été ajustés depuis 2019 alors que l’inflation a considérablement augmenté au cours de cette période ».
Annonce d’augmentation, sans précision
Selon les syndicats, la colère des ouvriers a explosé quand la puissante association des fabricants a proposé une augmentation de 25 %, ignorant leurs revendications.
Le Monde Application
La Matinale du Monde
Chaque matin, retrouvez notre sélection de 20 articles à ne pas manquer
Télécharger l’application
Les manifestations ont commencé au début de la semaine dernière, mais la contestation a tourné à la violence lundi avec le débrayage de dizaines de milliers d’ouvriers à Gazipur où une usine de six étages a été incendiée, entraînant la mort d’un ouvrier. Au moins un deuxième ouvrier a été tué, mortellement blessé dans des heurts opposant la police aux manifestants et décédé alors qu’il était transporté à l’hôpital.
Le gouvernement de Mme Hasina a instauré cette année un comité chargé de fixer un nouveau salaire minimum. Mardi, Faruque Hassan, président de l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA), a promis qu’ils augmenteraient le salaire minimum à partir du mois prochain, mais sans préciser le montant de la hausse.
Ces manifestations ouvrières surviennent au moment où le Bangladesh est secoué par de violents rassemblements antigouvernementaux dans plusieurs villes, les partisans des partis d’opposition exigeant la démission de Sheikh Hasina avant les élections prévues à la fin de janvier. Deux militants de l’opposition ont péri dans des circonstances non éclaircies, selon les autorités de Kuliarchar, au nord de Dacca.