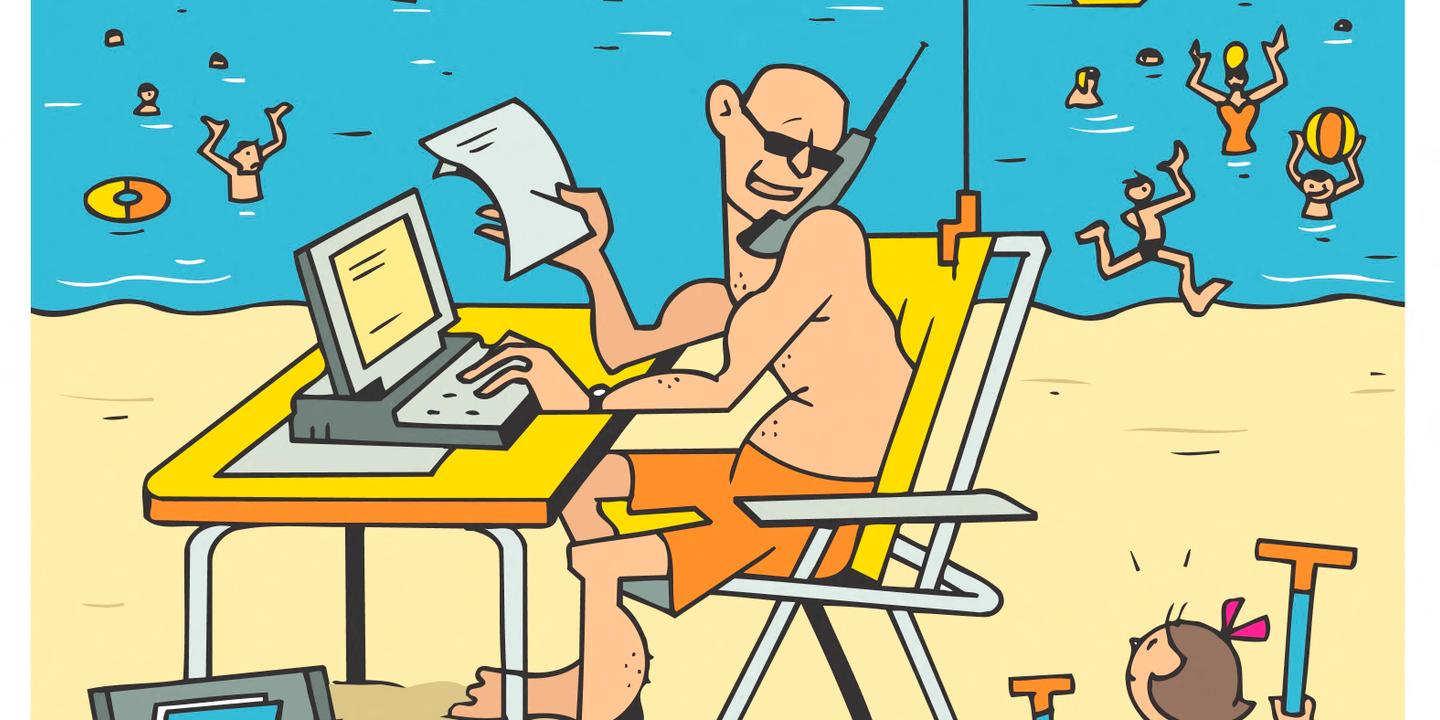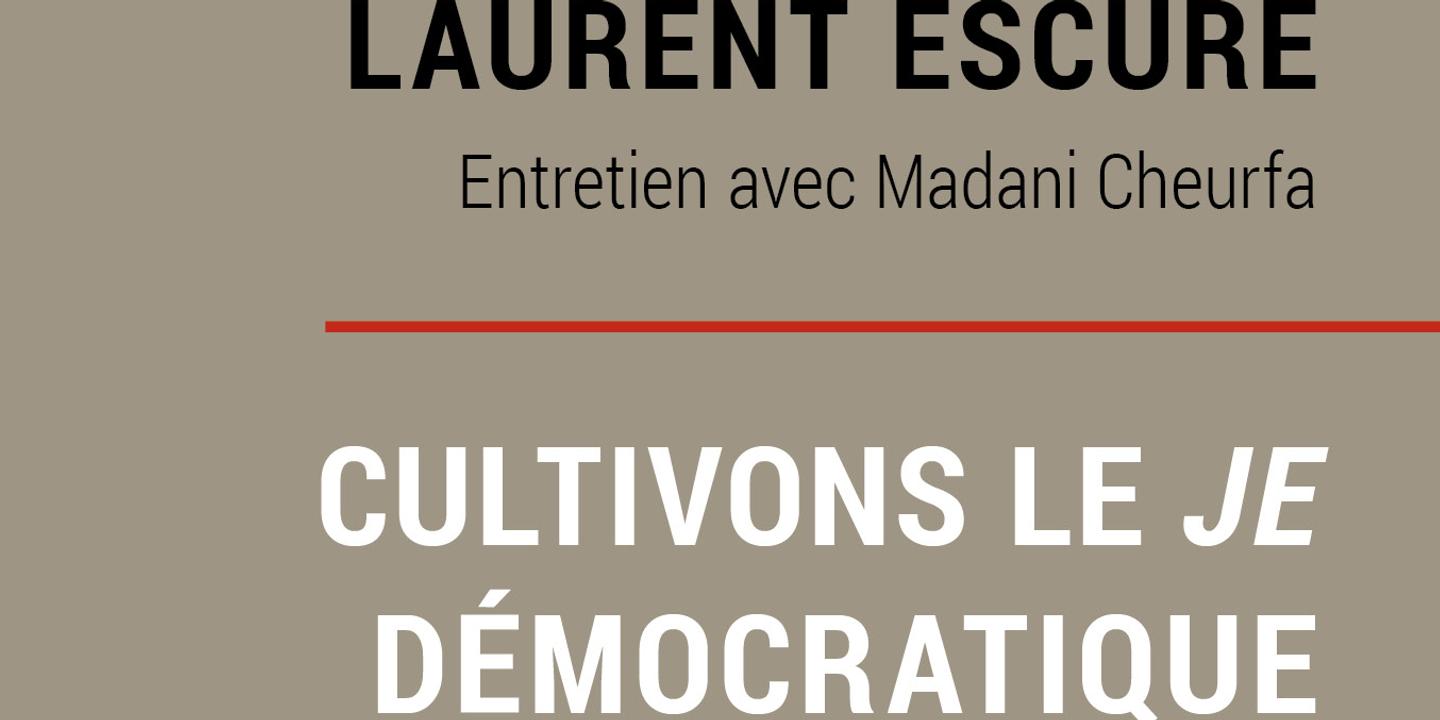Tiago Rodrigues : « Quand un artiste dirige le festival d’Avignon, il doit repenser sa façon de travailler »

Le nouveau directeur du Festival d’Avignon revient sur sa nomination et explique qu’il veut « créer des liens inattendus ».
Comment s’est décidée votre nomination ?
Au début de l’année, j’ai été contacté par l’Elysée et le ministère de la culture, qui m’ont demandé si je serais prêt à postuler. J’ai répondu positivement parce que j’ai une passion pour le festival. Par ailleurs, il est bon que le Teatro Nacional de Lisbonne, que je dirige depuis 2015, change de mains : il ne faut pas monopoliser les postes, surtout quand on a atteint quelques résultats. J’ai donc écrit un projet pour Avignon, en sachant que je faisais partie d’une longue liste de postulants. Au fil des mois, la liste a raccourci. J’ai rencontré la ministre de la culture, la maire d’Avignon et les membres du conseil d’administration du festival. Et j’ai été retenu parmi les finalistes.
Qu’est-ce qui vous passionne dans le Festival d’Avignon ?
Le mariage entre la mémoire et l’avenir. Avant d’y venir pour la première fois, en 2015, en tant qu’artiste et spectateur, je le connaissais bien sûr par mes études et mes lectures. En le vivant, j’ai été bouleversé : on est au centre de l’histoire du théâtre européen et mondial, qui a fait le mythe d’Avignon depuis sa fondation en 1947, et, en même temps, dans un laboratoire de l’inattendu, de l’innovation, des découvertes. Le public d’Avignon est unique au monde. C’est rare de sortir d’un théâtre et de voir ce que vivent les gens. Aux terrasses, dans les rues et les transports, partout, c’est encore le théâtre, et le débat sur le théâtre, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Cela a conforté la confiance en mon métier.
Allez-vous vous installer dans la ville ?
Ce n’est pas une obligation, mais je pense que c’est vraiment important que le directeur vive à Avignon toute l’année, qu’il appartienne à la ville, et qu’il consacre toute son énergie au service de l’utopie nécessaire que représente le festival. Je vais quitter la direction du Teatro Nacional – je suis en train d’en discuter avec le conseil d’administration et le gouvernement portugais. Dans quelques mois, je pourrai tout à fait me consacrer à ma prochaine fonction. Je vais travailler à la passation avec l’actuelle direction et faire mon apprentissage d’émigré, ce qui est tout nouveau pour moi. J’ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je n’ai jamais émigré. Je disais toujours que j’avais choisi de rester au Portugal, en en partant souvent, mais en y revenant. M’installer à Avignon, c’est émigrer, sans l’être vraiment : c’est aller habiter au pays du théâtre. Donc chez moi.
Il vous reste 33.94% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.