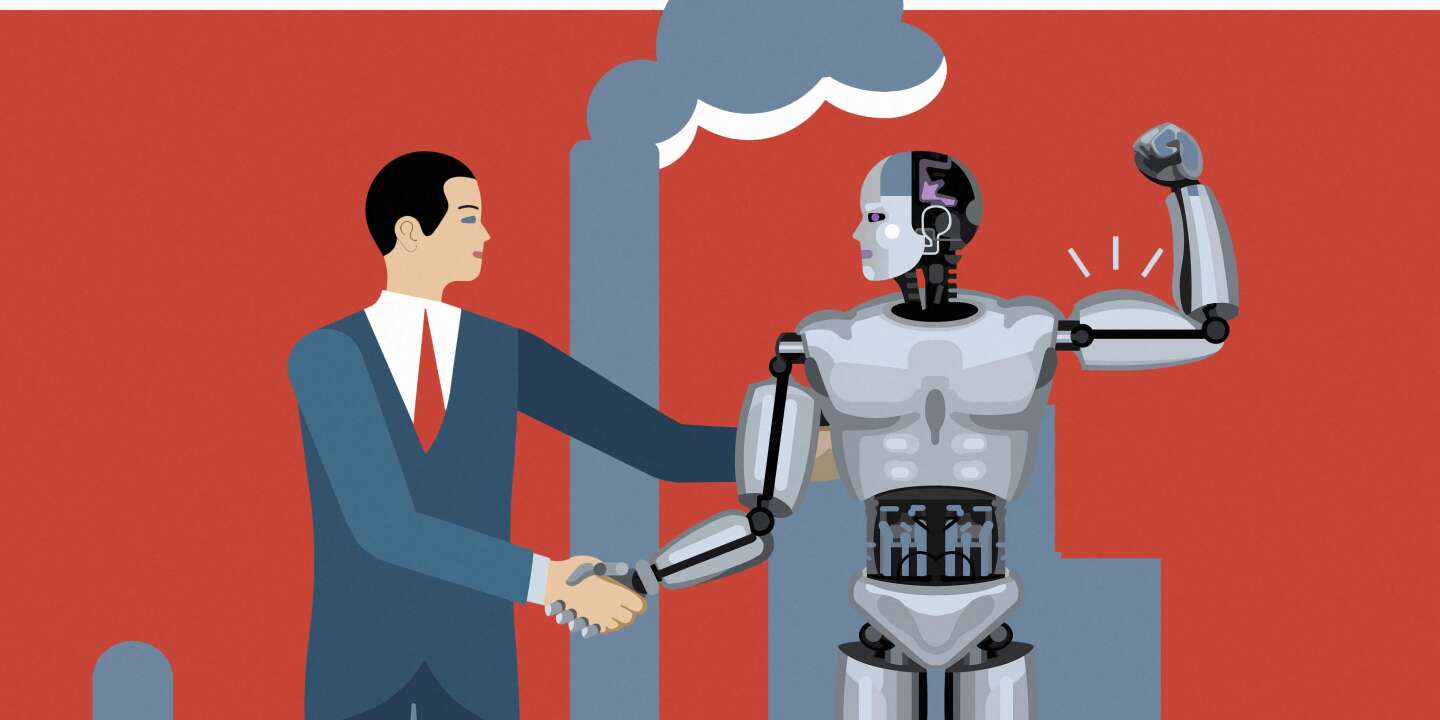Emmanuel Macron renonce à l’objectif de supprimer 50 000 postes d’agents de l’Etat

L’objectif de supprimer 50 000 postes dans la fonction publique d’Etat, promesse faite par Emmanuel Macron en 2017, est définitivement abandonnée. Lundi 5 juillet, dans un entretien accordé au site spécialisé Acteurs publics, le ministre délégué au budget, Olivier Dussopt, a indiqué que le nouvel objectif était « la stabilité de l’emploi de l’Etat » sur le quinquennat.
De fait, depuis la crise des « gilets jaunes », en 2018-2019, la volonté d’Emmanuel Macron de réduire le nombre de fonctionnaires dans les administrations d’Etat s’était déjà fortement émoussée. Olivier Dussopt l’a d’ailleurs rappelé : « Il y a eu des décisions qui ont été prises après le grand débat, en 2019, qui nous ont amenés à revoir ces objectifs. » Exemples : ne plus fermer d’écoles dans les campagnes sans l’accord du maire ou la mise en place du « plan BTS » qui représente « plusieurs centaines de postes ».
D’ailleurs, en juillet 2019, Gérald Darmanin, alors ministre de l’action et des comptes publics, avait confié que, sur les 50 000 postes promis, le quinquennat Macron n’en supprimerait sans doute que 15 000. La cible avait même encore été réduite ensuite. Car, a rappelé Olivier Dussopt, « après le grand débat, la crise [sanitaire] s’est abattue sur le pays. Et cela s’est traduit par des créations de postes parce qu’il fallait répondre ». Pôle emploi, les agences régionales de santé… « C’est plus de 500 postes créés dans les territoires », rappelle M. Dussopt. Les enseignants, « fragiles du point de vue de leur santé », qu’il a fallu remplacer parce qu’ils étaient à l’isolement, c’est encore « 1 500 emplois ». Bref, « toutes ces décisions, nous les assumons, cela fait partie de la réponse à la crise. Mais cela modifie l’objectif à l’échelle du quinquennat », a déclaré le ministre.
« Une bonne chose »
Deux limites, cependant : d’une part, stabilité ne signifie pas égalité de traitement. Si certains ministères gagnent des postes (armées, intérieur, justice), d’autres continueront à en perdre, comme le ministère de l’économie et des finances. D’autre part, la stabilité revendiquée par le gouvernement pourrait devenir création d’emplois à la fin du quinquennat. Car, outre les 50 000 postes dans la fonction publique d’Etat, Emmanuel Macron s’était également engagé à supprimer 70 000 postes dans les collectivités locales. Or, celles-ci ne l’entendent pas de cette oreille. Et cet objectif qui n’a jamais été officiellement abandonné a pourtant peu de chance d’être tenu. Bien au contraire. Alors que l’emploi local avait baissé du temps de François Hollande, il est fortement reparti à la hausse depuis l’élection d’ Emmanuel Macron : + 13 000 emplois en 2018 et + 16 500 en 2019.
Il vous reste 51.4% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.