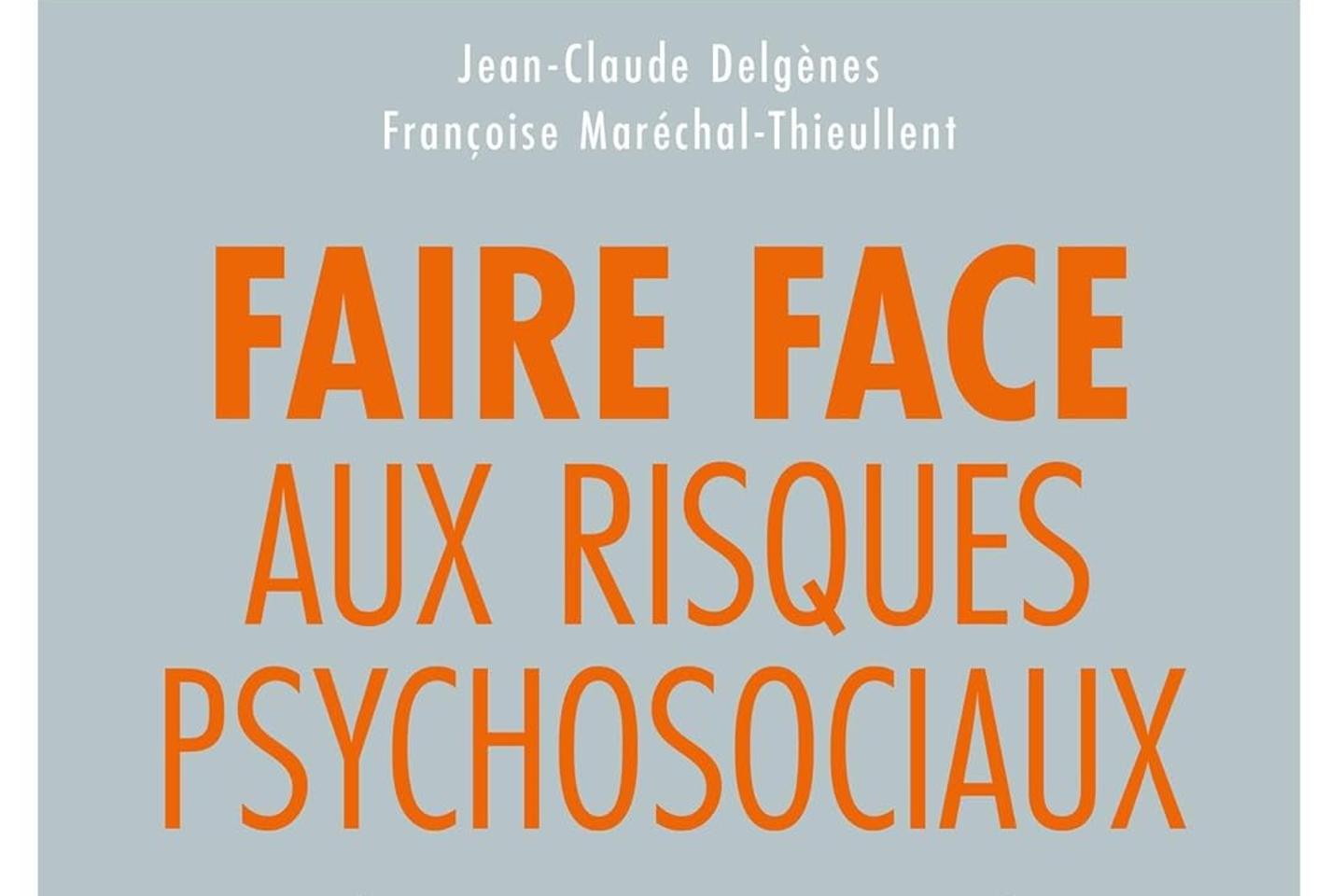« C’est un métier ! » : avec les outils numériques, les routiers ont perdu en autonomie

« Au début de ma carrière, quand je discutais avec des anciens, ils me faisaient rêver avec des récits de voyage, un peu façon aventuriers de la route, se souvient Eric, 53 ans et trente ans de métier, basé dans la Meuse. Aujourd’hui, notre boulot ressemble plus à un boulot comme les autres, avec des chefs et des objectifs à remplir. »
« Ce n’est plus le routier du passé, qui réglait seul ce qu’il pouvait faire, pouvait quitter l’autoroute pour se faire un bon restaurant. Maintenant il est pisté, ne peut pas s’arrêter où il souhaite, il y a beaucoup d’indicateurs chiffrés », résume Patrick Blaise, secrétaire général de l’Union fédérale route de la CFDT.
Depuis le début du XXIe siècle, le métier de routier a bien changé. D’abord pour des raisons d’évolution des marchés : l’ouverture à la concurrence du transport de marchandises transnational a redirigé les entreprises françaises vers des trajets plus courts, nationaux ou régionaux. Cela ne veut pas dire que les conducteurs travaillent moins longtemps : d’après l’Insee, entre 2021 et 2023, les routiers travaillent 44,3 heures en moyenne par semaine.
Chaque minute compte
Grâce au chronotachygraphe numérique, obligatoire depuis 2006, un appareil embarqué dans le camion qui enregistre l’état et la vitesse de celui-ci, ces temps de travail sont d’ailleurs mieux contrôlés. « Le chronotachygraphe change le mythe d’un chauffeur maître du temps, car il impose un temps de travail maximal précis, explique le sociologue Anatole Lamy, auteur d’une thèse sur le sujet, qui a abouti à la publication en novembre 2025 d’un article dans la revue Connaissance de l’emploi du Centre d’études de l’emploi et du travail du CNAM. Mais comme les employeurs essaient d’optimiser leurs itinéraires pour qu’ils se rapprochent du temps maximum, les routiers doivent juguler leur temps de conduite pour bien rester dans les clous. »
Avec l’optimisation des trajets par le management, chaque minute compte. « Lorsqu’on fait attendre un conducteur lors d’un chargement ou déchargement de marchandises, c’est beaucoup de stress car c’est du temps qu’il doit rattraper derrière », explique Patrick Blaise.
Il vous reste 47.16% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.