L’argot de bureau : les « KPI », à consommer avec mesure
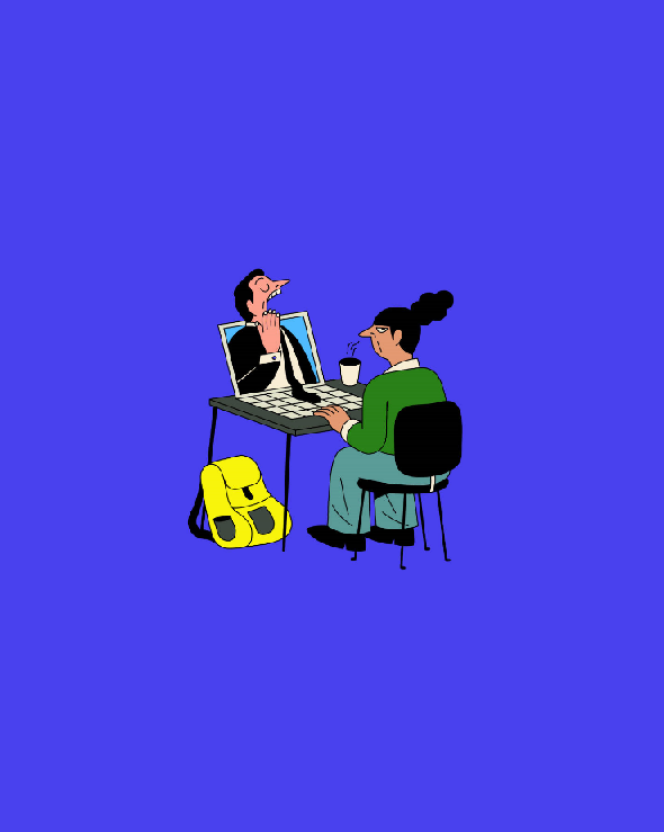
« Qui dit reporting dit rewarding », pourrait énoncer très caricaturalement un spécialiste du marketing digital un brin agaçant. Comprendre : si les salariés nous remontent les bons chiffres conformément aux objectifs, ils seront récompensés sur leur fiche de paie.
C’est le drame qui est arrivé à la banque américaine Wells Fargo, lorsqu’elle a défini au début des années 2010 des objectifs irréalistes d’ouvertures de comptes et de ventes de produits (une vingtaine par jour !) pour ses commerciaux.
Résultat ? Des millions de comptes ont été ouverts frauduleusement par les salariés jusqu’en 2016, sans l’accord des clients. Malin. Sauf que cette course à l’échalote a fini par se constater. L’entreprise a préféré licencier 5 300 « fraudeurs », et perdre quelques milliards de dollars, plutôt que de remettre en question la méthode : la faute était sans doute à de mauvais KPI (prononcer képi-aïe).
Robots exécutants
Les KPI – key performance indicators, ou indicateurs-clés de performance – sont un serpent de mer du management. A la base, un indicateur se veut très concret : c’est un chiffre-clé qui permet d’évaluer la performance d’une entreprise, au regard de ses objectifs. Par exemple, le coût par unité produite dans une usine, ou le taux de clics sur un mail. On le retrouve sur des tableaux de bord prospectifs, il y a des paliers à atteindre, et au gré des performances, il doit aiguiller les décisions en conséquence.
Malheureusement, les KPI se sont multipliés avec le temps, et concernent plus ou moins tout ce qui a un lien avec la productivité. Performance technique ? On mesurera le nombre de dossiers traités chaque jour par un salarié. Performance sociale ? Le taux de satisfaction des clients. Performance interne ? Le taux de collègues qui vous trouvent sympathique et bienveillant. Performance physique ? Le temps que vous êtes capable de passer à votre bureau sans vous rendre aux toilettes, ou sans prendre de pause. Performance mentale ? La part de salariés qui s’estiment « en détresse psychologique » devant leur manageur… Celui-là même qui leur a communiqué toutes ces mesures à avoir en tête.
A force, la to do list (liste de choses à faire, dans le jargon) s’allonge, et les travailleurs ne peuvent plus composer avec tous ces KPI, à moins de poser leur cerveau et de se transformer en robots exécutants. Au risque de disjoncter quand les objectifs sont inatteignables.
Parfois, ils sont même incompatibles : c’est le cas dans les métiers recevant du public, qui doivent à la fois satisfaire des clients exigeants, aux demandes individualisées, et remplir des quotas fixés par l’organisation. Pour reprendre l’expression des ergonomes Corinne Gaudart et Serge Volkoff dans leur ouvrage Le Travail pressé. Pour une écologie des temps du travail (Les Petits Matins, 2022), ils doivent « se dépêcher tout en prenant leur temps ».
Il vous reste 31.31% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.








