Le problème délicat du temps de travail des fonctionnaires d’Etat s’exhorte dans le débat

Un exposé déclare que les agents œuvrent en moyenne plus qu’avant mais qu’un tiers d’entre eux sont en dessous de la durée légale. Une condition « qui n’a pas de raison de perdurer ».
En moyenne, les employés d’Etat travaillent plus qu’avant et au-delà de la durée légale, mais un tiers d’entre eux font moins. C’est ce qu’indique un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) remis à Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, et publié par Le Figaro le 26 mars. L’IGF, qui s’est intéressé aux « régimes dérogatoires aux 35 heures dans la fonction publique », a relevé « plusieurs cas d’incohérence et de régimes dépourvus de justifications ». Elle considère donc que, « sauf cas exceptionnels, les situations actuelles n’ont pas de raisons de perdurer et impliquent qu’il y soit mis fin ». Cela permettrait, estiment les inspecteurs, d’économiser 30 000 postes. Le gouvernement s’est engagé à supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires d’ici à 2022, dont 50 000 dans les administrations d’Etat.
Cette question très délicate du temps de travail des fonctionnaires est approchée par le projet de loi sur la fonction publique, qui est exposé mercredi 27 mars en conseil des ministres par Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat de M. Darmanin. Mais, étrangement, les dispositions qui y sont renfermées concernent la fonction publique territoriale, non celle d’Etat. Le texte de M. Dussopt prédit un accompagnement de la durée du travail dans les collectivités locales en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale.
« Jours ministres »
De fait, l’IGF admet que la durée œuvrée par les agents d’Etat à temps complet s’établit à 1 712 heures, soit plus que ce qu’exige la loi – 1 607 heures par an. Cette estimation, qui porte sur la période 2013-2017, est supérieure à la précédente (2013-2014) : 1 627 heures. Les enseignants ne sont pas assimilés dans ces statistiques, mais la dernière étude officielle, datant de 2010, chiffrait à plus de 41 heures par semaine leur temps de travail effectif.
Par contre, les inspecteurs pointent le fait qu’un tiers des fonctionnaires d’Etat œuvrent moins que la durée légale. Cela indique 310 000 agents sur l’échantillon de 1,1 million d’agents (hors enseignants, militaires ou magistrats) retenu par l’IGF.
Une bonne part d’entre eux (190 000) ne font que 1 555 heures parce qu’ils jouissent de dispositifs historiques, « dont les justifications sont faibles voire inexistantes » pour 30 000 d’entre eux, tancent les inspecteurs. L’IGF évoque, par exemple, les 150 000 personnels administratifs et techniques qui travaillent dans l’enseignement. Comme les professeurs, ils profitent des vacances scolaires, mais à la différence près qu’ils n’ont ni préparation de cours ni corrections de copies à faire lorsqu’ils rentrent à la maison. L’IGF cite aussi les « jours de fractionnement », dispositif permettant aux fonctionnaires qui prennent leurs congés en hiver d’avoir des vacances supplémentaires. Or, avec les 35 heures, le mécanisme a atteint ses « limites », considèrent les inspecteurs qui proposent de le supprimer. Ils pointent pareillement les jours accordés arbitrairement dans certains ministères, comme à l’intérieur ou la culture, appelés « jours ministres ».
Conditions pénibles
Une autre partie (120 000) bénéficient de révisions horaires liées à leur fonction. Eux ne réalisent en moyenne que 1 538 heures par an. C’est le cas des fonctionnaires qui œuvrent la nuit ou dans des conditions difficiles ou dangereuses, comme les inspecteurs vétérinaires qui forment dans les abattoirs. Cela intéresse aussi des agents qui ont des contraintes spécifiques, comme les policiers, les CRS ou les surveillants de prison. L’IGF dénonce cependant au passage l’incohérence des régimes utilisés aux fonctionnaires en uniforme : les « personnels actifs de la police nationale » travaillent 1 523 heures, les militaires de la gendarmerie nationale 1 706 heures, sans que l’IGF en ait manifestement compris la justification.
Dans quelques cas, les rétractations sont compréhensibles. Dans d’autres cas, beaucoup moins, développent les inspecteurs : ils invoquent ainsi les personnels chargés de délivrer des titres dans les préfectures et les sous-préfectures. Eux n’œuvrent que 1 572 heures, et l’IGF rappelle que « l’impact de la dématérialisation des procédures recrutée au sein du ministère de l’intérieur se traduit par une diminution de fréquentation ».




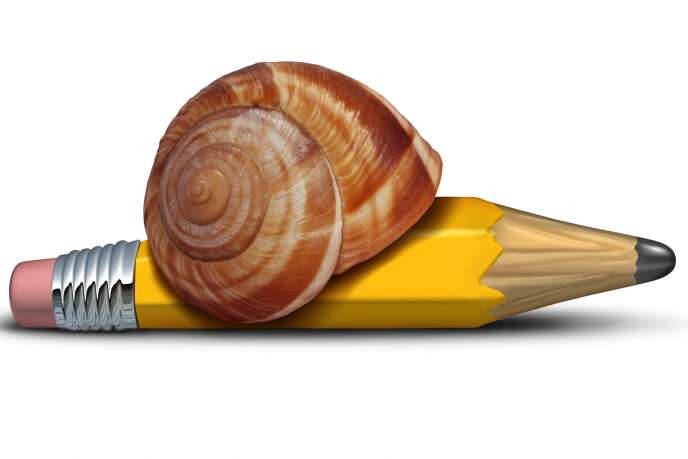
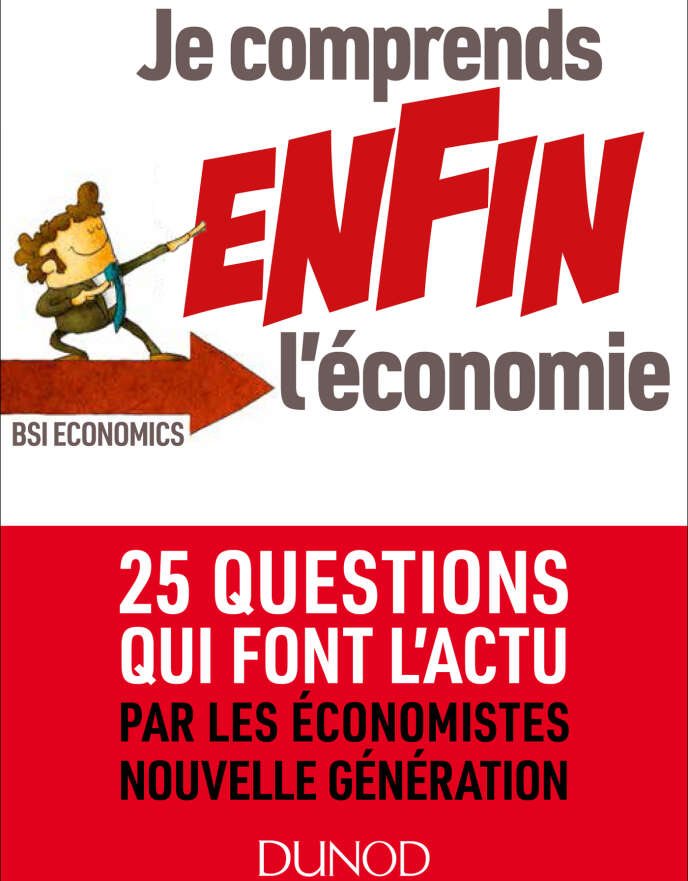



Le tribunal de grande instance de Strasbourg a agréé, mercredi 27 mars, un nouveau sursis à l’aciérie Ascoval à Saint-Saulve après trois récentes offres de reprise et deux marques d’intérêt dans ce dossier aux multiples effets.
Un mois après la cession du groupe franco-belge Altifort, qui a fait l’effet d’une douche froide, les 281 salariés du site étaient suspendus à cette nouvelle solution de justice, dans ce feuilleton évolué un marqueur de la politique industrielle du mandat Macron.
Lundi, trois offres de reprise et deux marques d’intérêt ont été placées auprès des organes chargés de l’action, encore assorties à ce stade de conditions suspensives. Deux d’entre elles sont jugées spécialement crédibles : celles du sidérurgiste britannique British Steel et du spécialiste italien des aciers spéciaux Calvi Networks, qui envisagent la reprise totale de l’activité et du personnel. L’usine est maintenant en sous-activité, depuis vendredi et jusqu’au 15 avril, toutes les commandes ayant été honorées.
Ces projets « sont cohérents, il va actuellement falloir qu’ils soient présentés au tribunal de façon complète, autant en termes commercial, industriel que financier », assure à l’Agence France-Presse (AFP) Nacim Bardi, délégué syndical CGT, qui définit que le personnel doit rencontrer prochainement ces repreneurs potentiels.
Ascoval : Plus qu’une aciérie, une « famille de sang et de cœur »
Des « gens très sérieux »
Une troisième offre, placée par le fonds SecuFund Industry et portée par l’ancien patron d’Ascometal Frank Supplisson, prévoit une reprise partielle des salariés et un changement de l’activité. Les marques d’intérêt ont été énoncées par des lettres d’intention de l’industriel régional Pascal Cochez et d’un groupe hollandais souhaitant disposer de plus de temps pour étudier le dossier.
Lundi, la secrétaire d’Etat à l’économie, Agnès Pannier-Runacher, s’est ravie de voir des « gens très sérieux » porter ces projets de reprise, « un beau signal pour les salariés et les familles qui sont derrière ». « Mais ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué ! », a-t-elle prévenu.
L’usine de Saint-Saulve, devenue Ascoval en 2017, attend un repreneur depuis la vente judiciaire, en février 2018, du groupe Asco Industries, auquel le métallurgiste Vallourec avait cédé 60 % de l’usine, tout en conservant 40 % des engagements de commandes. A la mi-décembre, le tribunal de Strasbourg avait mis fin à un long suspense en validant la reprise de l’usine par Altifort. Mais, à la surprise générale, le projet a échoué en février, le groupe franco-belge n’ayant pas réussi à réunir les 35 millions d’euros qu’il s’était escompté à apporter. Le tribunal de Strasbourg avait alors agréé un nouveau sursis d’un mois à l’aciérie, qui vient d’être renouvelé, mercredi 27 mars. Tout en saluant « l’attitude très responsable du personnel de l’aciérie », Bercy garantit :
« L’intérêt porté à l’usine d’Ascoval, quelques semaines seulement après l’échec du projet d’Altifort, réaffirme la qualité et l’intérêt de cette usine. »
« L’ambiance était lourde » ces ultimes semaines mais « ce qui est encourageant, c’est que notre dossier intéresse les industriels. C’est un nouvel espoir », affirme un salarié proche de la direction à l’AFP. « Les salariés sont fatigués. On est tous à bout », communique pour sa part Nicolas Lethellier, délégué CGT. « On a envie que ça se termine, cette condition dure depuis trop longtemps. »