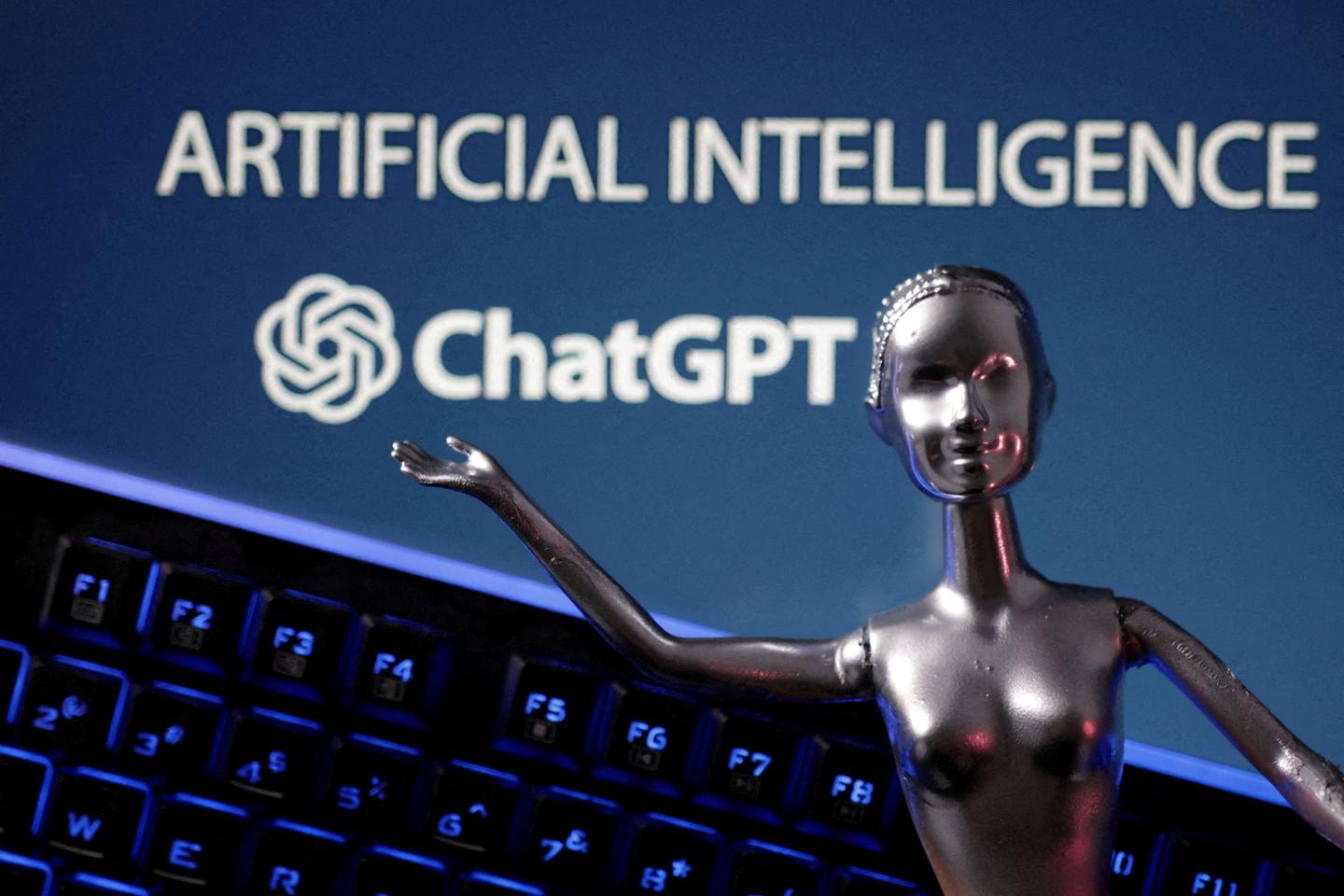Retraite progressive : comment fonctionne désormais ce dispositif méconnu

Travailler à temps partiel, tout en touchant déjà une partie de ses pensions, même si l’on n’a pas encore l’âge de la retraite : une possibilité offerte par le dispositif, méconnu, de la retraite progressive.
Aujourd’hui peu utilisé, ce dernier devrait concerner davantage de seniors dans les années à venir, à mesure que l’âge légal de la retraite reculera, de 62 ans à 64 ans, mais aussi parce que la réforme des retraites a étendu ce droit à de nouvelles catégories d’actifs, dont les fonctionnaires. Avant de se lancer, mieux vaut toutefois maîtriser les subtilités du dispositif.
Puis-je prendre ma retraite progressive si je suis déjà à temps partiel ?
Oui, les personnes travaillant déjà à temps partiel sont éligibles à la retraite progressive, nul besoin pour elles de réduire davantage leur temps de travail, si elles sont déjà à 40 %, la quotité de travail minimale pour accéder au dispositif (quotité maximale : 80 %).
« Beaucoup, souvent des femmes, travaillent à 80 % depuis des années et ne savent pas qu’ils pourraient toucher une partie de leur pension en plus de leur salaire à temps partiel, sans même dans ce cas demander l’accord de leur employeur », note Françoise Kleinbauer, qui dirige le cabinet de conseil France Retraite.
Peut-on prendre une retraite progressive si l’on a déjà l’âge de la retraite ?
Si la retraite progressive est possible dès deux ans avant l’âge légal de la retraite (donc entre 60 ans et 62 ans, selon les générations), rien n’empêche de la déclencher si l’on a déjà cet âge légal. Une option intéressante si vous souhaitez continuer à travailler quelques trimestres ou années pour obtenir le quota de trimestres requis pour votre génération, et accéder ainsi à la retraite à taux plein, tout en levant le pied en fin de carrière.
Rappelons, en effet, que même à temps partiel on valide généralement ses quatre trimestres sur une année civile – les quatre trimestres étant obtenus dès lors qu’on gagne, en 2023, au minimum 6 762 euros brut dans l’année, peu importe le nombre de jours ou de mois travaillés.
De même, la retraite progressive ne s’arrête pas forcément à l’âge légal de la retraite, dans le cas général. « On ne s’engage pas sur une date de départ, c’est vous qui décidez ensuite quand vous partez vraiment à la retraite, sauf si vous avez pris votre retraite progressive dans le cadre d’un accord d’entreprise qui fixe votre date de départ », complète Mme Kleinbauer.
Les cadres peuvent-ils en profiter ?
Oui, depuis le 1er janvier 2022, les salariés en forfait jours (rémunérés sur la base d’un nombre de jours travaillés par an, sans décompte en heures du temps de travail), essentiellement des cadres, peuvent prendre une retraite progressive. Leur exclusion du dispositif avait été jugée contraire à la Constitution en 2021. « Si vous êtes au forfait jours, vous devez travailler 87 à 174 jours pour la durée maximale de 218 jours », détaille l’Assurance-retraite.
Il vous reste 50.26% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.