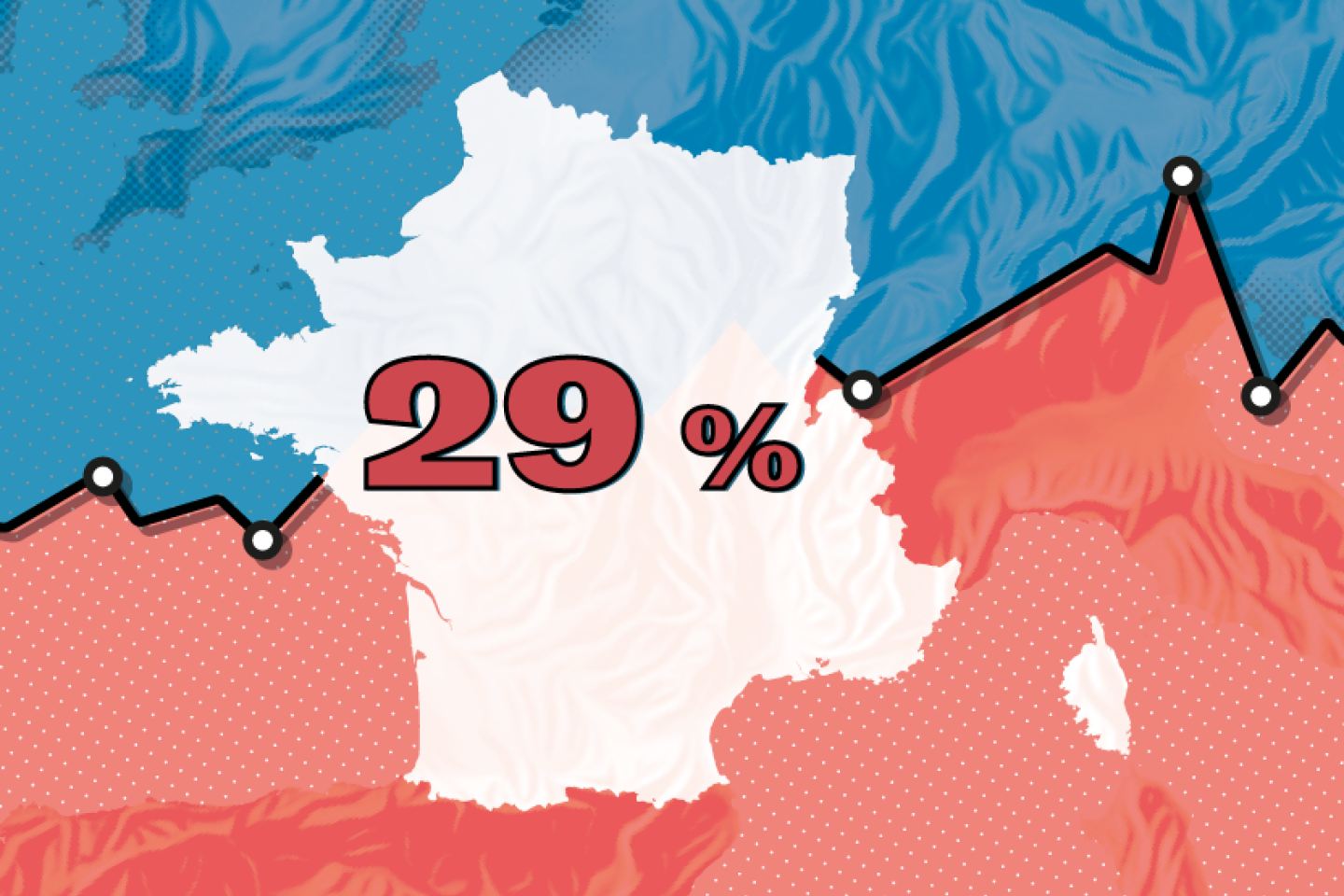Discriminations à l’embauche : des leçons ont été tirées du fichage « racial » par Adecco

Carnet de bureau. Un procès emblématique doit s’ouvrir jeudi 28 septembre devant la 31e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. La mise en cause du groupe d’intérim Adecco pour délit de discrimination à l’embauche et de fichage « en raison de l’origine, de la nationalité ou de l’ethnie » de cinq cents intérimaires entre 1997 et 2001 symbolise la difficile lutte contre les discriminations. « Il a fallu attendre vingt-deux années pour qu’enfin la société soit jugée de ces chefs d’inculpation », souligne Samuel Thomas, le président de la Maison des potes, qui a porté l’affaire devant la justice dès 2001 au nom de SOS-Racisme, dont il était alors vice-président.
Mais où sont aujourd’hui les cinq cents victimes de ce système de fichage « racial » (226-19 du code pénal) basé sur les codes BBR (bleu, blanc, rouge) et PR4 (pour les personnes de couleur), qui écartait de certains postes des candidats noirs ou originaires de banlieue ?
Sauront-elles que leur situation va être traitée par la justice ? « Sur les cinq cents personnes, 99 % ont changé de numéro de téléphone et sur les soixante-quinze adresses postales des victimes que nous avons contactées, soixante-dix enveloppes nous sont revenues avec la mention “inconnu à l’adresse indiquée”. Plusieurs sont décédées », reconnaît Samuel Thomas. Sur les cinq cents personnes, une vingtaine seulement s’étaient portées partie civile avant l’audience du 28 septembre.
Si ce procès est en soi « une victoire » après plus de vingt ans de bataille judiciaire, le bilan pour les victimes est maigre : la réparation du préjudice subi pourrait ne bénéficier qu’à une minorité d’entre elles, et il n’est pas prévu que les clients donneurs d’ordre soient poursuivis. Or, les salariés d’Adecco répercutaient les ordres de leurs entreprises clientes.
« Des progrès visibles »
La lutte n’est pas vaine pour autant. Si la discrimination à l’embauche reste une réalité en 2023, des leçons ont été tirées. « Les deux collaborateurs nommément mis en cause ne sont plus dans l’entreprise et, depuis 2001, on a un département spécifique qui forme tous les nouveaux collaborateurs. On fait également deux vagues de testing par an pour contrôler les pratiques réelles des recruteurs », explique un porte-parole d’Adecco.
Depuis le début des années 2000, de nombreuses organisations ont ainsi lancé des politiques pour se protéger des risques discriminatoires. L’Association française des managers de la diversité, créée en 2007 notamment pour renforcer la prévention en milieu professionnel, et ISM Corum, une autre association spécialisée dans le même domaine, viennent de publier à la mi-septembre un bilan des actions menées par les entreprises, dont il ressort que les discriminations ethnoraciales sont devenues une préoccupation majeure en matière de recrutement.
Il vous reste 19.6% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.