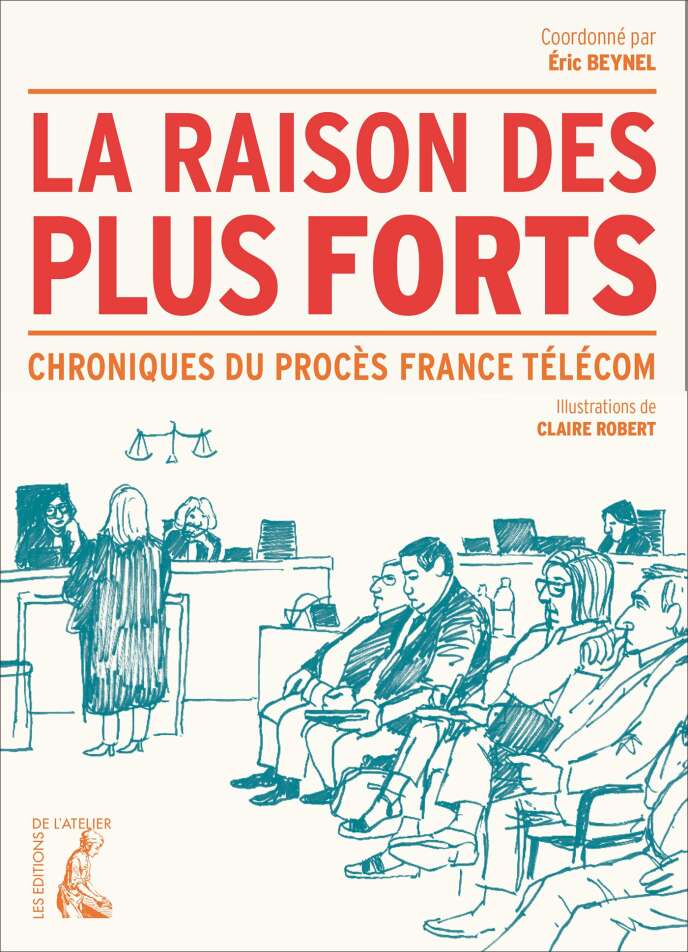Une étude réaffirme des liens inquiétants entre chômage et suicide

« Le lien entre travail et suicide résonne particulièrement dans l’actualité puisque la crise sanitaire se double d’une crise économique et sociale. » C’est en ces termes que Fabrice Lenglart, à la tête de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), rattachée au ministère des solidarités et de la santé, et président délégué de l’Observatoire national du suicide (ONS), a présenté, mercredi 10 juin, le quatrième rapport de l’ONS.
La relation de cause à effet n’est pas évidente. « Le chômage peut détériorer la santé mentale, mais une mauvaise santé mentale peut, à terme, limiter la participation au marché du travail, la recherche et l’obtention d’un emploi », rappelle l’ONS. Et pourtant, les chiffres sont là : 30 % des chômeurs songent sérieusement au suicide, contre 19 % des actifs en poste, et « le risque de décès par suicide des chômeurs est supérieur à celui des actifs en emploi, en particulier chez les hommes entre 25 et 49 ans ».
La perte d’emploi a des conséquences sur tous les domaines de la vie (famille, relations sociales) et des effets délétères sur la santé du chômeur (troubles du sommeil, alimentation déséquilibrée, moindre activité physique, comportements addictifs, etc.). « Le chômage entraîne une détérioration de la santé mentale pouvant aller de l’anxiété à la dépression, voire, dans sa forme la plus dramatique, au suicide », peut-on lire dans le rapport.
Une réponse à la société
Le psychiatre Michel Debout, coauteur du document, alerte les pouvoirs publics sur l’urgence de proposer des accompagnements psychiques aux demandeurs d’emploi. Dans la perspective d’améliorer la prévention, il distingue différents types de suicide chez les chômeurs : « le suicide retrait », qui vient clore une période d’isolement et de désocialisation provoquée par le chômage et qui pourrait être évité par une proposition de formation ou d’emploi, même précaire ; « le suicide protestation », qui manifeste l’opposition à tout ce qui, en amont, a conduit au licenciement ; enfin, « le suicide sacrifice », qui est aussi un acte de dénonciation, mais pour faire bouger les lignes.
L’acte suicidaire n’est pas seulement un problème avec soi, mais une réponse à la société. « C’est bien à “l’être social” que s’adresse la violence générée par la perte d’emploi, les licenciements, les plans sociaux et les dépôts de bilan », souligne M. Debout. Vu les perspectives économiques, la baisse du nombre de morts par suicide révélée par le rapport (9 300 en 2016) est fragile. « Hélas, cette évolution est en cours d’inversion rapide. On constate déjà une remontée des actes suicidaires avec la crise », affirme Jean-Claude Delgènes, président fondateur du cabinet Technologia, spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux.
Il vous reste 0% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.