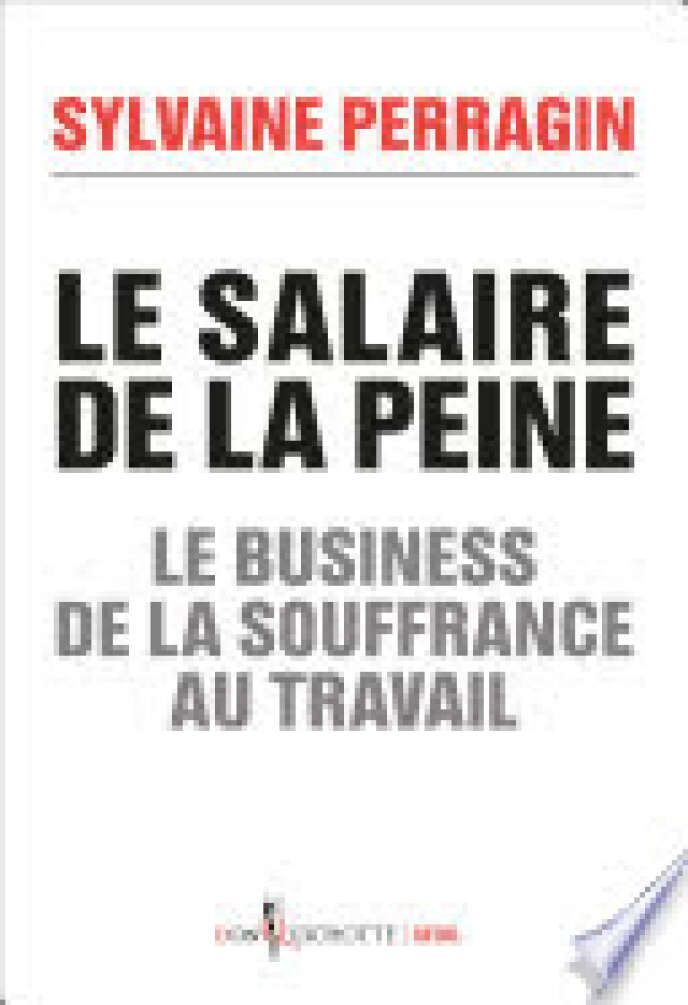Les distances de chômage régionaux consternent à se dissoudre en Europe

Alors que le sud de l’Italie arrive péniblement à créer des emplois, l’Europe de l’Est est appréciée à une carence de main-d’œuvre.
Délicatement, mais certainement, les conséquences de la crise s’abolissent sur le Vieux Continent. En février, le taux de chômage est ainsi chuté à 6,5 % dans l’Union européenne, soit le plus faible taux noté depuis janvier 2000, selon l’office statistique européen. Cette moyenne prometteuse masque cependant de grandes variations entre les Etats membres, et plus encore au sein même des Etats.
Selon Eurostat, le taux de chômage s’espaçait en 2018 de 1,3 % dans la région de Prague à 35,1 % à Mayotte, le record
Les chiffres diffusés lundi 29 avril par Eurostat admettent d’en mesurer l’abondance. En 2018, le taux de chômage a descendu dans huit régions européennes sur dix. Mais, dans le détail, il s’échelonnait encore de 1,3 % dans la région de Prague et 1,5 % dans le sud-ouest de la République tchèque, où il est historiquement bas, à 29 % dans la ville autonome espagnole de Ceuta, et 35,1 % à Mayotte, le record. L’écart est presque aussi montré pour le taux de chômage des moins de 25 ans, qui varie de 4 % dans la Haute-Bavière allemande à 66,1 % à Melilla, en Espagne.
Sans surprise, ces différences sont en partie l’héritage de la crise de 2008. Ainsi, les régions les plus frappées sont surtout situées dans le sud de l’Espagne et de l’Italie, et en Grèce, pays spécialement affectés par le recul. A l’inverse, les taux de chômage les plus faibles sont enregistrés dans les territoires où la reprise a été la plus solide, surtout en Allemagne, au Royaume-Uni, en Autriche et en Europe de l’Est.
« Ces écarts sont aussi le fruit des politiques économiques nationales et de l’inégale répartition des activités sur le continent, déclare Laurent Chalard, docteur en géographie à Paris-IV-Sorbonne. Ainsi, les richesses productives raidissent à se accumuler sur la dorsale européenne allant des Pays-Bas au nord de l’Italie, en suivant l’axe rhénan. »
S’adjoint à cela ce que les économistes nomment « les phénomènes d’agglomération », à savoir une disposition à la concentration des activités autour des villes dynamiques. A l’opposé, certaines régions périphériques, à l’exemple du sud de l’Italie, réunissent les retards et les handicaps : institutions publiques de moindre qualité, faible propriété des travailleurs, forte présence de l’économie souterraine.