« La prise de parole des victimes oblige à repenser l’exercice du pouvoir »
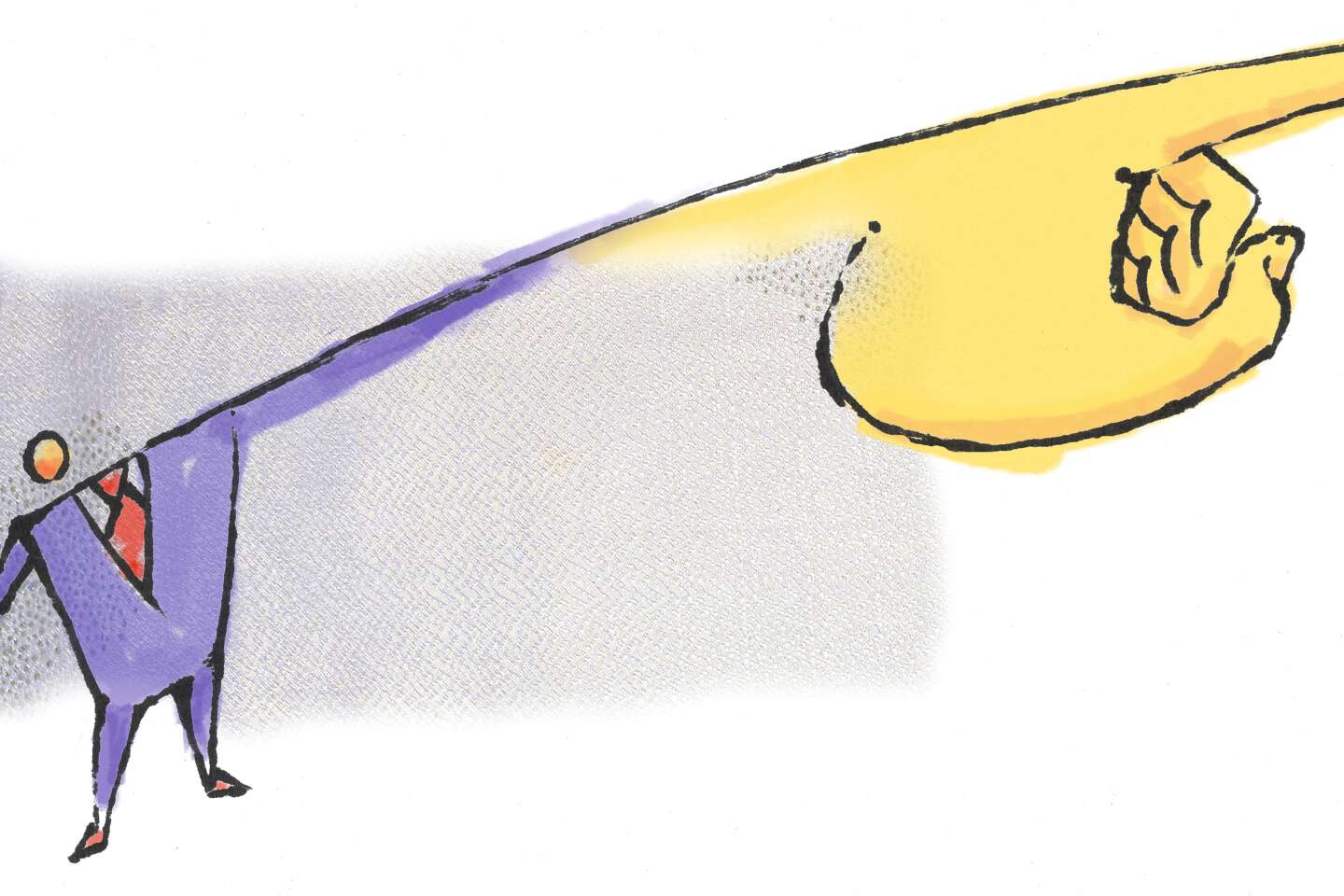
Gouvernance. Le statut de victime a acquis une telle aura dans l’opinion des sociétés occidentales qu’il donne à ceux qui prennent la parole en son nom un puissant moyen de pression sur la gouvernance des institutions. Loin d’être purement moral, le phénomène est un produit de la « sociétalisation », cette nouvelle manière de réguler les conduites en les soumettant aux injonctions de la société civile.
Le mouvement #metoo est un bon exemple du mécanisme. Considérés longtemps comme une expression « normale » de la différence de statut symbolique et pratique entre les hommes et les femmes, les comportements sexistes ont été dénoncés comme des manifestations abusives de la violence masculine.
Une telle reformulation a été permise par ce que le philosophe américain John Dewey (1859-1952) a appelé la publicisation du sujet (Le Public et ses problèmes, 1927), c’est-à-dire par la prise de conscience par des femmes que les actes machistes dont elles étaient victimes dépassaient les vécus personnels et concernaient toute la société. Ils banalisent en effet des rapports de domination qui structurent une manière intolérable de vivre ensemble.
Une compétence exceptionnelle
Depuis une décennie et parallèlement à #metoo, des groupes de parole ont « publicisé » de nombreux sujets : harcèlements physiques et moraux, abus d’autorité, manipulations psychologiques, violences sexuelles ou conjugales, mépris des minorités et discriminations de toutes formes.
Selon une même démarche, des actes individuels sont rendus publics pour dénoncer le système institutionnel qui invisibilise les abus. La prise de parole à partir de cas privés n’a pas vocation de « rompre le silence », comme on le dit souvent, mais, au contraire, de mettre des mots communs sur des comportements qui étaient jusqu’alors inexprimés parce qu’ils étaient négligés.
Fait politique nouveau, la publicisation renverse aussi la logique classique démontrée par René Girard (1923-2015) notamment (La Violence et le sacré, 1972), qui fait de la victime le bouc émissaire passif de la violence publique. Au contraire, elle procure aux victimes une compétence exceptionnelle qui les autorise à énoncer publiquement une parole d’autorité. D’où la multiplication de discours victimaires et l’extension toujours plus large du périmètre des victimes, incluant désormais celles du réchauffement climatique, des animaux menacés par la chute de la biodiversité, des forêts ou de la Terre elle-même, victime ultime de l’activité humaine.
Un climat trop instable
Il vous reste 30.06% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.





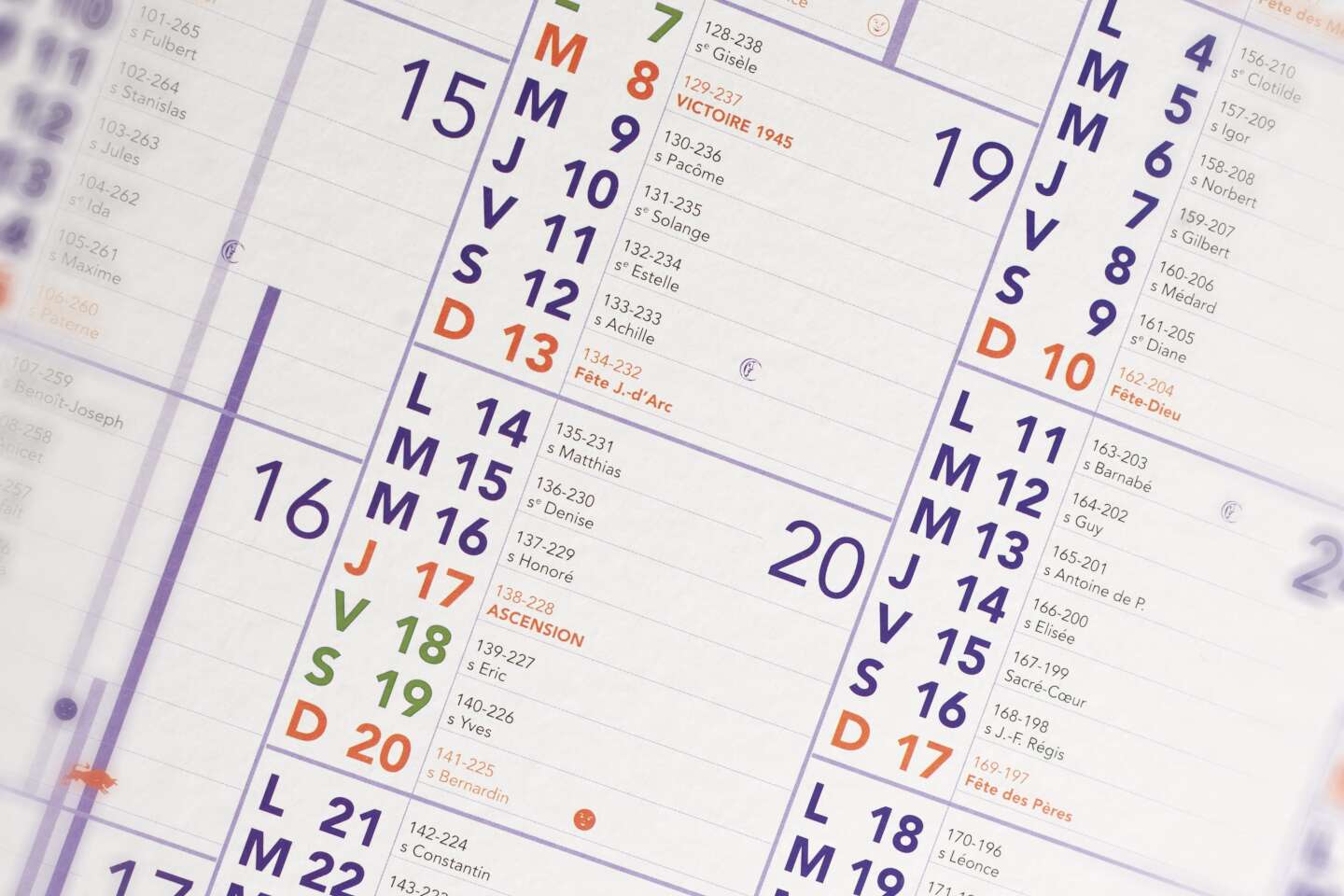



L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.