Carnet de bureau : « L’égalité femmes-hommes à l’index »

La note moyenne de l’index égalité femmes-hommes déclarée par les entreprises en 2023 est de 88/100, a annoncé, le 8 mars, le ministère du travail. Pour Orange SA, 89/100, avec une petite faiblesse sur la parité au sein des dix plus hautes rémunérations ; 96/100 à la Caisse nationale d’assurance-vieillesse ; qui dit mieux ?
L’index, que chaque entreprise de plus de cinquante salariés est obligée de brandir le 1er mars, est censé exprimer le niveau d’égalité entre les femmes et les hommes, par la mesure des écarts de salaire, de promotion et de la parité au sein des dix plus fortes rémunérations : 72 % des entreprises concernées ont publié leur index en 2023, contre 61 % en 2022 et 2021 et 54 % en 2020.
L’index, créé par la loi sur l’avenir professionnel, en 2018, apparaît désormais sur les sites des entreprises au printemps, comme les premières fleurs de l’année, essentiellement pour vanter leurs bons scores et étaler leur image de « belle boîte ». « Les résultats sont en constante progression depuis sa mise en place, en 2019 », souligne le ministère du travail. Il reste pourtant beaucoup à faire pour atteindre l’égalité professionnelle en entreprise, en particulier au sein du très masculin top 10.
Les mauvais élèves de l’index font profil bas, d’autres évitent tout simplement de déclarer leur situation, quitte à risquer la sanction prévue par la loi. Depuis 2019, 49 pénalités financières ont ainsi été notifiées aux entreprises par l’inspection du travail, pour absence de publication de l’index, absence de définition de mesures correctrices ou du fait d’un index inférieur à 75/100 pendant plus de trois exercices consécutifs. Depuis 2020, 77 entreprises sont restées en deçà du seuil fatal de 75/100, qui déclenche la sanction.
Des conclusions sévères
Quelle est donc l’utilité de cet index ? Quatre ans après sa création, l’Institut des politiques publiques (IPP) a décidé d’en faire le bilan, et l’a présenté en conférence de presse le 6 mars. Ses conclusions sont sévères : « Une couverture limitée », « peu d’effet sur les entreprises concernées », « des règles de calcul complexes, qui permettent d’atténuer les écarts salariaux ». En clair, les entreprises ont appris à adapter l’instrument de mesure au service de leurs intérêts ou ne rentrent tout simplement pas dans le champ d’application. L’IPP a ainsi établi que les postes de travail pris en compte par l’index « ne représentent que 25,5 % de l’emploi privé ».
Il ne faudrait pourtant pas jeter l’index aux orties, comme un vulgaire élément parasite de communication. Car, si Orange SA, par exemple, peut aujourd’hui présenter un taux de féminisation de plus de 32 % des cadres dirigeants et de 40,7 % au comité exécutif (comex), c’est bien parce que, avant la loi Rixain de 2021, qui a imposé un quota de femmes au comex des entreprises de plus de 1 000 salariés, il y avait eu la création de l’index, et, dix ans plus tôt, en 2011, la loi Copé-Zimmermann, qui introduisit des quotas dans les conseils d’administration.
Il vous reste 7.26% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.







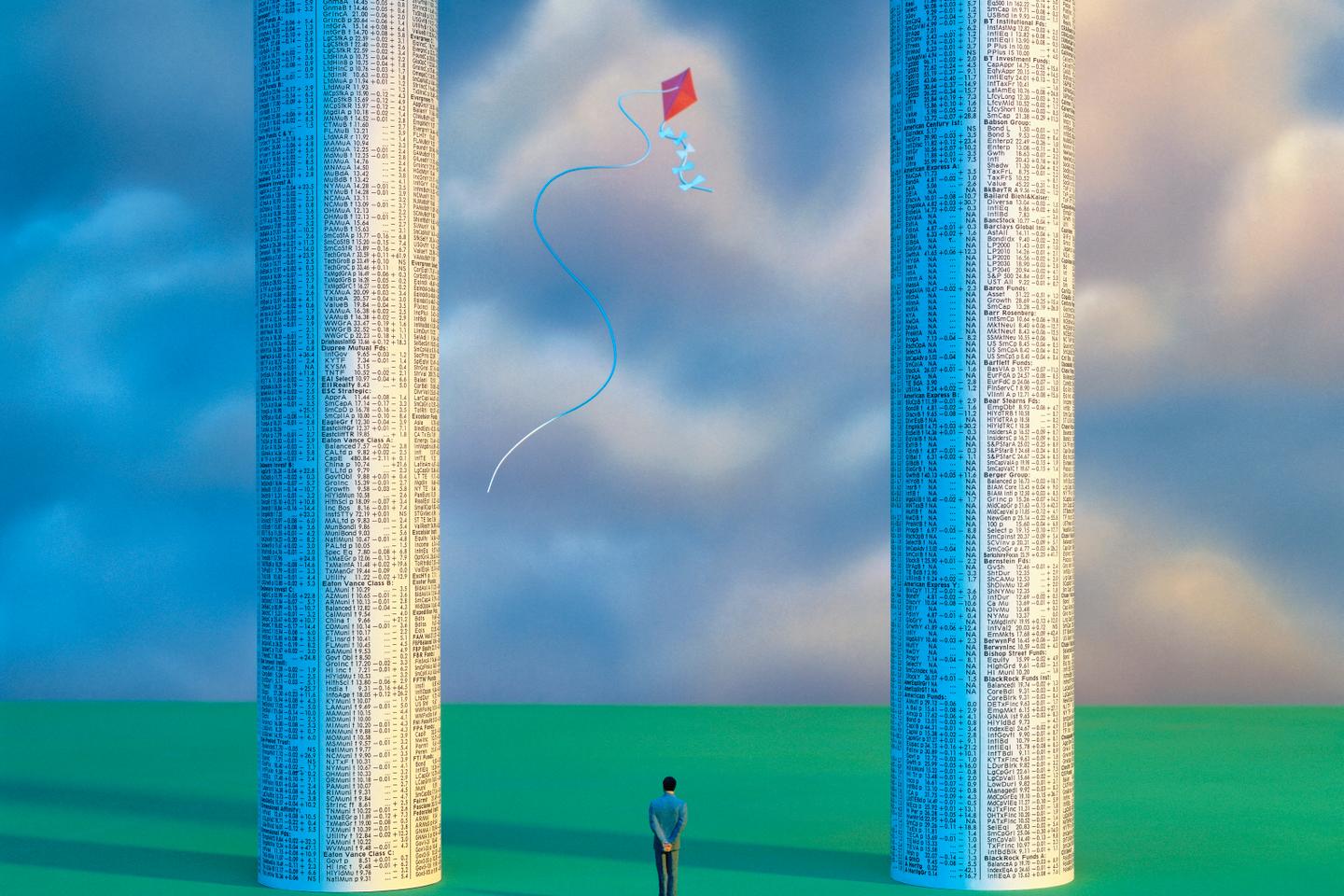

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.