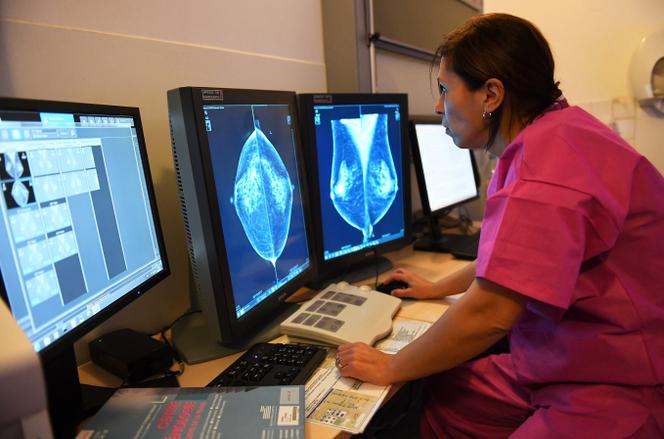Les mercredis de l’enfer des parents en télétravail : « Ma journée est complètement saucissonnée ! »

Pour permettre à son enfant de ne pas se lever à l’aube le mercredi matin et lui éviter une journée au centre aéré, Hélène Bastou a opté pour le télétravail. En accord avec son patron, le mercredi, elle reste chez elle, du côté de Nîmes. Sa fille, âgée de 6 ans, a compris le contrat : « Elle sait qu’elle peut se lever plus tard et prendra son petit déjeuner toute seule. J’ai tout préparé. Si elle m’entend parler, c’est que je suis au téléphone ou en visio. » Et le mot d’ordre est clair : « Interdiction de venir me déranger. » Bien consciente que cette organisation un peu militaire n’est pas parfaite, cette chargée de mission, qui vit seule la semaine (son compagnon travaille à 300 kilomètres), fait partie de celles et ceux qui, chaque mercredi, assument les tâches professionnelles et familiales sur le même créneau horaire.
La plupart sont indépendants et excellent dans l’art de jongler entre vie privée et sphère professionnelle. Une véritable « gymnastique de l’esprit », estime Marine Avias, alias Mademoiselle Astuce dans le milieu professionnel. Maman de quatre enfants, cette architecte d’intérieur dans l’Hérault est une spécialiste de l’anticipation : « C’est comme le sport, plus on s’entraîne, plus on est musclé ! Maintenant, j’ai l’habitude. Quand je suis avec mes enfants, je suis totalement avec eux, hors de question de travailler, mais pendant qu’ils sont à leurs activités, ou quand je suis en voiture, je réponds à un client, je fais un suivi de chantier. »
Ces mères, puisqu’il s’agit principalement d’elles, sont devenues des as du changement de casquette : à 10 h 10, elles sont mamans pour amener l’aîné à l’entraînement ; à 10 h 25, de leur voiture, elles reprennent le dernier dossier en cours et, une heure trente plus tard, elles gèrent le déjeuner en famille, avec le portable à portée de main – « On ne sait jamais », commente Laure (le prénom a été changé). Journaliste free-lance à Rennes, elle se reconnaît « complètement dans cet emploi du temps gruyère ». Elle admet facilement tomber dans ce qu’elle qualifie de « pièges », « comme les appels téléphoniques alors qu’[elle est] dans les vestiaires de la piscine ». « Je n’ose pas ne pas répondre et je vois ma fille me faire les gros yeux », rapporte-t-elle. Sa fille justement, Eléonore, 9 ans, ne saisit pas bien la frontière entre les heures de travail de sa mère et le temps où elle est disponible : « Elle dit qu’elle ne travaille pas le mercredi, mais en fait, elle est toujours connectée. Elle passe beaucoup de temps au téléphone ou prend son ordinateur pour m’emmener au sport. Et ça arrive souvent qu’on annule une activité parce que, finalement, elle doit travailler. » Son petit frère, Paul, 7 ans, « trouve que maman travaille tout le temps, même le dimanche ». « Mais elle essaie quand même de jouer avec nous, nuance-t-il. Et je préfère être à la maison qu’au centre aéré, même si mes copains y vont. »
Il vous reste 72.57% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.