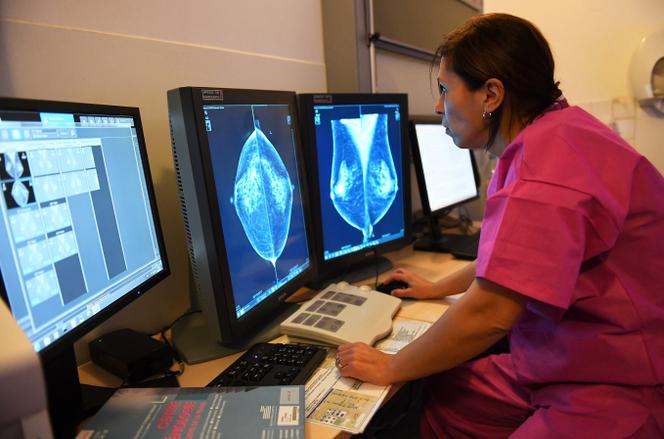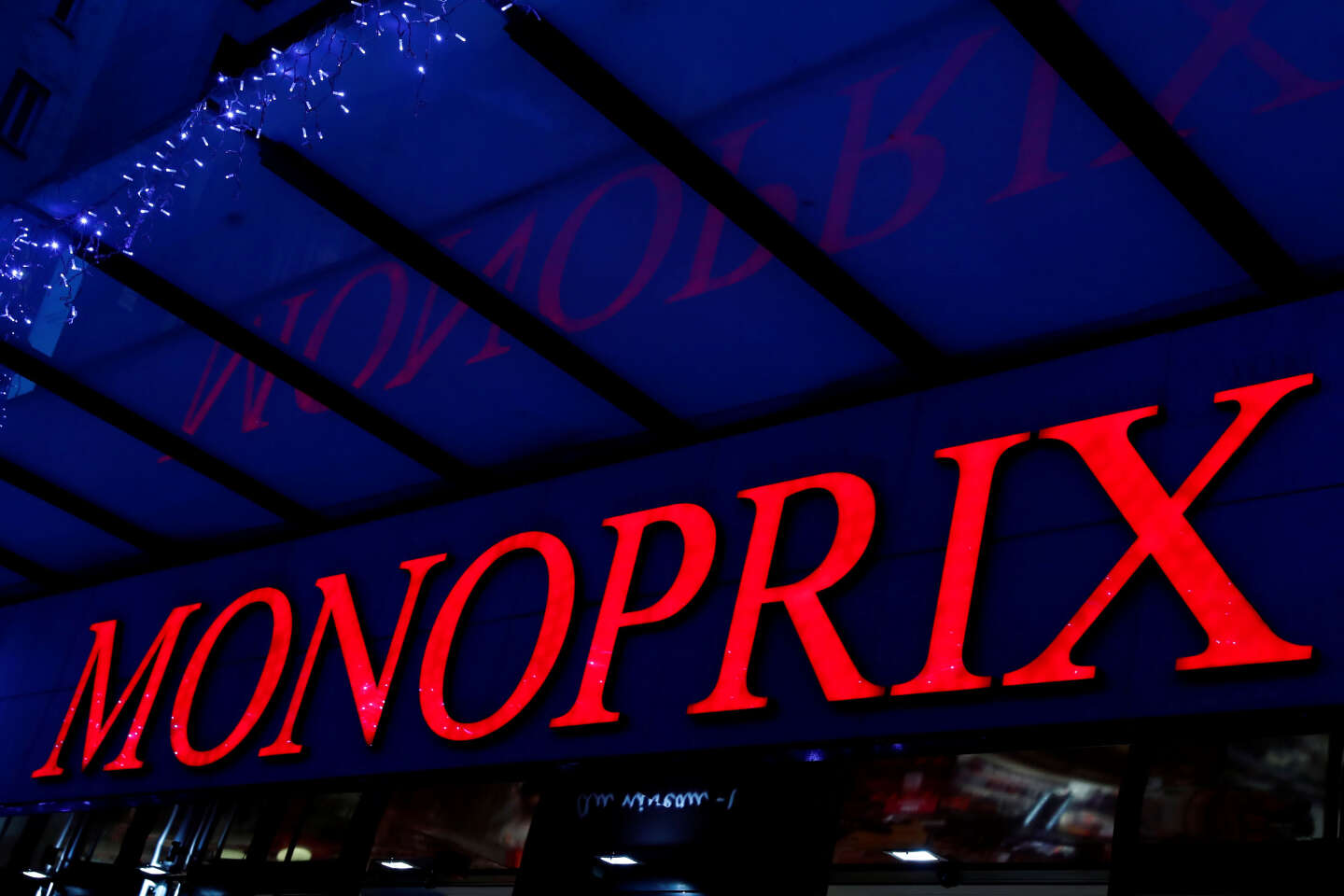Pimkie va fermer 64 magasins et supprimer 257 postes d’ici à 2027
L’enseigne de prêt-à-porter féminin Pimkie a annoncé, mercredi 29 mars, son intention de fermer 64 magasins d’ici à 2027, conduisant à la suppression progressive de 257 postes, dans le cadre d’un plan de transformation de son propriétaire, Pimkinvest.
Ce « plan d’économie » s’explique par « une baisse de la fréquentation et des ventes », explique dans un communiqué la marque, rachetée à l’Association familiale Mulliez (AFM) en février par Pimkinvest, consortium mené par les groupes Lee Cooper France, Amoniss (Kindy) et Ibisler Tekstil.
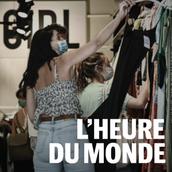
Écouter aussi Camaïeu, San Marina, Kookaï… Désastre dans le prêt-à-porter
Des délégués syndicaux de Pimkie avaient alerté au début de février sur l’imminence d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), craignant alors la disparition d’environ 500 postes.
« Les leviers pour réduire le nombre de fermetures seront étudiés avec attention, à chaque fois que cela sera possible, notamment aux côtés des partenaires bailleurs de Pimkie », est-il précisé dans le communiqué. Ce plan vise à « inscrire Pimkie dans un projet de long terme, en s’appuyant sur une structure saine », affirme la direction de la marque.
Pimkie liste plusieurs chantiers dont une « modernisation de l’offre et de l’image », une « transformation digitale » ou « l’amélioration de la performance commerciale ». L’entreprise entend « tout mettre en œuvre pour proposer des solutions favorisant le repositionnement des salariés » via un « reclassement interne » et « un accompagnement personnalisé », a-t-elle assuré.
Citée dans le communiqué, la directrice générale de Pimkie, Sandrine Lilienfeld, espère « réaffirmer la place de Pimkie » dans « le top 3 des marques préférées des femmes de 18 à 25 ans ».
L’enseigne longtemps détenue par l’AFM, qui emploie 1 500 salariés et compte 232 magasins en propre et 81 en affiliation, avait annoncé en octobre être entrée en négociations exclusives en vue de son rachat. La vente a été finalisée le 22 février.