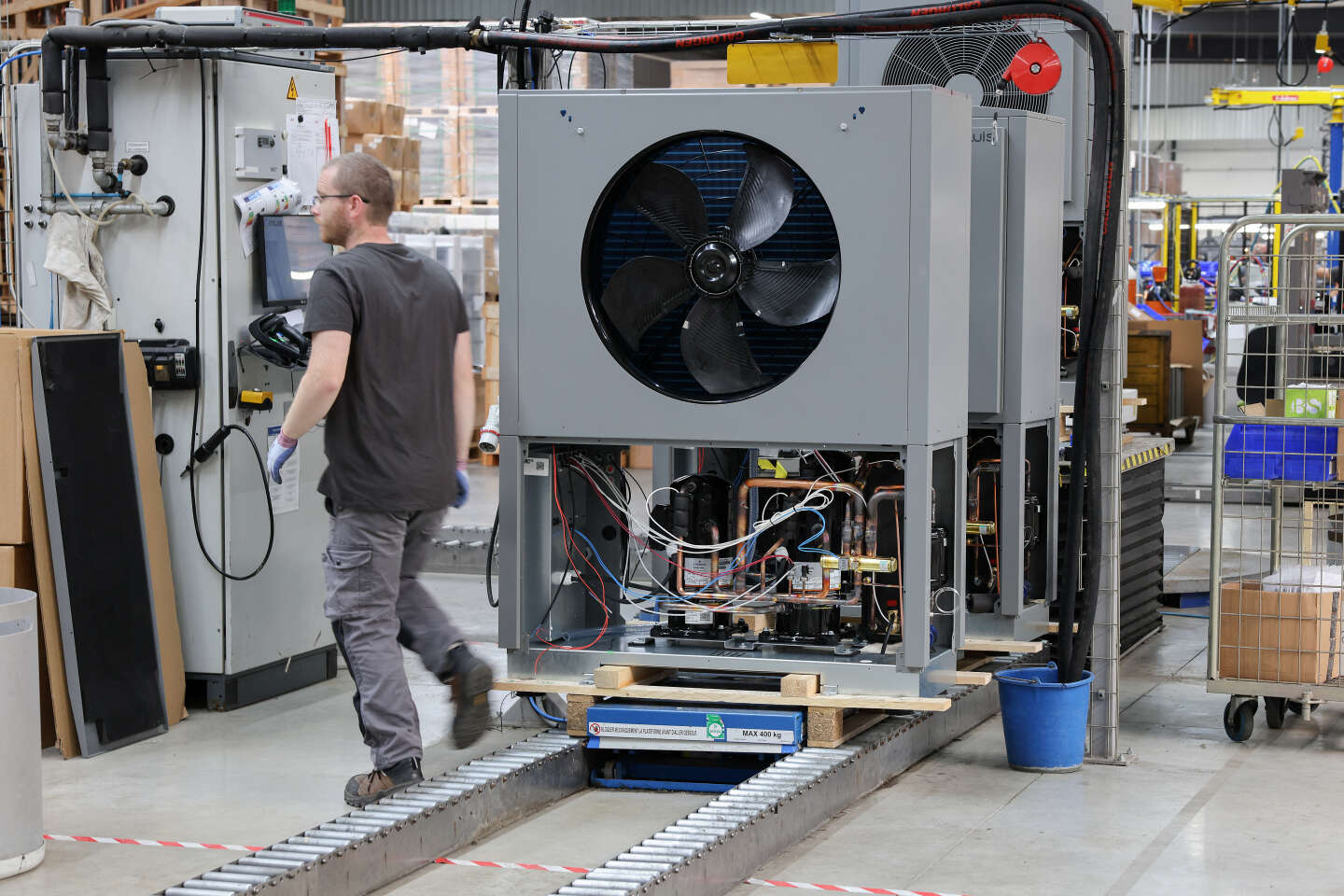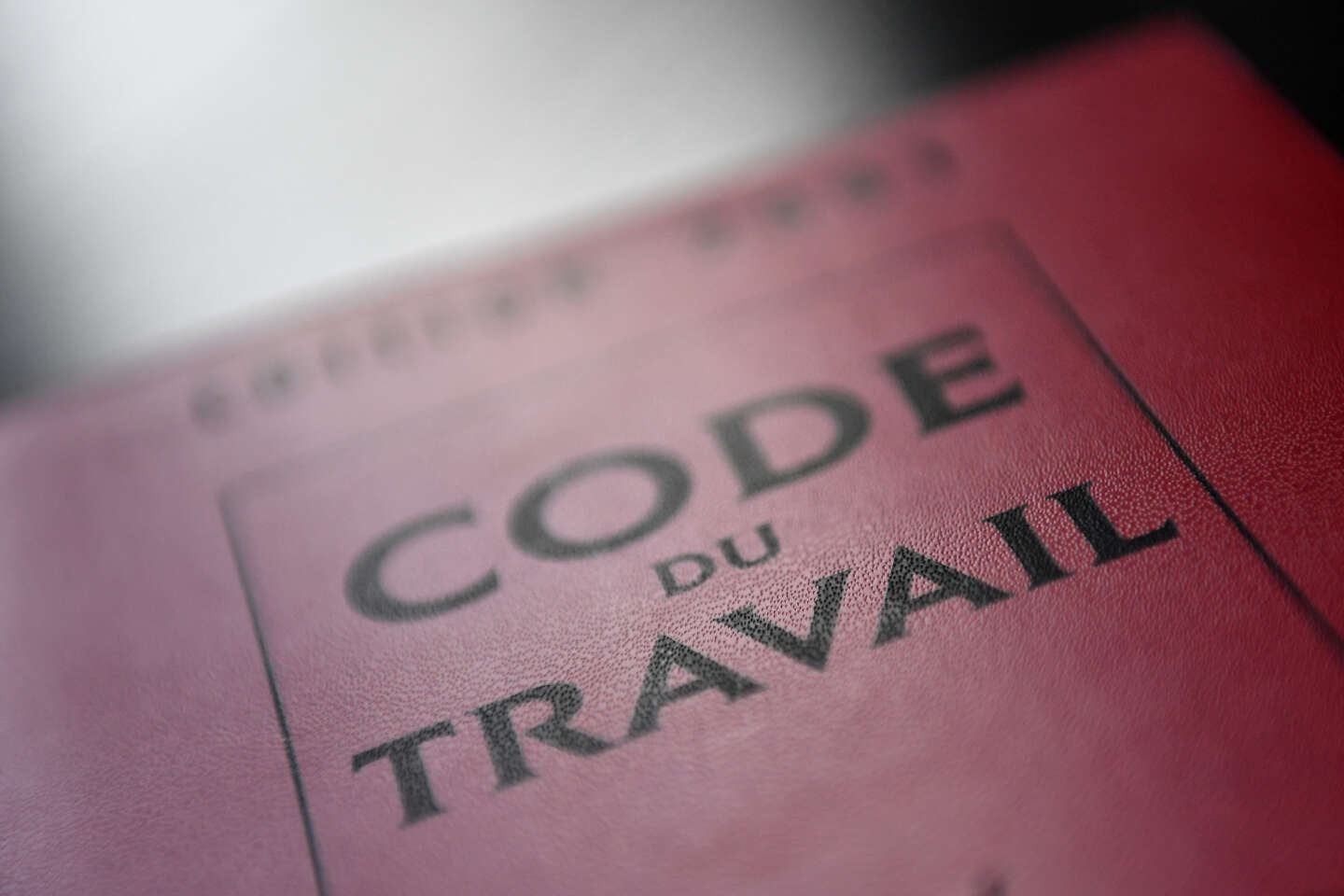« Que sait-on du travail ? » : des « normes viriles » persistent en entreprise

17 % : c’est, en 2019, la part de femmes en emploi qui possèdent le statut de cadre, contre 4 % en 1982. Cette proportion de cadres atteint 21,6 % chez les hommes, selon l’Insee. Alors que les entreprises et les pouvoirs publics ne cessent – en particulier autour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes – de mettre en avant leurs initiatives, peut-on affirmer que l’égalité femmes-hommes soit en bonne voie ?
Ce n’est pas l’avis de la sociologue Haude Rivoal, dans sa contribution au projet de médiation scientifique « Que sait-on du travail ? » du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques diffusé en collaboration avec les Presses de Sciences Po sur la chaîne Emploi du site Lemonde.fr.
Cette sociologue affirme que l’entreprise demeure fondamentalement masculine, ce qui signifie non pas « qu’elle est dirigée par des hommes », mais que « les pratiques d’entreprises favorisent les hommes ».
Pour établir ce constat, l’autrice fait appel aux travaux de plusieurs chercheurs, mettant en évidence les raisons structurelles de cette lenteur. L’accession de davantage de salariées à des postes à responsabilité est un arbre qui cache la forêt, car cela ne change pas la manière dont fonctionnent les organisations, les inégalités structurelles de salaires et les violences sexistes. Les qualités attendues pour devenir dirigeant ont peu changé, soit la même confiance en soi, et le même investissement sans faille – qui implique de se délester du travail domestique, et exclut dès lors une majorité de femmes.
Un marqueur social
Lorsqu’elles ne sont pas critiquées pour un comportement trop masculin, il arrive que les femmes cadres supérieures soient à l’inverse valorisées pour un management « différent » : « plus doux, plus conciliant, plus horizontal »… Soit, paradoxalement, l’inverse de ce qui permet de gravir les échelons. En s’attardant sur ces traits de caractère très schématiques, ou en les incitant simplement à mieux négocier leur salaire, certains employeurs relèguent la progression des femmes à un problème individuel.
Haude Rivoal explique qu’il s’agit d’un problème de culture, et que la « virilité » en entreprise a su s’adapter aux évolutions de la société pour conserver ses privilèges. En affirmant parfois à outrance une inclusivité et un féminisme qui ne se vérifient pas dans les chiffres de l’entreprise, certains chefs d’entreprise masculins espèrent même protéger leur poste, a pu observer la chercheuse au fil d’entretiens. Le sexisme ou la lutte contre celui-ci est davantage un marqueur social qu’un réel engagement. Dans la manière de manager, la hantise de l’impuissance reste valorisée, de même que la concurrence entre hommes.
Il vous reste 14.58% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.