Nokia annonce la suppression de 14 000 emplois

Jusqu’à 14 000 emplois supprimés. C’est ce qu’a annoncé, jeudi 19 octobre, le groupe finlandais d’équipements de télécommunications Nokia, dans le cadre d’un nouveau plan de réduction des coûts. Le groupe a mis en avant une baisse de 69 % de ses bénéfices au troisième trimestre à 133 millions d’euros (140 millions de dollars) par rapport à l’année précédente. Après la publication des résultats, le cours de l’action Nokia a baissé de 2 %, à 3,26 euros.
L’équipementier télécoms, engagé dans une bataille pour les réseaux 5G avec son rival suédois Ericsson et le chinois Huawei, a annoncé avoir vu ses ventes chuter de 20 % à 4,982 milliards d’euros au troisième trimestre par rapport à 2022. « Nous avons constaté un certain ralentissement dans le rythme du déploiement de la 5G en Inde, ce qui signifie que la croissance n’y était plus suffisante pour compenser le ralentissement en Amérique du Nord », a déclaré Pekka Lundmark, le directeur général de Nokia. Celui-ci a également exprimé sa tristesse quant à la suppression massive d’emplois, soulignant que « les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui ont un impact sur notre personnel ».
Le programme d’économies du groupe devrait permettre des réductions de coûts allant jusqu’à 1,2 milliard d’euros d’ici 2026, en ciblant notamment les réseaux mobiles, ainsi que les services cloud et réseau. Selon le directeur général, « le chiffre d’affaires net du troisième trimestre a été affecté par l’incertitude actuelle » mais celui-ci prévoit néanmoins « une amélioration saisonnière plus normale dans nos activités de réseau au quatrième trimestre ».
Contribuer






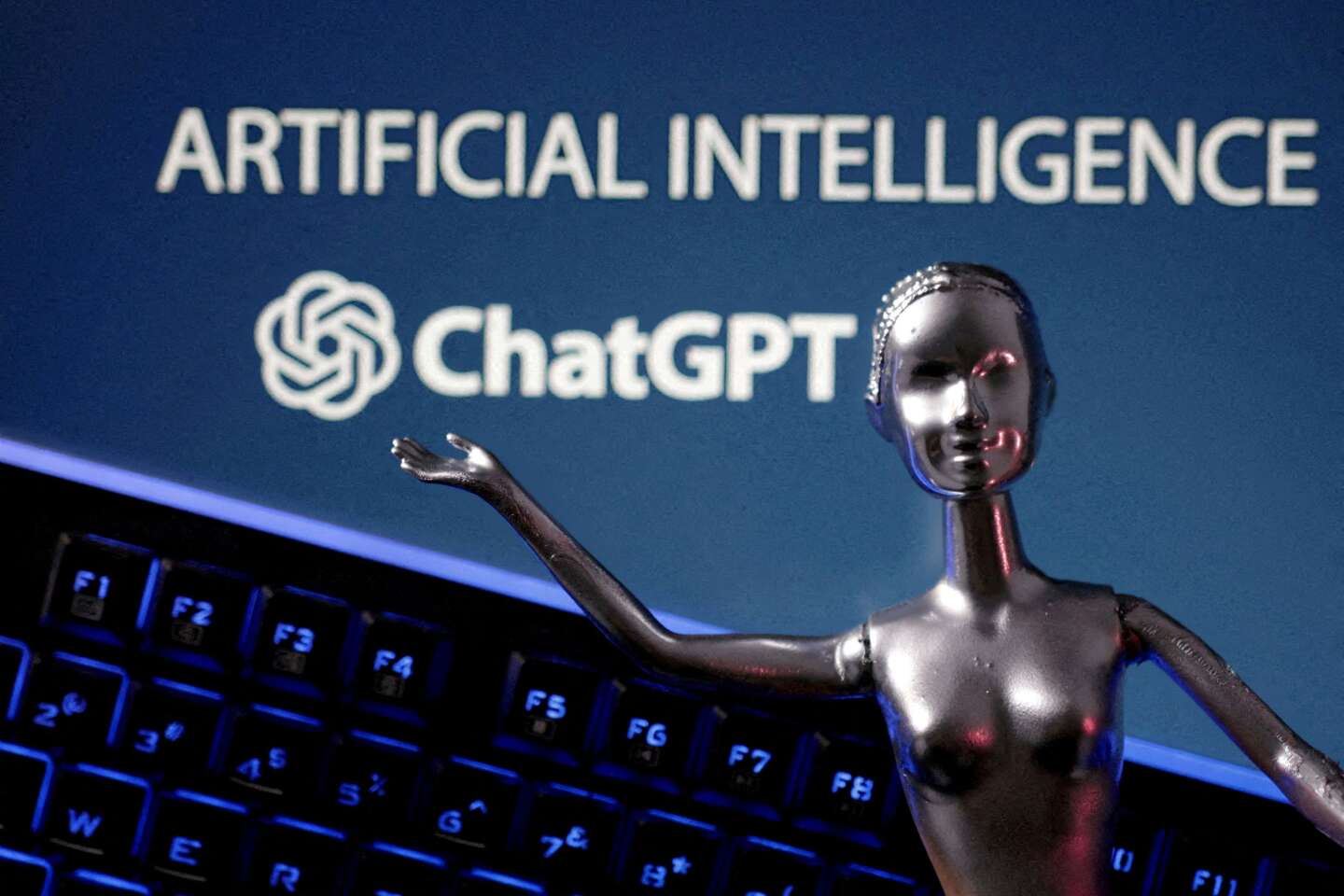

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.