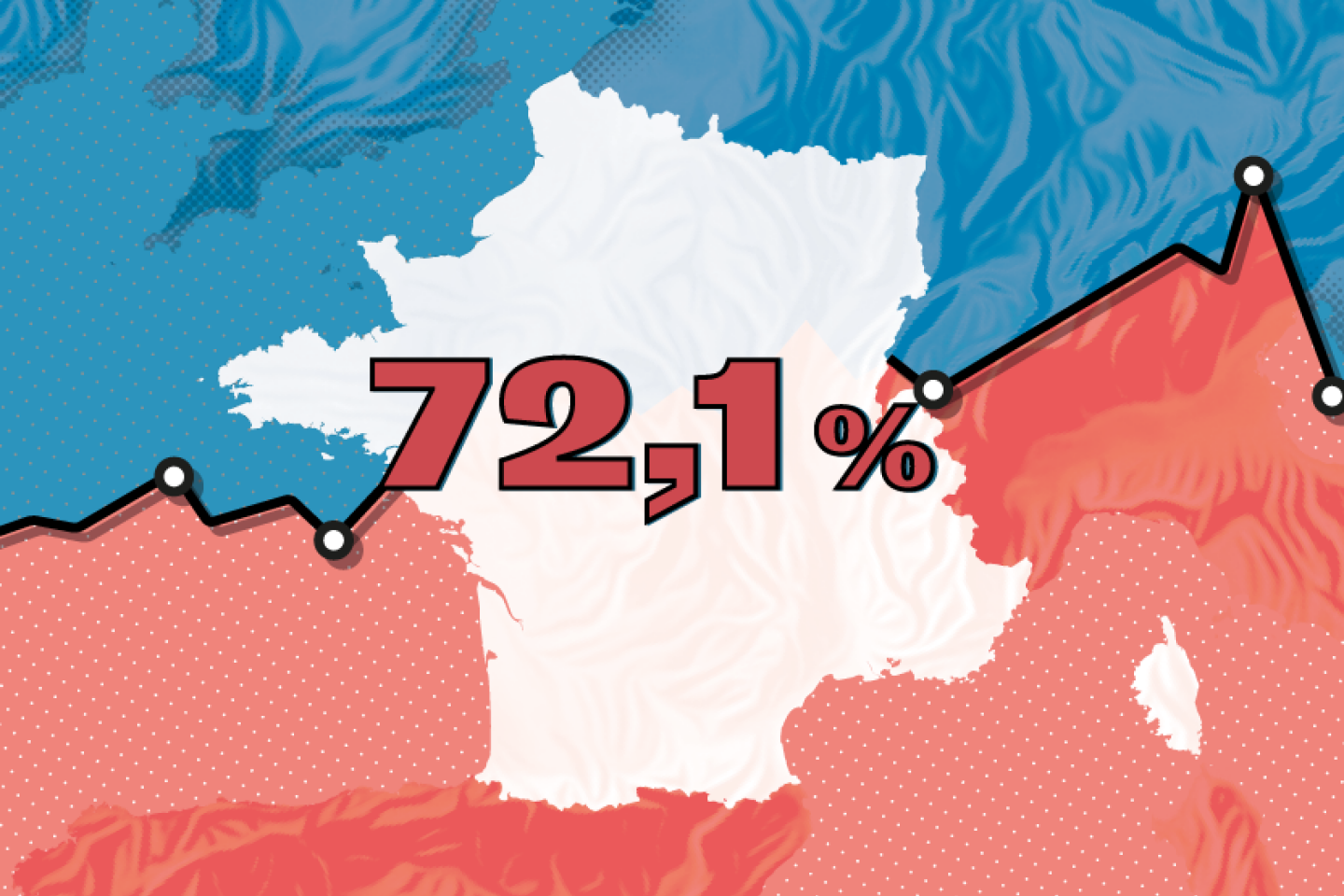Prix Penser le travail : la dégradation de la qualité du travail à la loupe

L’importance de l’environnement de travail, la singularité des métiers, la réhabilitation du geste, c’est ce que nous racontent les trois ouvrages nommés au prix Penser le travail : Le Deuxième Corps, de Karen Messing (Ecosociété), Le Travail pressé, de Corinne Gaudart et Serge Volkoff (Les Petits Matins) et Le Soin des choses (La Découverte), de David Pontille et Jérôme Denis.
D’une certaine manière, l’édition 2023 du prix de l’ouvrage management de l’année cofondé par Sciences Po et Le Monde célèbre la complexité du monde du travail et l’importance qu’il y a à l’observer de près pour en préserver la qualité. A quoi servirait de travailler toujours plus vite et toujours plus intensément si c’est au détriment de la qualité du travail et de la santé de ceux qui le font ?
Les étudiants en management de Sciences Po qui ont passé leur année de master à débattre de l’ensemble des ouvrages publiés en 2022 dans leur spécialité l’ont bien compris en présélectionnant ces trois finalistes sur quelque quatre-vingts ouvrages. L’approche clinique du travail commune aux trois nommés met en exergue les points de rupture et la dégradation des conditions du travail à l’œuvre dès leur apparition.
Qu’ils soient ergonomes, sociologues ou biologistes, les auteurs nous invitent à les suivre dans leurs enquêtes de terrain dans le BTP, la banque, les musées, les commerces, auprès des infirmières, des enseignants, des ingénieurs, etc. pour voir émerger les sources des inégalités femmes-hommes, les mécanismes de l’accélération du travail, et le rôle de la maintenance dans la préservation de la qualité du travail.
L’inadaptation des équipements
Dans son essai, la bio-généticienne canadienne Karen Messing, professeure émérite à l’université du Québec, aborde la question de la santé au travail par le genre. Elle part des inégalités constatées en situation de travail pour chercher la façon la plus efficace d’améliorer la prise en compte de la santé des femmes. Elle développe l’inadaptation des équipements professionnels au corps des femmes. Elle pointe que les exigences physiques du travail des femmes sont souvent invisibilisées, contrairement à celles des tâches typiquement masculines, et démontre en quoi « l’occultation des différences biologiques liées au sexe peut exacerber les inégalités et nuire à la santé des femmes ».
Elle compare les conditions quotidiennes du travail des femmes à celles de leurs collègues masculins dans différents milieux professionnels sur plusieurs décennies, et démontre ainsi la nécessité d’adapter les environnements à la diversité des corps, le milieu du travail ayant été pensé pour le corps des hommes.
Il vous reste 54.92% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.