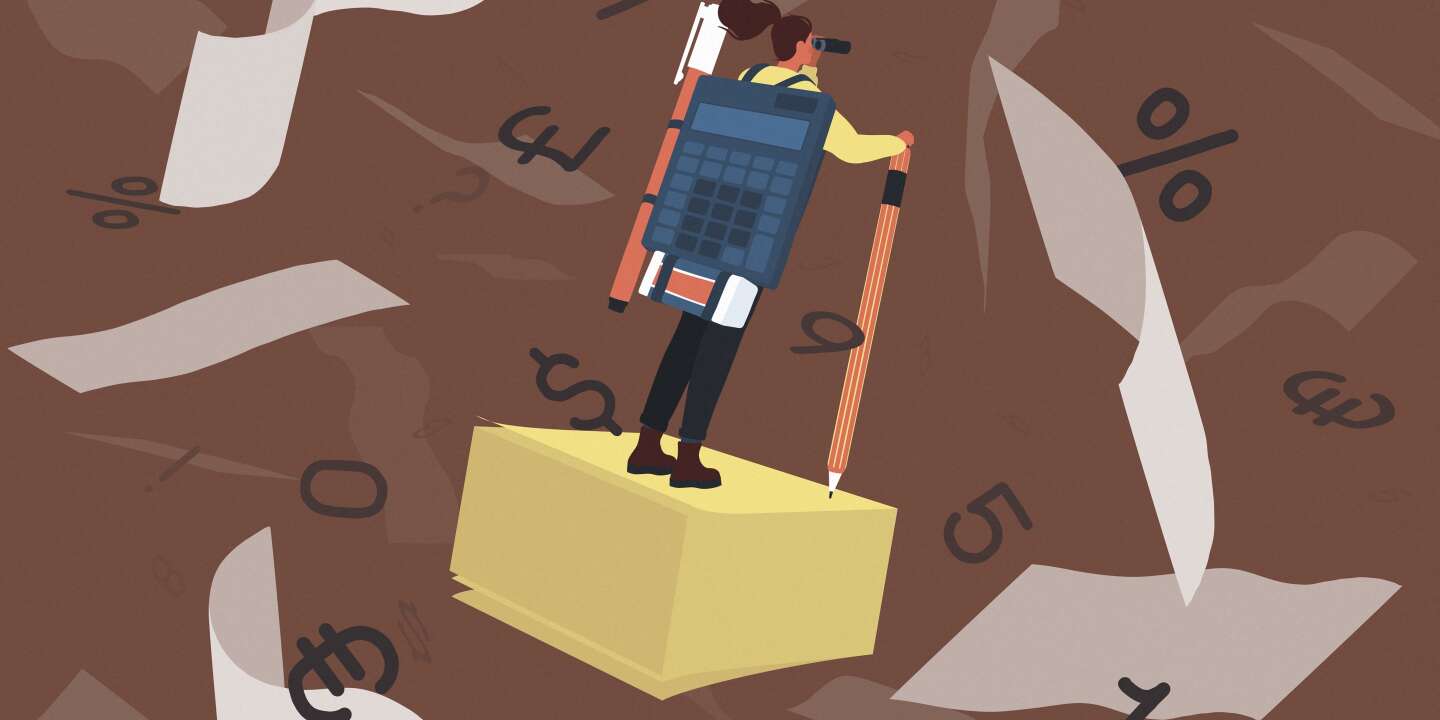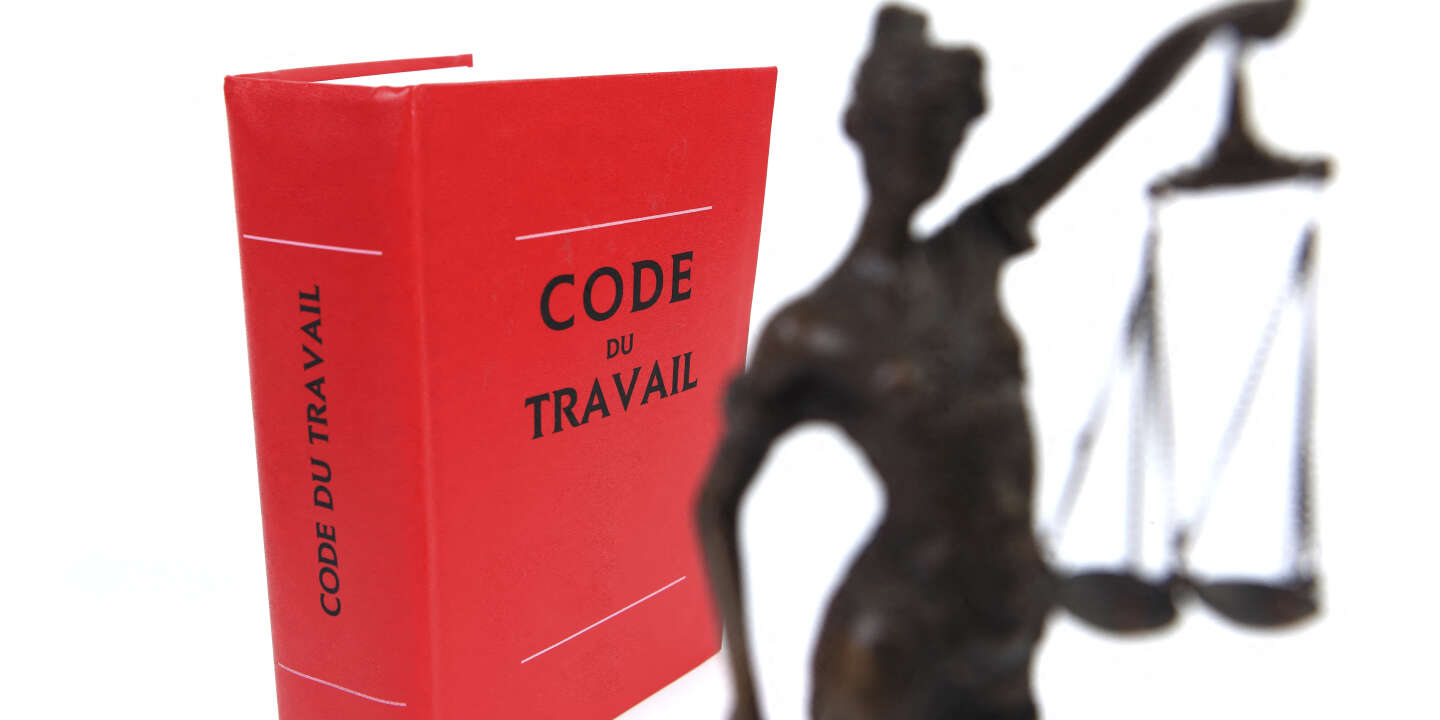« A la fin de l’année, on aura retrouvé le niveau d’activité de fin 2019 »

La confiance des ménages a dépassé en juin, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, sa moyenne de longue période, la consommation a rebondi de 10 % en mai, le taux de chômage est stable… Dans un entretien, Jean-Luc Tavernier, le directeur général de l’Insee (dont la note de conjoncture a été publiée jeudi 1er juillet), se dit confiant sur la reprise et estime une inflation autour de 1,8 % en fin d’année.
Après un an et demi de pandémie, tous les voyants de l’économie française sont passés au vert. La crise est-elle derrière nous ?
Compte tenu des données issues des enquêtes de conjoncture et des enquêtes de confiance auprès des ménages – collectées dans une période très favorable du point de vue de l’amélioration de la situation sanitaire et de la levée des restrictions –, la croissance devrait atteindre 6 % cette année par rapport à 2020. Pour mémoire, le PIB a été en léger recul de 0,1 % au premier trimestre, il progresserait de 0,7 % au deuxième trimestre, et nous prévoyons 3,4 % au troisième trimestre et 0,7 % au quatrième.
Nous pensons que nous reviendrons à la fin de l’année au niveau d’activité pré-crise, celui qui avait été atteint à la fin de l’année 2019. C’est mieux que ce que la plupart des conjoncturistes anticipaient en début d’année. Mais il faut rester prudent, comme nous l’avons toujours été dans nos prévisions depuis le début de cette crise : tout dépendra de la situation sanitaire, de l’évolution du variant Delta et du développement de la vaccination.
A cette réserve près, peut-on dire que la crise sera derrière nous à la fin de l’année ?
Entendons-nous bien : on aura retrouvé le niveau d’activité de fin 2019, ce qui ne signifie pas que nous aurons rattrapé le terrain perdu. Pendant ces deux années, on aurait quand même dû avoir un peu de croissance. En mettant bout à bout les différentes analyses sectorielles, nous estimons ce terrain perdu à 1,6 point de PIB. Environ la moitié de cette perte est imputable aux secteurs les plus touchés par la crise, comme l’aéronautique ou le tourisme.
Certains redoutaient une très forte hausse du chômage, elle ne s’est pas produite…
Effectivement, les pertes d’emplois ont été freinées par le dispositif d’activité partielle l’an passé, et la reprise des créations d’emplois avec le redressement de l’activité. Le taux de chômage reste un peu au-dessus de 8 % et devrait se maintenir à ce niveau à la fin de l’année. Si certains actifs qui avaient cessé de chercher un emploi vont revenir sur le marché du travail dans les mois qui viennent. Dans le même temps, de nombreux secteurs devraient recréer des emplois au second semestre, notamment dans les services. On attend ainsi un peu plus de 300 000 créations d’emplois cette année, contre 300 000 destructions d’emplois en 2020. On reviendra, alors, au niveau d’il y a deux ans.
Il vous reste 55.15% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.