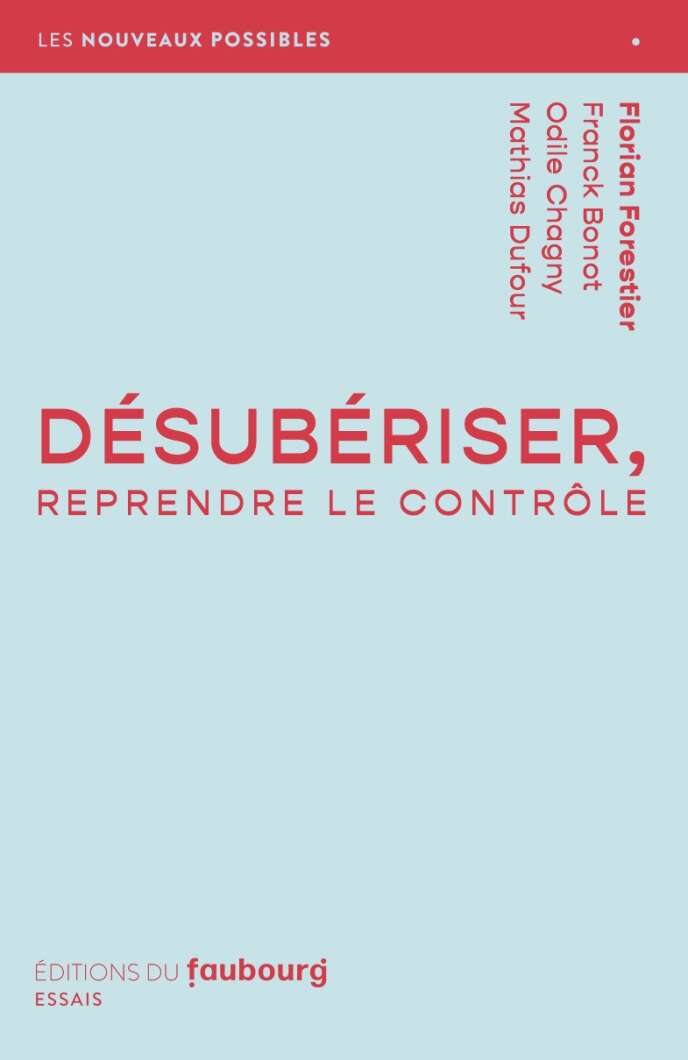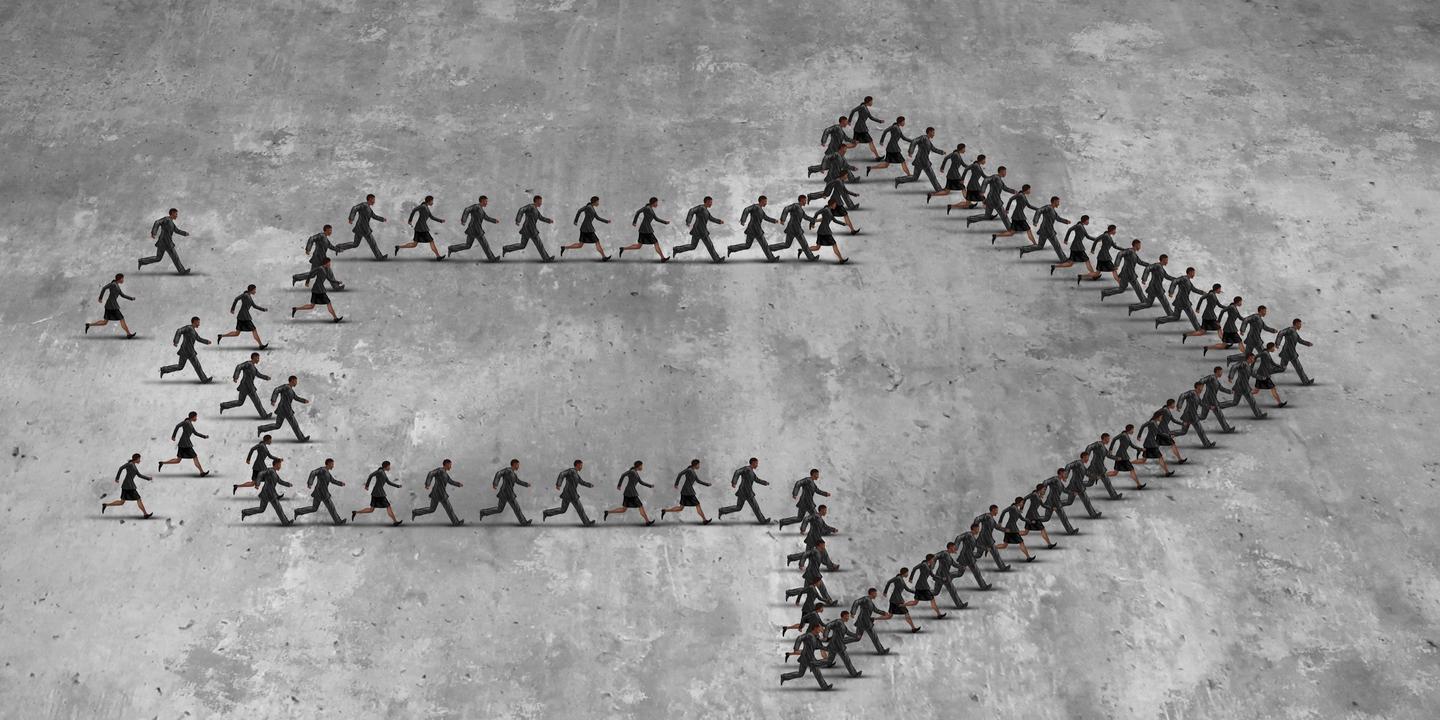Féminisation du pouvoir en entreprise : l’exemple californien

« Je ne suis pas une sainte-nitouche ». Parole de Loria Yeadon, la première femme à avoir intégré le conseil d’administration (CA) de TiVo, le spécialiste californien du magnétoscope numérique. Et lorsque TiVo a fusionné avec Xperi, la quinquagénaire a rejoint un autre CA, celui de l’entreprise familiale Laird Norton. Mme Yeadon se veut femme d’influence. Elle s’implique dans la recherche du futur directeur général de la société.
Elle se sent tout à fait libre de réclamer, par exemple, la prise en compte de candidats différents, femmes et minoritaires, pour des postes de haute responsabilité. Présidente du Young Men’s Christian Association (YMCA) du grand Seattle, au quotidien, elle milite aussi en faveur de l’intégration des jeunes dans les conseils d’administration. « Mes filles ont une vingtaine d’années. Je les emmène aux réunions, j’organise des rencontres avec d’autres femmes, dit-elle. Je les pousse à intégrer les instances dirigeantes d’une association pour qu’elles apprennent le b.a.-ba et qu’elles puissent, ensuite, faire leur entrée dans une entreprise. »
Mme Yeadon fait partie du cercle restreint des membres du conseil d’administration, ces VIP qui autrefois étaient plutôt des dirigeants masculins, vieux et à la retraite. Aux Etats-Unis, explique Betsy Berkhemer Credaire, la directrice de l’association 2020 Women on Boards, 60 % des candidats qui s’installent habituellement au tour de table de l’entreprise sont « cooptés ». « Ils appartiennent à un petit milieu de patrons, amis d’amis, sans femmes ou gens de couleur. » C’est pourquoi Mme Berkhemer Credaire, la chasseuse de tête, a milité en faveur d’une nouvelle loi.
Adoptée en Californie en 2018, elle impose au moins une femme au sein des administrateurs des entreprises cotées en Bourse et installées en Californie, et même deux ou trois femmes d’ici à la fin 2021, lorsque la compagnie dispose d’un conseil élargi.
Elle représentait « toutes les femmes »
Les résultats ne se sont pas faits attendre. « En 2019 en Californie, 45 % des nouveaux administrateurs étaient des femmes, constate Kim Rivera, la responsable des affaires juridiques du groupe HP, elle-même membre du CA de Thomson Reuters. Et d’insister sur les progrès accomplis : « En 2018, les conseils d’administration de quatre-vingt-treize compagnies étaient entièrement masculins, un an plus tard ils n’étaient plus que dix-sept. »
Les statistiques du groupe d’analyse Equilar attestent de la féminisation des instances gouvernantes : au début de l’année, 24 % des sièges des conseils des entreprises californiennes appartenant à l’indice Russell 3000 étaient occupés par des femmes. D’autres Etats ont suivi la tendance : l’Etat de New-York (23 %), le Massachusetts (23 %) et l’Illinois (22 %)…
Il vous reste 52.06% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.