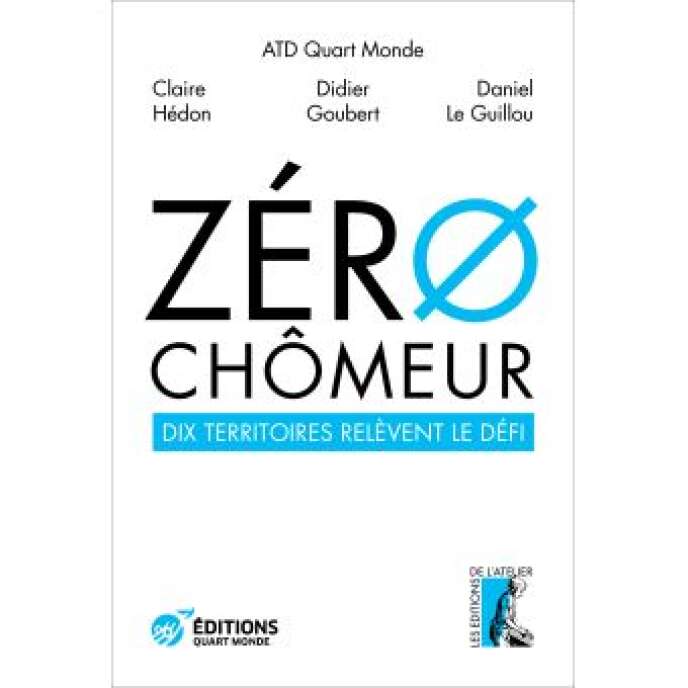Retraites : le gouvernement repousse les économies de court terme

Reculer pour mieux sauter ? Un temps envisagée, l’idée de réaliser dès 2020 des économies sur le système de retraites, avant la mise en place du régime universel promis par Emmanuel Macron, semble aujourd’hui écartée. Cette hypothèse avait été explorée durant plusieurs semaines, afin de reconstituer des marges de manœuvre budgétaires, qui s’étaient dégradées sous l’effet des mesures prises en réponse au mouvement des « gilets jaunes ». Finalement, l’exécutif ne devrait pas donner de tour de vis dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour l’an prochain. L’information, révélée par Les Echos, a été confirmée au Monde par plusieurs sources concordantes.
Pour autant, il ne faut surtout pas voir dans cet arbitrage un renoncement. Le gouvernement maintient son intention de réclamer des efforts, mais ceux-ci seront légèrement décalés dans le temps et étalés sur plusieurs années. « La question essentielle à résoudre est de savoir comment on s’organise pour que le futur régime universel de retraites soit fondé en 2025 sur des bases saines », explique un des artisans de la réforme en cours d’élaboration. « L’objectif est de remettre le système actuel à l’équilibre d’ici [six ans], au moment de la bascule [vers le nouveau dispositif] », ajoute un autre fin connaisseur du dossier.
Publiées en juin, les dernières prévisions du Conseil d’orientation des retraites (COR) ont montré que les comptes de nos régimes de pension, pris dans leur globalité, resteraient dans le rouge à hauteur de 0,4 % du PIB en 2022, ce qui équivaut à un déficit d’environ 10 milliards d’euros. L’enjeu est donc d’atteindre la ligne de flottaison en 2025. « Tout le monde s’accorde sur cette cible, qui est, pour le président de la République et le premier ministre, une condition sine qua non à la mise en œuvre de la réforme », complète cette même source, en précisant qu’une nouvelle concertation sera lancée « sur les modalités pour y arriver » : « Le tout figurera dans le projet de loi retraites en 2020. »
Ne pas « polluer » les municipales
Ce texte est censé s’inspirer des recommandations que Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, doit remettre le 18 juillet. Il les dévoilera aux partenaires sociaux puis au premier ministre, Edouard Philippe. Le projet de loi, lui, pourrait être présenté en conseil des ministres cet automne avant d’être débattu au Parlement en 2020 – peut-être après les municipales prévues en mars, afin de ne pas « polluer » la campagne avec un sujet hautement inflammable.
Pour M. Delevoye, l’absence de mesures dans le PLFSS 2020 peut, à première vue, être analysée comme une victoire. Le haut-commissaire était, en effet, très réticent à l’idée que les paramètres du système actuel puissent être changés à très court terme, dans une optique purement budgétaire : une telle démarche aurait été contraire aux engagements de M. Macron et à ceux que le haut-commissaire a pris vis-à-vis des partenaires sociaux, dans le cadre des consultations menées pendant plus d’un an.
Parmi les pistes d’économies qui ont récemment circulé, il y a notamment l’accélération du calendrier de la loi Touraine de 2014 : ce texte prévoit d’augmenter graduellement la durée de cotisation requise pour obtenir une pension à taux plein en la portant à 172 trimestres en 2035 ; l’un des schémas sur la table aurait consisté à avancer cette échéance de dix ans, en 2025, donc.
Mises en garde
Autres scénarios à l’étude, auxquels M. Delevoye était hostile : une minoration accrue de la pension de base des salariés du privé qui réclament leur pension avant d’avoir acquis tous leurs trimestres pour le taux plein. Ou encore l’instauration, dès 2020, d’un âge pivot autour de 64 ans (une décote étant appliquée à ceux qui partent avant cet âge). Le haut-commissaire estimait que de tels dispositifs pouvaient provoquer une levée de boucliers et mettre en péril le vaste chantier qu’il pilote depuis l’automne 2017.
Crainte non dénuée de fondement. Ces derniers jours, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a multiplié les mises en garde : si l’annonce du 18 juillet comporte « une mesure applicable dès 2020, par exemple l’augmentation de la durée de cotisation, la discussion sera terminée », a-t-il déclaré dans Ouest-France, le 7 juillet. Un avertissement qui a sans doute pesé dans la décision de l’exécutif de renoncer à des dispositions paramétriques dans le PLFSS 2020. Un parlementaire macroniste de premier plan observe :
« Si ce choix était confirmé, il serait pour partie la conséquence de la mobilisation des députés de la majorité et des syndicats, très attachés à faire aboutir la réforme systémique promise aux Français. »
Reste maintenant à voir comment les préconisations de M. Delevoye s’inscriront dans cette volonté d’assainir les comptes de nos régimes de pension. « Le haut-commissaire a toujours dit qu’il voulait mettre le système à l’équilibre en 2025, rappelle une source proche du dossier. Cela n’impliquerait pas forcément des mesures d’économies, le choix des mesures n’est d’ailleurs pas du tout acté. » On y verra, peut-être, plus clair le 18 juillet.