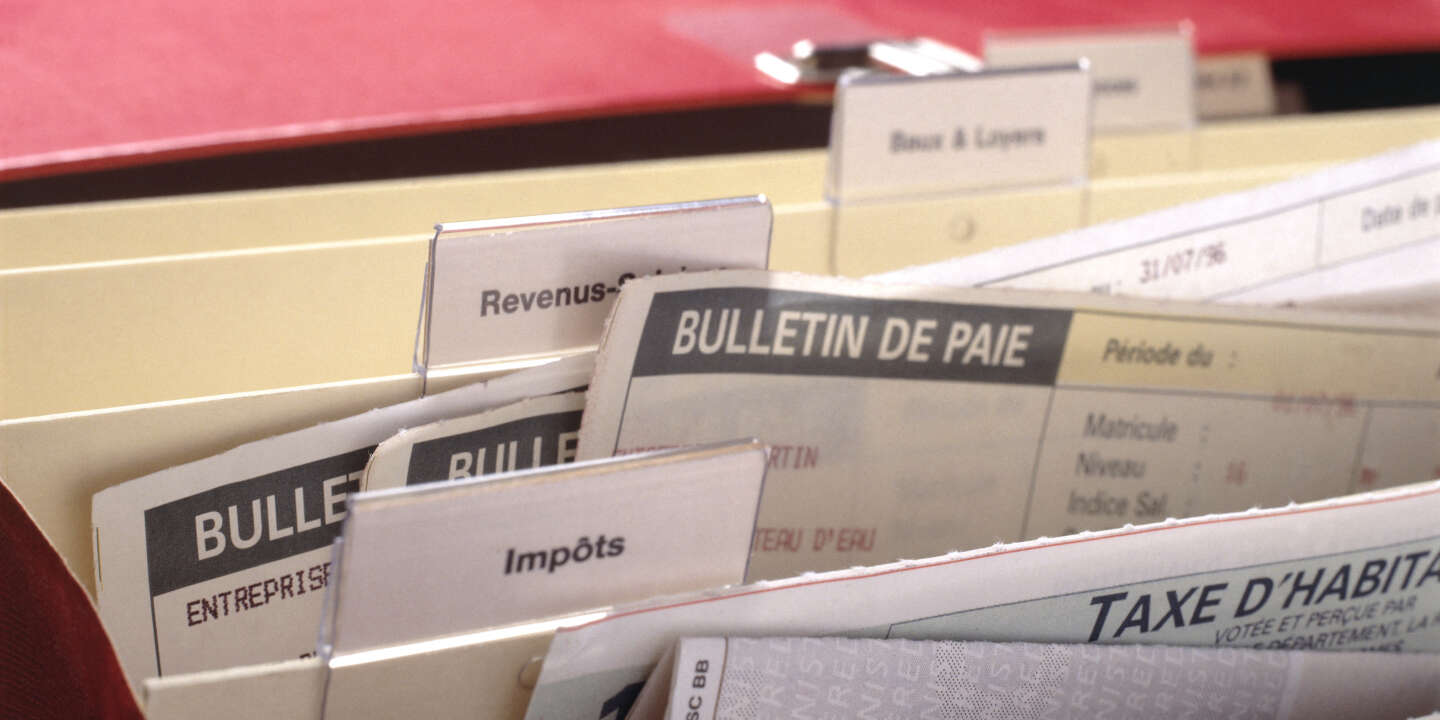Toyota va fabriquer un nouveau véhicule en France, dans son usine nordiste d’Onnaing
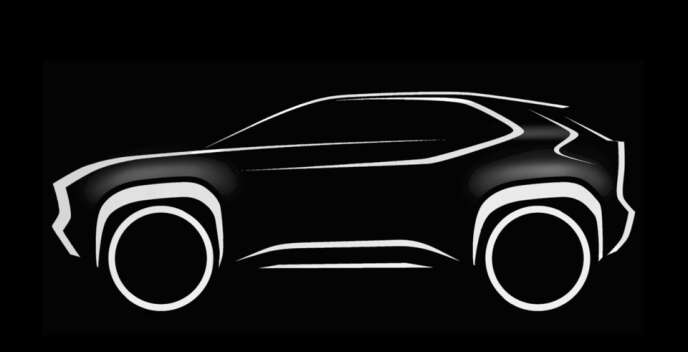
Le géant japonais de l’automobile Toyota se plaît en France. Mardi 14 janvier, le deuxième constructeur mondial a annoncé la production d’un second véhicule dans son usine d’Onnaing (Nord), dans la banlieue de Valenciennes, où la Yaris est déjà fabriquée. La voiture sera un petit SUV (« sport utility vehicle », aux allures de 4 × 4 urbain), concurrent de la Peugeot 2008 ou du Renault Captur. Ni le nom du modèle ni le calendrier de production ne sont, pour l’instant, connus, même si, dans le Nord, un démarrage est espéré dès cette année.
Ce qui est sûr, en revanche, c’est que la décision s’accompagne d’un investissement de 100 millions d’euros, qui viennent s’ajouter aux 300 millions déjà consacrés à la production de la Yaris de quatrième génération, lancée en mai 2019. L’usine emploiera 400 personnes supplémentaires en CDI, faisant passer le nombre de CDI à 3 600, qui seront recrutés essentiellement parmi les quelque 1 000 CDD de l’entreprise. L’effectif global du site atteindra, en tout, 4 500 personnes.
Ce qui est aussi acquis, c’est que ce futur SUV Toyota sera doté d’une motorisation hybride, spécialité du constructeur japonais. « Cette technologie est notre atout numéro un, rappelle Eric Moyere, directeur de la communication du site d’Onnaing. Pour la Yaris 4, nous prévoyons que 80 % de la production sera en version hybride. Nul doute que, pour le futur SUV, ce ratio sera aussi important. »
Une ambition de produire 300 000 véhicules par an
La nouvelle était fortement espérée dans le Valenciennois, car elle pérennise l’usine. « Notre ambition de produire 300 000 véhicules par an peut ainsi devenir réalité, assure Luciano Biondo, le directeur de Toyota Motor Manufacturing France, qui gère le site. La production de ce nouveau modèle permettra au site de ne pas être tributaire du cycle de vie commercial d’un seul modèle, renforçant ainsi la stabilité des effectifs dans le temps. »
« Deux véhicules, c’est une vraie sécurité et, pour certains anciens, un aboutissement »
Ce choix est aussi la suite logique de la décision, annoncée début 2018, de fabriquer dans les Hauts-de-France la dernière génération de la Yaris sur une nouvelle plate-forme industrielle dite « TNGA » (Toyota New Global Architecture), qui a nécessité une refonte de l’usine. C’est aussi sur cette base que sera produit le futur SUV. Il faut dire que plusieurs bonnes fées s’étaient alors penchées sur l’avenir de l’usine. Emmanuel Macron en personne s’était rendu à Onnaing pour en faire l’annonce. Il était accompagné de Didier Leroy, vice-président de Toyota, chargé de la compétitivité, du planning et des opérations industrielles, numéro deux officieux du groupe.