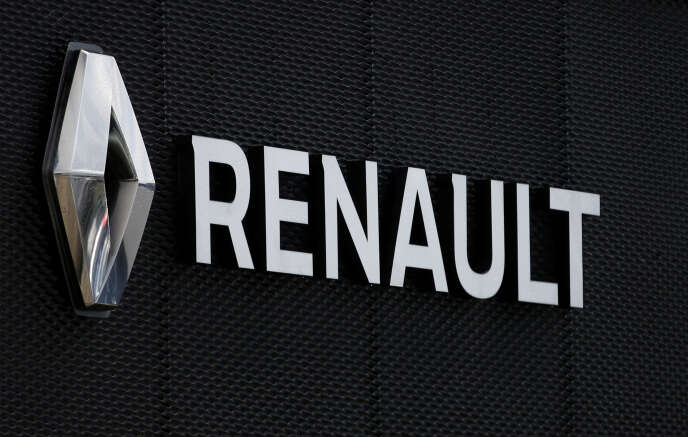Le front syndical contre la réforme des retraites s’est étoffé jeudi 21 novembre avec la décision de la branche cheminots de Confédération française démocratique du travail (CFDT-Cheminots), de plusieurs syndicats d’Electricité de France (EDF) et de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) d’appeler à la grève le 5 décembre.
Réforme des retraites, conditions de travail, précarité, les raisons de cette journée d’action reconductible se multiplient. Revue de détail à un peu moins de quinze jours de la mobilisation.
SNCF. Le gouvernement a raté le train du compromis avec les cheminots : les quatre syndicats représentatifs de la SNCF – CGT-Cheminots, UNSA ferroviaire, SUD-Rail, CFDT-Cheminots – sont lancés dans une grève reconductible à partir du 5 décembre contre la réforme voulue par Emmanuel Macron. Mais la CFDT-Cheminots, ralliée à la mobilisation le 21 novembre, pourrait ne pas appeler à la grève si elle obtient satisfaction dans les prochains jours. Force ouvrière (FO), le cinquième syndicat, participe également.
Laurent Brun (Confédération générale du travail, CGT) prévoit « une grosse journée de mobilisation », y compris dans l’encadrement. Les voyageurs sauront « le 3 décembre dans l’après-midi » quels trains circuleront le 5, précise la direction de la SNCF.
RATP. Mobilisation importante prévue également à la RATP, après la journée très suivie du 13 septembre qui avait mis Paris quasiment à l’arrêt. Les trois syndicats représentatifs de la régie – CFE-CGC, CGT et Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) – ont appelé cette fois-ci à une grève illimitée contre la réforme.
« Le 5 décembre sera a priori aussi fort que le 13 septembre », estime Fabrice Ruiz de la CFE-CGC. « Ce sera une très grosse journée » au vu des « remontées du terrain et des déclarations des agents qui doivent prévenir à l’avance s’ils seront grévistes », explique Bertrand Hammache de la CGT. « On n’est pas très inquiets pour le 6 décembre », qui devrait voir la grève se poursuivre, note Thierry Babec de l’UNSA.
Air France. Les syndicats de pilotes et ceux des hôtesses et stewards n’appellent pas à la grève. En revanche, trois syndicats bien implantés auprès du personnel au sol ont déposé des préavis : FO, premier syndicat toutes catégories, qui souhaite un mouvement reconductible, comme la CGT. SUD-Aérien veut mobiliser le 5 décembre, en scandant « ni retraite à points, ni droits en moins ». Les grévistes impliqués dans l’exploitation aérienne (navigants ou personnel au sol) doivent se déclarer individuellement au plus tard quarante-huit heures avant le début du conflit pour permettre à la compagnie de s’organiser et d’informer ses passagers.
Chez les contrôleurs aériens, le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), premier syndicat, n’appelle pas à la grève, contrairement à l’Union syndicale de l’aviation civile (USAC-CGT), numéro deux. Ces fonctionnaires sont soumis à un système d’astreinte destiné à assurer un service minimal, mais une mobilisation importante pourrait engendrer retards ou annulations de vols.
Routiers. La CGT et FO appellent à une grève illimitée dès le 5 décembre dans le transport urbain et routier de voyageurs, de marchandises, de fonds. Un appel qui concerne également les ambulanciers, les déménageurs ou les taxis.
« On fait ce qu’il faut pour que ce soit suivi », a déclaré Patrice Clos de FO-Transports et Logistique. « Pour le transport urbain et le transport routier de voyageurs, des notifications avant préavis de grève, assez nombreuses, ont été déposées », par exemple « à Lyon, Montpellier, Bordeaux », a-t-il précisé. Dans le privé, aucun préavis n’est nécessaire.
Après les annonces gouvernementales le 20 novembre d’une rallonge budgétaire et une reprise de dettes étalées sur trois ans, jugées insuffisantes, la colère est toujours vive dans le monde hospitalier. Le collectif Inter-Hôpitaux a appelé à une nouvelle « manifestation nationale » samedi 30 novembre. Les internes en médecine sont appelés à une grève illimitée par leur syndicat, l’Intersyndicale des internes (INSI), à partir du 10 décembre pour dénoncer la « dégradation des soins » et réclamer une amélioration de leur statut.
Certains soignants privilégient plutôt une jonction avec la grève interprofessionnelle du 5 décembre contre la réforme des retraites. Une option notamment défendue par les membres du collectif Inter-Urgences, à l’origine de la contestation du monde hospitalier et dont le mouvement de grève débuté en mars dans la capitale s’est étendu à tout le pays, avec encore 268 établissements touchés en début de semaine.
Du côté des syndicats, les fédérations « santé » de la CGT et de FO se sont alignées sur l’agenda de leurs centrales nationales, qui ont averti que le 5 décembre serait « la première journée de grève potentiellement reconductible ». Le Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI – CFE-CGC) a rejoint l’appel à la grève du 5 décembre.
Plusieurs syndicats d’EDF, parmi lesquels la CGT, FO et SUD, ont appelé le 21 novembre, à leur tour, à la grève reconductible le 5 décembre pour protester contre la réforme des retraites.
La CGT appelle à la grève ainsi qu’à des « baisses de production d’électricité, des coupures en énergie des bâtiments publics d’Etat (hors lieux de santé) » ainsi que dans des entreprises de la branche, et à l’inverse à remettre le courant chez les particuliers où il aurait été « injustement coupé », selon un communiqué.
Le Syndicat national des enseignements de second degré-Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU), SUD-Education et l’UNSA-Education appellent à une grève des enseignants le 5 décembre. D’autres syndicats de l’intersyndicale éducation sont également mobilisés. Tous dénoncent en effet une future réforme qui pénalisera, selon eux, les enseignants qui perçoivent peu d’indemnités et de primes.
Plus généralement, dans la fonction publique, la FSU et la fédération CGT des services publics appellent tous les syndicats représentants des agents de la fonction publique à faire grève. Des syndicats de pompiers sont également sur le pont, tout comme ceux de La Poste.
Plusieurs syndicats de police, dont Alliance et l’UNSA, ont menacé le 19 novembre de se joindre au mouvement social du 5 décembre, si le ministère de l’intérieur « ne répond pas à [leurs] attentes ». Ils envisagent de lancer, le jour de mobilisation contre la réforme des retraites, des « actions de 10 heures à 15 heures dans tous les services de police », notamment la « fermeture symbolique des commissariats, le refus de rédiger des PV [procès-verbaux] ou encore des contrôles renforcés aux aéroports et aux péages d’autoroutes ».
Dans leur « assemblée des assemblées » à Montpellier, des « gilets jaunes » ont voté, le 3 novembre, une proposition pour rejoindre la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. « L’heure est à la convergence avec le monde du travail et son maillage de milliers de syndicalistes, qui, comme nous, n’acceptent pas », avaient-ils précisé dans un communiqué de presse.
Plus de dix jours après la tentative d’immolation par le feu d’un étudiant devant un Crous de Lyon, le mouvement étudiant ne décolère pas et réclame des mesures pour lutter contre la précarité étudiante. Surfant sur la grande grève, l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) a appelé à manifester le 5 décembre pour « maintenir la pression » sur le gouvernement et exiger une réévaluation des bourses universitaires. Il a été rejoint par d’autres organisations syndicales et de jeunesse : la Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL), le Mouvement national lycéen (MNL), l’Union nationale lycéenne (UNL).