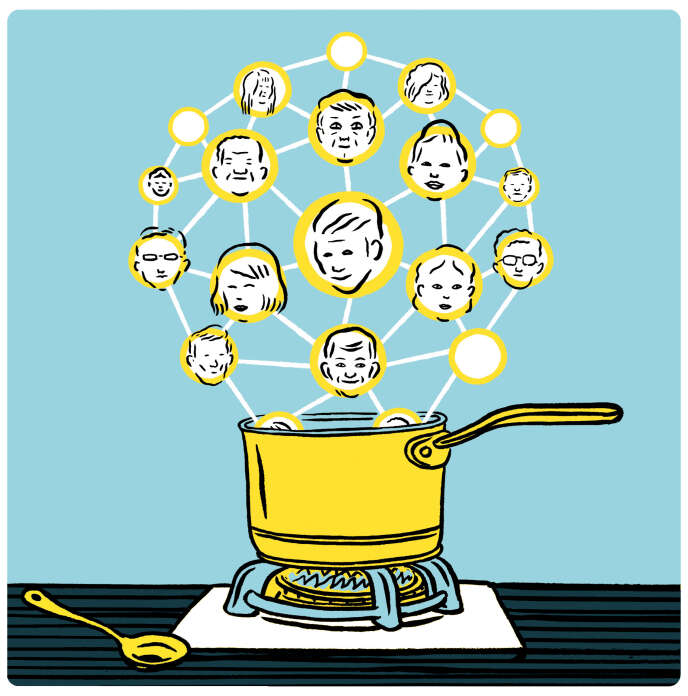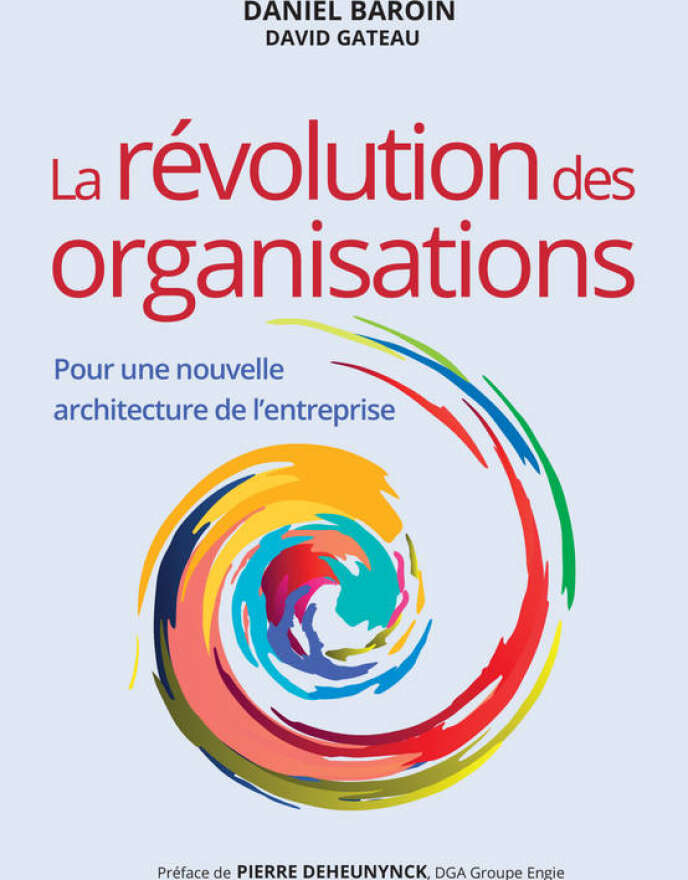Le salarié moderne « un nomade en éternelle migration

Sur un canapé, dans un TGV, dans un café : les agents du tertiaire œuvrent sans lieux fixes. En sont-ils plus libres ? Pas certainement, examine dans sa chronique le journaliste Nicolas Santolaria. Selon lui, le prix à renvoyer pour cette alléguée liberté est exorbitant.
Comme l’assure le philosophe Bruno Latour, nous sommes changés « des migrants de l’intérieur », pas seulement dans notre pays, mais aussi dans nos entreprises, dans nos open spaces, au cœur même de ce qui aménageait nos géographies intimement structurantes. « Si l’angoisse est si profonde, c’est parce que chacun d’entre nous commence à sentir le sol se dérober sous ses pieds. Nous découvrons plus ou moins obscurément que nous sommes tous en migration vers des territoires à redécouvrir et à réoccuper », écrit le philosophe dans Où atterrir ? (La Découverte, 2017).
Travail sous influence
Il n’est qu’à observer l’errance des salariés déambulant dans leur propre boîte à la recherche d’une salle de réunion ad hoc pour comprendre que c’est la sédentarité qui est actuellement devenue problématique. Afin de ne pas être délogé par les utilisateurs pressants de ces espaces mutualisés (« Ah désolé, mais on avait tempéré à 13 h 30 ! »), on en vient souvent à s’installer sur un coin de table à la cafétéria, comme des « Touareg du tertiaire ». D’une certaine manière, la métaphore du nomadisme qui structure aussitôt notre vision du travail sous influence numérique a trop bien fonctionné.
SELON le baromètre Paris Workplace 2018, exécuté par l’IFOP et la Société foncière lyonnaise, 34 % des salariés travaillent désormais au moins une fois par mois en dehors de leur boîte. A cette mobilité externe s’ajoute une mobilité interne, puisque 35 % des personnes interrogées ne restent pas fixées à leur poste, mais s’installent à deux endroits ou plus dans l’entreprise au cours d’une journée type. Entièrement adapté à la « société liquide », le nomade est cet individu qui, tel un agglomérat de 0 et de 1, n’est plus lié à un territoire mais peut se concrétiser, à tout instant, en n’importe quel point de la carte. Le nomade peut soudain apparaître sur la banquette d’un café Starbuck, derrière les canisses d’une paillote corse ou dans le fauteuil d’un TGV lancé à 300 km/h, continuant vaillamment à conduire de front ses activités professionnelles grâce à la portabilité des nouveaux outils de production.
Éternelle migration
Emprisonné à son MacBook Air, l’oreille connectée à son téléphone mobile, ce forçat du circuit de problèmes dessine les contours fatalement un peu flous (la faute à la vitesse) de ce que l’on nomme la « supermobilité ». L4essentielle figuration de cette « déterritorialisation » rendue possible par les outils numériques est sans doute l’agent Smith du film Matrix qui, surfant sur les coordonnées fluctuantes de la matrice, semble capable d’apparaître et de disparaître à l’envi, comme pour nous persuader que la matérialité du monde est un concept caduc.