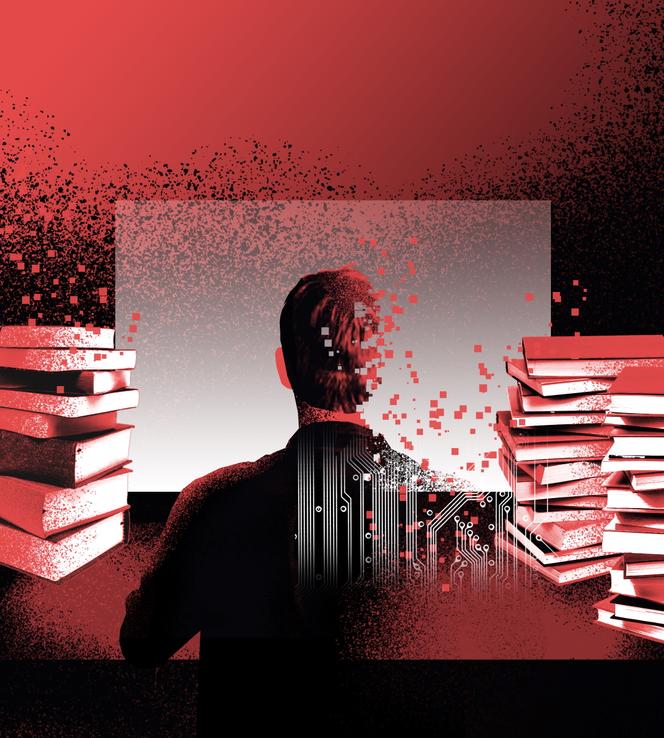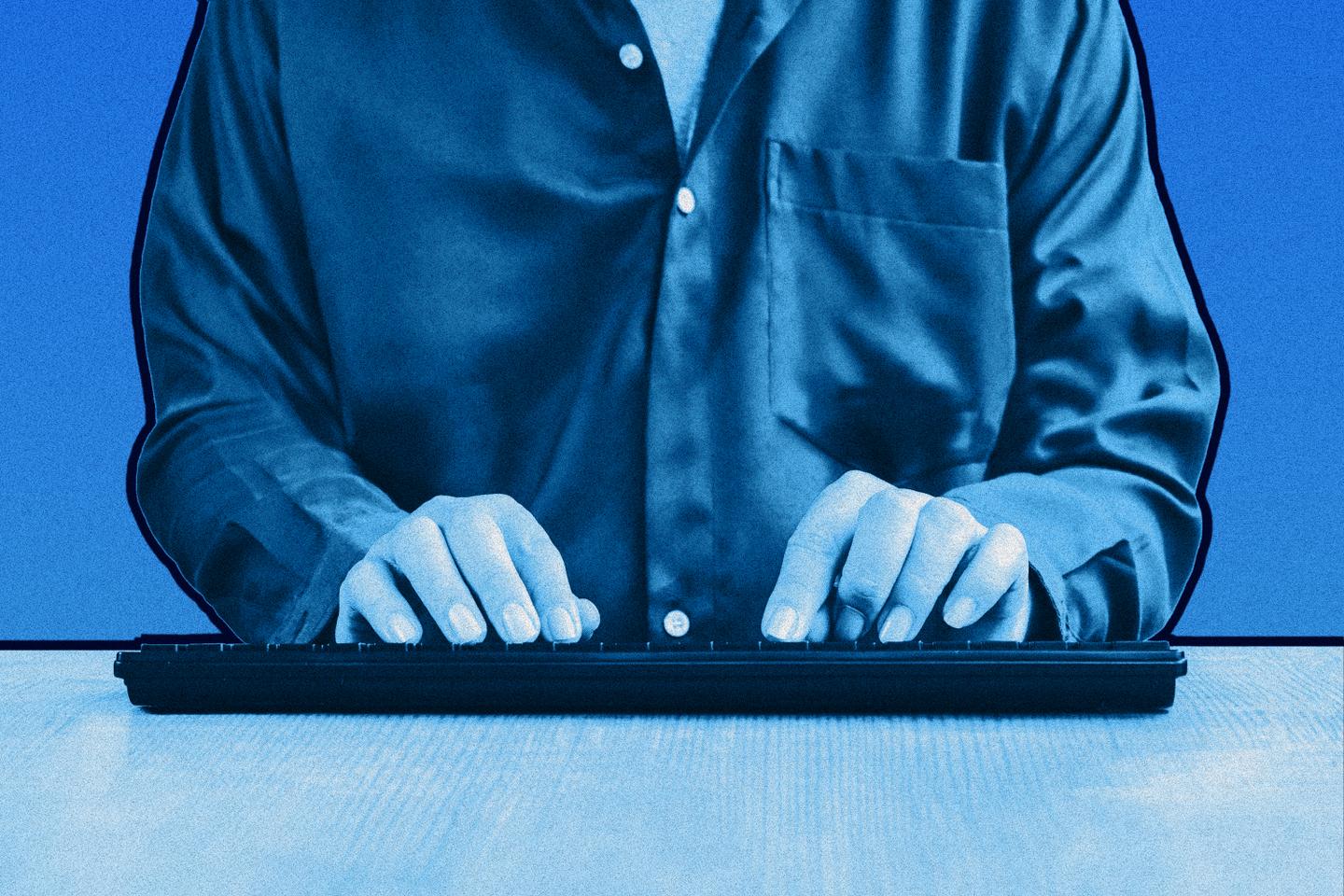Vers une baisse inédite en dix ans des entrées en apprentissage

Vers un atterrissage en douceur ou une descente en piqué ? De début janvier à fin octobre, près de 769 000 contrats d’apprentissage ont été signés dans le privé et dans le public, soit un total inférieur de 4,4 % par rapport à la même période de 2024. Mise en évidence dans une publication diffusée, mardi 30 décembre, par le ministère du travail, cette évolution ne constitue pas une surprise, compte tenu – en particulier – des restrictions budgétaires imposées depuis trois ans à cette voie de formation. Un nouveau tour de vis devant être donné durant les prochaines semaines par le gouvernement, la question qui se pose désormais est de savoir si cette politique en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes risque de dépérir.
Il paraît aujourd’hui acquis que le bilan de 2025 sera moins flatteur que celui de l’exercice précédent, même si les services de l’Etat ne disposent pas encore de toutes les données pour le dire avec précision. Se fondant sur des statistiques fournies par des opérateurs qui évoluent exclusivement dans le privé, le ministère du travail a récemment livré une estimation orientée à la baisse : comparé à 2024, le nombre de contrats d’apprentissage signés au cours des douze derniers mois devrait enregistrer une érosion de 3 % à 4 %, d’après ces calculs rapportés dans le quotidien Les Echos du 26 décembre.
Il vous reste 73.46% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.