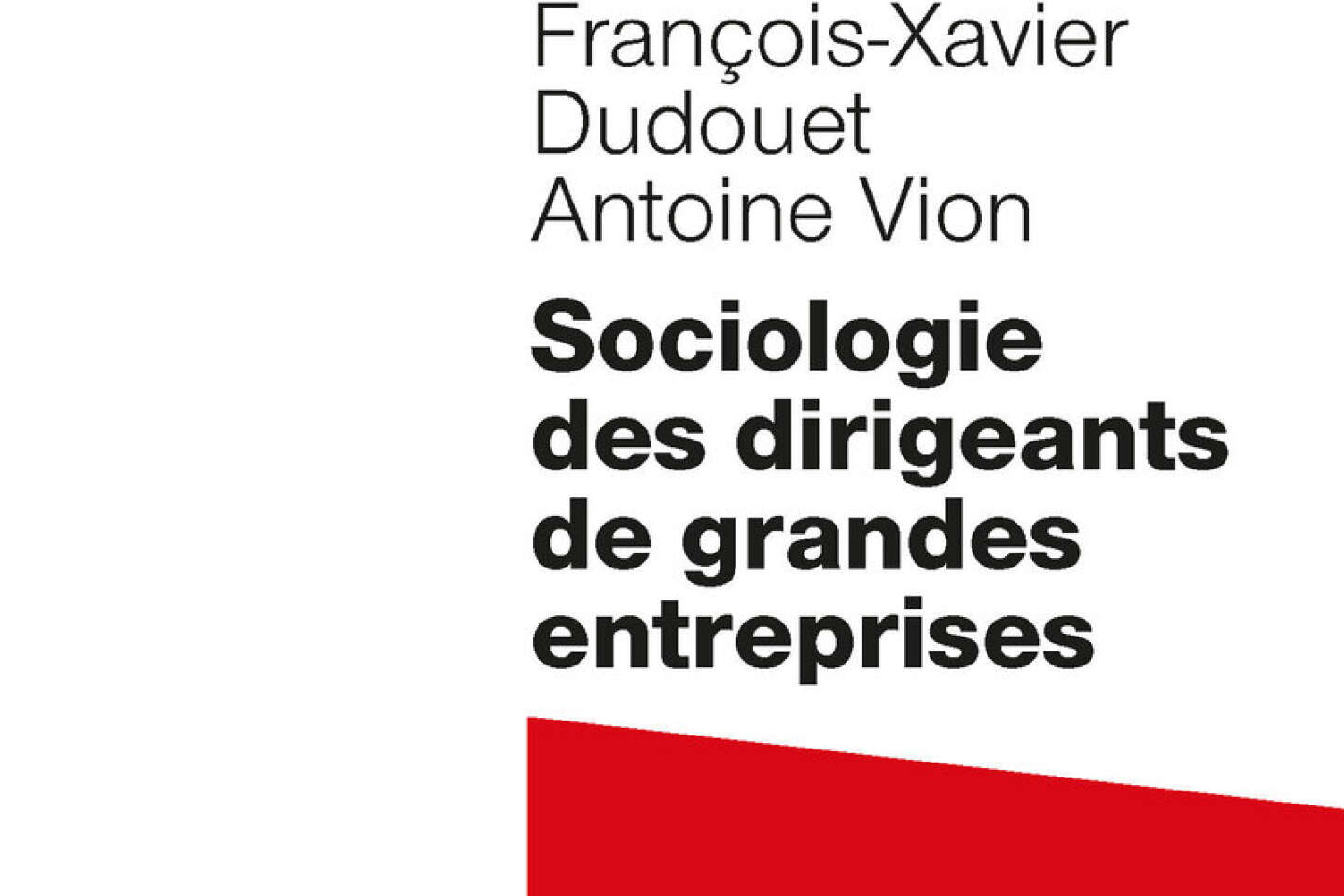Après le mouvement social des contrôleurs de la SNCF qui a provoqué l’annulation d’un TGV sur deux samedi 17 et dimanche 18 février pour le chassé-croisé des vacances d’hiver, la ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement, Marie Lebec, n’a pas exclu mardi de « sanctuariser » des périodes sans grève dans les transports.
« La question de la protection du droit de grève est essentielle, mais je crois qu’on peut s’interroger sur le recours au droit de grève quand on a une mission de service public », a déclaré la ministre déléguée sur Sud Radio.
Pour Mme Lebec, « il y a des moments où on peut estimer qu’il faut sanctuariser ces périodes », a-t-elle ajouté, interrogée sur les initiatives parlementaires des Républicains et des sénateurs centristes qui visent à encadrer le droit de grève, notamment pendant les vacances scolaires ou lors de grands événements.
« Trop, c’est trop », s’était notamment indigné à la mi-février le président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille, auteur d’une proposition de loi permettant au gouvernement de disposer d’un capital annuel de soixante jours d’interdiction de grève, répartis par décret dans une limite de quinze jours par période d’interdiction. « Si on avait affaire à des gens responsables, on ne serait pas obligés d’imaginer des dispositifs de cette nature mais il faut bien protéger les Français », avait-il déclaré.
« Toutes les options sont ouvertes »
Pour Mme Lebec, « la réflexion sur le sujet peut être débattue à l’Assemblée ». « Est-ce que les modalités doivent forcément passer par la loi ? Est-ce que ça peut faire l’objet d’un accord ou autre avec les représentants syndicaux ? Je crois que toutes les options sont ouvertes », a-t-elle estimé. Le premier ministre, Gabriel Attal, avait encouragé le Parlement à s’emparer de ce débat, déplorant « une forme d’habitude, à chaque [période de] vacances (…), d’avoir l’annonce d’un mouvement de grève » des cheminots. « Les Français savent que la grève est un droit », mais « aussi que travailler est un devoir », avait-il dit.
« Boîte de Pandore »
« Ce qu’il faut sanctuariser, c’est le droit de grève, a répliqué mardi la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, interrogée par l’AFP. Je rappelle au gouvernement que le droit de grève est un droit fondamental des travailleurs, inscrit dans la Constitution et dans les normes fondamentales du droit international. Le dernier gouvernement qui a interdit le droit de grève, c’est Vichy. »
Alors que la liberté de circulation est invoquée pour sanctuariser des périodes sans grève, « pendant les manifestations de paysans où ils ont bloqué routes et autoroutes, on n’a pas entendu parler de remise en cause du droit de grève », a réagi le secrétaire général de l’UNSA-Ferroviaire, Didier Mathis, dénonçant un « deux poids, deux mesures ». Une telle mesure, « c’est ouvrir la boîte de Pandore et une fois que c’est ouvert, on ne sait pas jusqu’où ça peut aller », a-t-il mis en garde.
Pour SUD-Rail, « c’est une ligne rouge », a insisté le secrétaire fédéral, Julien Troccaz. « A part mettre de l’huile sur le feu pendant la période, on ne voit pas trop à quoi ça va servir », a-t-il assuré.