Une foule longue s’accumule devant Ground Control. Le site de 6 000 mètres carrés, prisé des Parisiens en réclame de grands espaces, est habituel des longues files d’attente. Cette fois, le public est venu, porte-documents à la main, éprouver sa chance au forum emploi de la SNCF, qui se tenait lundi 13 et mardi 14 mai.Depuis certaines semaines, le groupe ferroviaire déclare, à grand appui de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux et de visualisations publics, vouloir mobiliser 4 500 cheminots en CDI, dont 2 500 pour la seule région Ile-de-France, en 2019. « Cette opération a été lancée car la population ne connaît pas les métiers du ferroviaire, alors que nous sommes l’un des plus gros embaucheurs de France », déclare Benjamin Raigneau, directeur des ressources humaines de la SNCF. Le technocrate de 35 ans déclare :
« Face à l’accroissement du trafic et à l’évolution du groupe, nous explorons des profils variés et des compétences spécifiques. »
Conducteur de train, aiguilleur, ingénieur, mécanicien de maintenance, électricien, agent commercial, forment autant de métiers recherchés par la SNCF. Diplômés ou non, les candidats avaient jusqu’à mardi soir pour découvrir ces postes, déposer un CV ou apercevoir des recruteurs. Au total, quelque 7 000 personnes s’étaient préinscrites sur Internet, s’assurant ainsi un job-dating, c’est-à-dire un entretien express et chronométré avec un embaucheur de la SNCF.
Recherche d’équilibre
Mais lorsqu’elle a voulu s’inscrire, Keysa, 20 ans, s’est vue objecter un refus, les préinscriptions étant complètes. Elle est donc venue au déchaussé, escortée de deux amies, elles aussi munies de leur CV, « parce qu’on sait jamais ». A l’instar des autres personnes consultées dans la longue file d’attente, la jeune femme témoigne d’un environnement professionnel moribond, où les postes sont rares et l’instabilité est de mise.
Titulaire d’un bac ES, Keysa, parvenue de Guadeloupe en métropole il y a un an, travaille dans la restauration six jours sur sept et complète son salaire avec des missions d’intérim. Actuellement, après avoir sollicité la fiche métier de la SNCF, elle se verrait bien agent de service en gare, « pour aider les gens et parce que je suis sociable ». « Ça passe ou ça casse », lance la jeune femme, résumant l’état d’esprit de plusieurs personnes se montrant à l’improviste devant l’entrée du Ground Control.
« C’est la dernière année pour postuler et avoir le statut »
Hocine, 26 ans, accumule les diplômes et recherche maintenant un emploi. Celui qui se décrit comme un digital native déclare que les métiers proposés ne correspondent pas vraiment à ce qu’il cherche, mais il tente « le coup de poker » : « La SNCF est une grosse boîte qui pourrait m’apporter des opportunités », décrit le jeune homme, venu de Creil (Oise) avec un ami. Ce dernier complète : « C’est aussi la dernière année pour postuler et avoir le statut. »
Jusqu’à l’âge de 30 ans, les personnes recrutées d’ici à la fin de l’année pourront en effet profiter du statut de cheminot, qui met à l’abri d’un licenciement économique. Les embauches sous ce statut s’arrêteront au 1er janvier 2020, avec la mise en œuvre de la réforme ferroviaire décidée l’an dernier, qui a donné lieu à un mouvement de grève naissant de trois mois.
Bastien, 20 ans, est venu de Brétigny-sur-Orge (Essonne) pour postuler à la SNCF.
Si la question du statut revient irrégulièrement dans les déclarations que nous avons recueillis, les postulants évoquent surtout des « avantages » secondaires, comme « l’aide au logement » ou encore « les tarifs de train avantageux ». Surtout, c’est l’image de « stabilité » et de « solidité » de l’entreprise qui semble motiver les candidats. Bastien n’a pas encore terminé ses études, qu’il prévoit déjà « le marché du travail compliqué » qui l’attend. L’élève en terminale technologique, venu de Bretigny-sur-Orge (Essonne), se dit « prêt à tout faire à la SNCF ».
« Le couac de la rétribution »
David, lui, a un projet professionnel plus achevé. Le quadragénaire venu d’un petit village du Loir-et-Cher espère réussir un entretien au poste de conducteur. Le candidat, qui conduit des trains « mais sur une petite ligne du groupe Keolis, connaît déjà les horaires décalés et le travail les jours fériés ». Désireux d’intégrer la SNCF depuis plusieurs années, il regarde que « le groupe offre plus de perspectives, une possibilité de se former tout au long de sa carrière, et un salaire plus important ».
David, 48 ans, est venu du Loire-et-Cher pour se présenter en tant que conducteur à la SNCF, lundi 13 mai.
La rémunération forme une motivation pour certains et un inconvénient pour d’autres. Nizar, 35 ans, qui vient de participer à un escape game avant son entretien express au poste de superviseur du réseau électrique ferroviaire, déclare la couleur : « Je ne veux pas travailler en dessous de 2 600 euros net par mois ». L’employé dans les télécommunications se dit lassé des postes de contractuels qu’il cumule depuis huit ans. Mais s’il souhaite « intégrer la fonction publique », il sait que le salaire sera moins juteux que dans le privé.
« Sur certains postes, nous avons une pénurie de candidatures »
Katia (le prénom a été changé à sa demande), chargée de recrutement à la SNCF, qui accomplit pendant deux jours des entretiens de job-dating, évoque certainement « le couac de la rémunération ». La trentenaire, qui a tenu « une quinzaine de dossiers intéressants » en quelques heures, évoque les prétentions salariales trop élevées de certains candidats, postulant à des « métiers en tension », comme la gestion des systèmes informatiques, où l’offre est supérieure à la sollicitation. « Sur certains postes, nous avons une pénurie de candidatures », reconnaît-t-elle, confirmant les fins des syndicalistes du groupe, présents à l’entrée du site.
Pour Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail, ce fait, inédit de la part de la SNCF, souligne « une difficulté à recruter ». « Avec la réforme du ferroviaire, impliquant notamment une remise en cause du statut de cheminot, la SNCF est confrontée à un manque d’attractivité », déclare le délégué syndical, définissant que le nombre de candidats est passé de 300 000 en 2017 à 200 000 en 2018.
Consulté sur ce point, le directeur des ressources humaines réaffirme que « pendant le conflit social, nous avons reçu moins de candidatures ». Et d’additionner : « Regardez le monde dehors qui vient chercher un métier qui a du sens ». Il est 18 heures, le lieu ferme dans quatre heures, plus personne n’attend dehors.



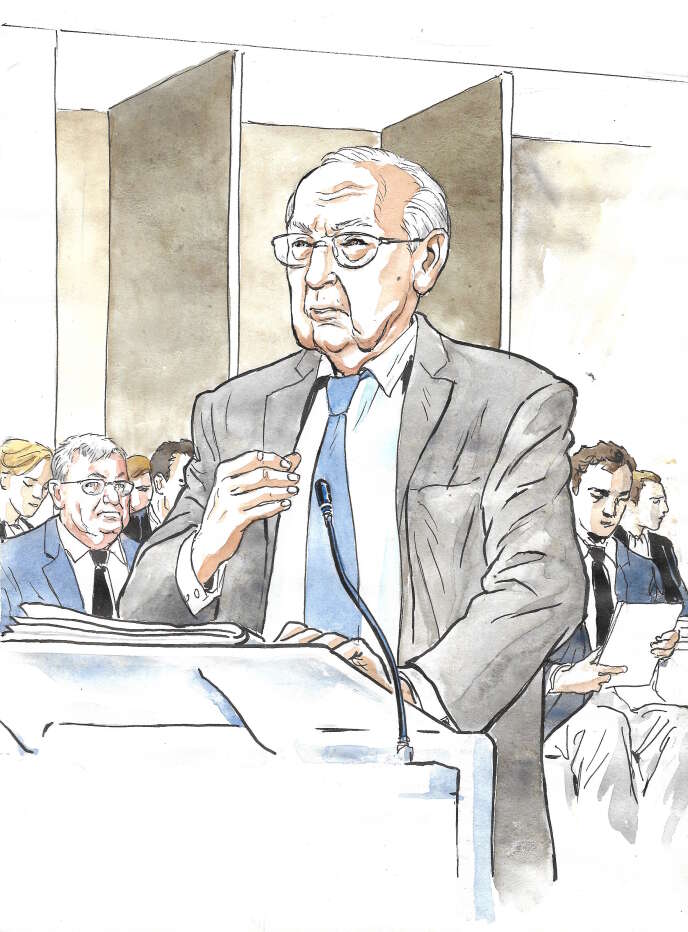



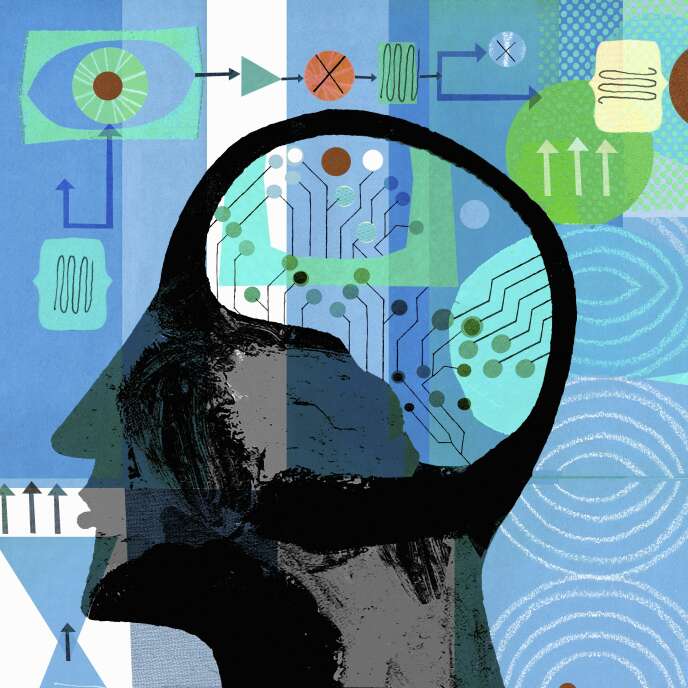

« Face à l’accroissement du trafic et à l’évolution du groupe, nous explorons des profils variés et des compétences spécifiques. »
Conducteur de train, aiguilleur, ingénieur, mécanicien de maintenance, électricien, agent commercial, forment autant de métiers recherchés par la SNCF. Diplômés ou non, les candidats avaient jusqu’à mardi soir pour découvrir ces postes, déposer un CV ou apercevoir des recruteurs. Au total, quelque 7 000 personnes s’étaient préinscrites sur Internet, s’assurant ainsi un job-dating, c’est-à-dire un entretien express et chronométré avec un embaucheur de la SNCF.
Recherche d’équilibre
Mais lorsqu’elle a voulu s’inscrire, Keysa, 20 ans, s’est vue objecter un refus, les préinscriptions étant complètes. Elle est donc venue au déchaussé, escortée de deux amies, elles aussi munies de leur CV, « parce qu’on sait jamais ». A l’instar des autres personnes consultées dans la longue file d’attente, la jeune femme témoigne d’un environnement professionnel moribond, où les postes sont rares et l’instabilité est de mise.
Titulaire d’un bac ES, Keysa, parvenue de Guadeloupe en métropole il y a un an, travaille dans la restauration six jours sur sept et complète son salaire avec des missions d’intérim. Actuellement, après avoir sollicité la fiche métier de la SNCF, elle se verrait bien agent de service en gare, « pour aider les gens et parce que je suis sociable ». « Ça passe ou ça casse », lance la jeune femme, résumant l’état d’esprit de plusieurs personnes se montrant à l’improviste devant l’entrée du Ground Control.
« C’est la dernière année pour postuler et avoir le statut »
Hocine, 26 ans, accumule les diplômes et recherche maintenant un emploi. Celui qui se décrit comme un digital native déclare que les métiers proposés ne correspondent pas vraiment à ce qu’il cherche, mais il tente « le coup de poker » : « La SNCF est une grosse boîte qui pourrait m’apporter des opportunités », décrit le jeune homme, venu de Creil (Oise) avec un ami. Ce dernier complète : « C’est aussi la dernière année pour postuler et avoir le statut. »
Jusqu’à l’âge de 30 ans, les personnes recrutées d’ici à la fin de l’année pourront en effet profiter du statut de cheminot, qui met à l’abri d’un licenciement économique. Les embauches sous ce statut s’arrêteront au 1er janvier 2020, avec la mise en œuvre de la réforme ferroviaire décidée l’an dernier, qui a donné lieu à un mouvement de grève naissant de trois mois.
Bastien, 20 ans, est venu de Brétigny-sur-Orge (Essonne) pour postuler à la SNCF.
Si la question du statut revient irrégulièrement dans les déclarations que nous avons recueillis, les postulants évoquent surtout des « avantages » secondaires, comme « l’aide au logement » ou encore « les tarifs de train avantageux ». Surtout, c’est l’image de « stabilité » et de « solidité » de l’entreprise qui semble motiver les candidats. Bastien n’a pas encore terminé ses études, qu’il prévoit déjà « le marché du travail compliqué » qui l’attend. L’élève en terminale technologique, venu de Bretigny-sur-Orge (Essonne), se dit « prêt à tout faire à la SNCF ».
« Le couac de la rétribution »
David, lui, a un projet professionnel plus achevé. Le quadragénaire venu d’un petit village du Loir-et-Cher espère réussir un entretien au poste de conducteur. Le candidat, qui conduit des trains « mais sur une petite ligne du groupe Keolis, connaît déjà les horaires décalés et le travail les jours fériés ». Désireux d’intégrer la SNCF depuis plusieurs années, il regarde que « le groupe offre plus de perspectives, une possibilité de se former tout au long de sa carrière, et un salaire plus important ».
David, 48 ans, est venu du Loire-et-Cher pour se présenter en tant que conducteur à la SNCF, lundi 13 mai.
La rémunération forme une motivation pour certains et un inconvénient pour d’autres. Nizar, 35 ans, qui vient de participer à un escape game avant son entretien express au poste de superviseur du réseau électrique ferroviaire, déclare la couleur : « Je ne veux pas travailler en dessous de 2 600 euros net par mois ». L’employé dans les télécommunications se dit lassé des postes de contractuels qu’il cumule depuis huit ans. Mais s’il souhaite « intégrer la fonction publique », il sait que le salaire sera moins juteux que dans le privé.
« Sur certains postes, nous avons une pénurie de candidatures »
Katia (le prénom a été changé à sa demande), chargée de recrutement à la SNCF, qui accomplit pendant deux jours des entretiens de job-dating, évoque certainement « le couac de la rémunération ». La trentenaire, qui a tenu « une quinzaine de dossiers intéressants » en quelques heures, évoque les prétentions salariales trop élevées de certains candidats, postulant à des « métiers en tension », comme la gestion des systèmes informatiques, où l’offre est supérieure à la sollicitation. « Sur certains postes, nous avons une pénurie de candidatures », reconnaît-t-elle, confirmant les fins des syndicalistes du groupe, présents à l’entrée du site.
Pour Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail, ce fait, inédit de la part de la SNCF, souligne « une difficulté à recruter ». « Avec la réforme du ferroviaire, impliquant notamment une remise en cause du statut de cheminot, la SNCF est confrontée à un manque d’attractivité », déclare le délégué syndical, définissant que le nombre de candidats est passé de 300 000 en 2017 à 200 000 en 2018.
Consulté sur ce point, le directeur des ressources humaines réaffirme que « pendant le conflit social, nous avons reçu moins de candidatures ». Et d’additionner : « Regardez le monde dehors qui vient chercher un métier qui a du sens ». Il est 18 heures, le lieu ferme dans quatre heures, plus personne n’attend dehors.