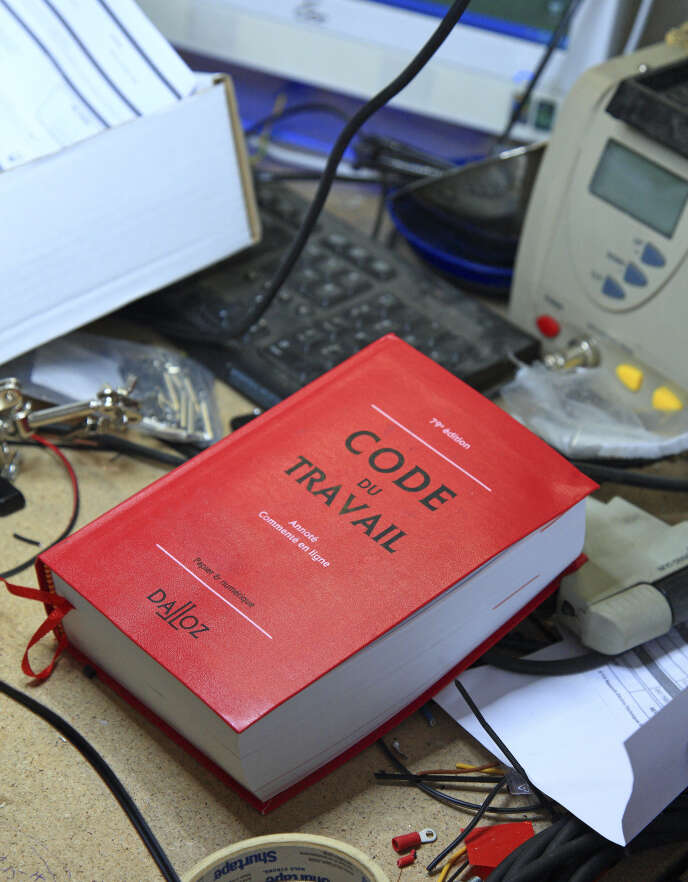Du labeur à l’ouvrage : et si le manager à bout de souffle s’inspirait de l’artisanat
Une spécialiste du futur du travail publie un livre lucide sur le sentiment de perte de sens qui gagne les salariés et leurs managers. Parmi les pistes pour tourner le dos à cette sinistrose, elle propose une voie originale : s’inspirer de l’artisanat. Autonome et créatif, l’artisan maîtrise l’impact de son travail et en retire de la satisfaction.
Vos vacances ne sont plus qu’un lointain souvenir. Vous croulez déjà sous les dossiers, les sollicitations de votre équipe, les injonctions de votre N+1. Halte-là ! Vous n’êtes nullement contraints de retourner dans la roue du hamster jusqu’à l’été prochain. Libre à vous d’adopter une nouvelle posture et de devenir les artisans de votre vie professionnelle. C’est l’invitation enthousiasmante de Laetitia Vitaud dans son livre Du labeur à l’ouvrage, Pourquoi l’artisanat est le futur du travail (1). Il s’adresse à tous mais nous en avons retenu 5 grandes idées qui peuvent inspirer en particulier cadres et managers.
1/ Le labeur est en crise
Place enviable dans l’organigramme, fortes responsabilités, bons salaires, trajectoires toutes tracées… Et pourtant. Face aux réorganisations incessantes, aux injonctions contradictoires et à l’horizon court-termiste devenu indépassable, nombre de cols blancs ressentent usure, surmenage, ou encore ennui. Cette perte de sens, symptôme des « boulots à la con » (1) se double d’une « crise de la cognition » provoquée par le numérique. Laetitia Vitaud pose un diagnostic sans appel : « L’économie de masse se meurt. (…) Elle a conduit les travailleurs, autrefois bien traités, dans une impasse. On a cru qu’il suffisait de continuer à appliquer les recettes du taylorisme pour retrouver le chemin de la croissance. Mais en cherchant à pousser plus loin cette approche, on a privé les travailleurs de l’autonomie à laquelle ils aspirent dans la société actuelle ». On les aurait « aliénés ».
2/ La résistance de l’économie de masse tayloriste
C’est que le labeur n’a pas dit son dernier mot. Laetitia Vitaud décèle l’ambiguïté que vivent de nombreux salariés : « Ils subissent fréquemment leur travail en même temps qu’ils souffrent de la peur de le perdre ». S’ajoute à cela « la peur du déclassement pour eux ou pour leurs enfants ». Pour mieux les retenir, les grandes entreprises adoptent la « cool » attitude des start-up et les outils numériques sans rien changer « au management, aux procédures, à la rigidité hiérarchique, ni à l’autonomie de leurs employés ». Malgré tout, depuis leur cage dorée, certains cadres rêvent de déployer leur créativité.
3/ Freelances, néo-artisans et autres indépendants à la conquête du sens
Ils ont fui l’open-space pour « retrouver le goût de l’ouvrage » et se reconvertir en brasseurs, boulangers ou menuisiers. Ils ont quitté les tours de la Défense pour devenir leur propre patron dans l’informatique, le graphisme ou le marketing. Tous ont troqué le statut de salarié pour la liberté qui rime avec responsabilité, créativité, singularité.
Phénomène remarquable en France, le nombre d’indépendants avoisine 11 % des actifs. Le freelancing, nouvelle idéologie ? L’experte du futur du travail déconstruit les fantasmes. On imagine les travailleurs indépendants « nomades et nombreux à choisir de travailler depuis une plage thaïlandaise. Pourtant la réalité est tout autre. (…) S’ils se disent plus « heureux » que les salariés, ils sont aussi plus anxieux ».
4/ Les travailleurs indépendants « pollinisent » l’entreprise
Incontestablement, la transformation est à l’œuvre. Le sur-mesure, la personnalisation et la qualité exceptionnelle – fondamentaux de la démarche artisanale – dessinent déjà le futur de l’entreprise post-moderne.Par ailleurs, « à force de travailler avec des prestataires extérieurs dont on ne surveille pas le travail chaque instant, les managers s’accoutument à l’idée de confier un projet à un travailleur en lui laissant plus de libertés ». Par cette « pollinisation », les travailleurs autonomes constituent ce que Laetitia Vitaud nomme carrément « l’avant-garde de la réinvention du monde du travail ».
5/ Vers un contrat d’ouvrage
Du labeur à l’ouvrage verse dans la prospective : « cette réinvention ne peut que profiter à ceux qui resteront salariés, c’est-à-dire la majorité des travailleurs ». Prestataires, consultants, intérimaires, freelances, « toujours plus nombreux à travailler pour les entreprises sans être managées par elles », constituent un défi pour l’entreprise pyramidale. Deviendra-t-elle demain « une « plateforme » ou un » hub », plus en phase avec l’économie numérique » ? Laetitia Vitaud prédit que les entreprises « sauront offrir aux salariés les meilleures conditions pour un travail autonome ». Elle prône la création d’un « contrat d’ouvrage », qui doit remplacer le « contrat de labeur ». Comme les artisans façonnant leur ouvrage, elle encourage un nouveau rapport au travail dans les entreprises, qui valorise l’autonomie, la créativité et la responsabilité. Sous contrat d’ouvrage, les managers pourraient retrouver l’impact de leur travail. Et donc un nouveau souffle, porteur de sens ?