La licence de droit, star de Parcoursup
La licence de droit est la formation universitaire la plus demandée par les lycéens sur Parcoursup. Alors que celles-ci se diversifient de plus en plus, le cap de la première année reste difficile à franchir.
La licence de droit est la formation universitaire la plus demandée par les lycéens sur Parcoursup. Alors que celles-ci se diversifient de plus en plus, le cap de la première année reste difficile à franchir.

L’heure est grave pour les journaux français. Presstalis, qui distribue sur tout le territoire 75 % de la presse, est en grande difficulté. Malgré plusieurs plans de sauvetages, l’entreprise, détenue à 73 % par les magazines et à 27 % par les quotidiens, continue de subir de plein fouet la baisse des ventes au numéro des journaux. Lestées d’une dette comprise entre 500 et 600 millions d’euros, en déficit chronique, et en proie à la concurrence féroce de son concurrent, les Messageries lyonnaises de presse (MLP), les ex-Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP) seront confrontées, fin mars, à des échéances financières qu’elles ne peuvent honorer.
Nommé à la mi-février, son nouveau président, Cédric Dugardin, est chargé d’élaborer un énième plan de redressement, sous la surveillance du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), autrement dit de l’Etat. Selon nos informations, M. Dugardin a déjà acté que le dépôt de bilan était inévitable, et a construit un plan dont le montant atteindrait 100 millions d’euros, reposant sur cette douloureuse étape. Elle est loin d’être neutre, même si ce type d’opération permet d’apurer une partie du passif. Une fois déclaré en faillite, Presstalis laissera une importante ardoise auprès des éditeurs, en particulier des magazines. Ces derniers vont perdre entre 120 et 140 millions d’euros, selon les estimations. Ces sommes sont liées aux dernières semaines de ventes en kiosque, dont le produit est reversé aux journaux avec un certain délai. Certains petits éditeurs indépendants pourraient ainsi ne pas survivre à cette faillite. Autre population mise en difficulté par cette défaillance, les kiosquiers et autres maisons de la presse, censés recevoir 17 millions d’euros en mars de la part de l’entreprise.
Point le plus sensible du plan, la lourde restructuration à venir cristallise les inquiétudes. Plus de la moitié des 900 postes de Presstalis pourrait être supprimés. Les effectifs du centre de distribution situé à Bobigny et du siège pourraient être divisés par deux. Les dépositaires, qui distribuent les titres en région et perdent entre 20 et 30 millions d’euros chaque année, seraient fermés ou vendus.
Une saignée sans précédent pour l’entreprise. « On ne restera pas à l’extérieur du débat. L’organisation syndicale est contre le démantèlement », prévient Laurent Joseph, de la CGT-SGLCE. Par le passé, le syndicat a montré qu’il était capable de perturber pendant plusieurs semaines la distribution de la presse pour se faire entendre. Il a rappelé ces derniers jours sa capacité d’action en bloquant un centre de distribution du Parisien.

Tribune. La Cour de cassation a requalifié le 4 mars en contrat de travail la relation contractuelle entre la société Uber et un chauffeur aux motifs qu’il n’avait pas la possibilité de se constituer sa propre clientèle, ni la liberté de fixer ses tarifs, ni celle de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service.
Partout dans le monde, les plates-formes sont mises à mal par les recours qui fleurissent en Europe et aux Etats-Unis, visant à requalifier tous les chauffeurs VTC (véhicules de tourisme avec chauffeurs) en salariés. Pourtant, souhaitons-nous collectivement que les plates-formes de VTC et de livraison ferment leurs portes, nous qui les avons intégrées à notre quotidien, en recourant massivement à la livraison à domicile ou aux transports avec chauffeurs ? Et les travailleurs de ces plates-formes, la plupart chauffeurs et livreurs, le souhaitent-ils aussi, eux qui nous disent qu’ils sont avant tout attachés à leur indépendance ?
Et si la décision de la Cour de cassation provoquait un électrochoc, en nous faisant enfin réaliser qu’elle fait courir le risque de porter un coût d’arrêt aux plates-formes et à l’économie collaborative, mais aussi à leurs travailleurs devenus salariés, en renchérissant le coût du service de façon insupportable pour le client ?
Dans cet arrêt, c’est la connexion à la plate-forme numérique Uber, et donc à l’algorithme, qui crée le lien de subordination entre le chauffeur et la société, faisant pour la première fois rentrer dans les critères de requalification un élément objectif, l’algorithme, et non plus des pratiques individuelles d’entreprises.
L’évolution des plates-formes et de leurs algorithmes a transformé le B2B (« business to business ») en B2B2C (« business to business to consumers »), créant une intermédiation difficilement contrôlable. La loi d’orientation des mobilités de 2019 a tenté d’y apporter des solutions mais, on l’a vu, de façon contestable, avec la tentative de mise en place de chartes censées offrir aux travailleurs des plates-formes des garanties en matière de conditions de travail et de protection sociale.
Finalement, tout cela s’est vu justement sanctionné par le Conseil constitutionnel. Plus récemment, les annonces de regroupement de certaines plates-formes n’ont pas plus convaincu, car elles n’apportent pas de gages de leur capacité à répondre aux problèmes sociaux de leurs travailleurs. Car pour éviter les situations de requalification, l’objectif n’est pas de protéger les plates-formes, mais bien ceux qui y travaillent !

A l’occasion de leur congrès national, en juin 2020, à Strasbourg, les professionnels de la médecine et de la santé au travail pourront assister à un symposium autour du thème : « Le radon, un risque méconnu ». Un intitulé qui reflète au mieux la situation actuelle sur le sujet. De fait, les dangers de ce gaz radioactif sont aujourd’hui encore largement ignorés au sein des entreprises.
« Le radon ? Je sais que le secteur de la construction s’y intéresse car nos sols volcaniques représentent une zone à risque. Mais je n’ai jamais reçu d’information ni de consigne sur le sujet pour ma propre entreprise », résume la DRH d’une PME auvergnate du secteur agroalimentaire. « La méconnaissance peut même toucher les acteurs de la prévention », constate Romain Mouillseaux, expert d’assistance conseil à l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS).
Comme le note Géraldine Ielsch, chef du bureau d’étude et d’expertise du radon à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), « il reste encore un important travail de pédagogie à réaliser. » Il s’agit de faire connaître les nouvelles obligations des entreprises en la matière.
Elles doivent, en effet, depuis juillet 2018, intégrer l’exposition de leurs salariés au radon à leur évaluation des risques professionnels. La communication en direction des organisations visant, dans le même temps, à rappeler les dangers parfois sous-estimés du radon pour la santé. Ce gaz radioactif naturel émis par les sols est en effet classé, depuis 1987, comme « cancérigène certain pour le poumon » par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). « Il est à l’origine de cancers broncho-pulmonaires et on lui attribue environ 3 000 décès annuels », explique l’IRSN, soit 10 % de ce type de cancer.
L’exposition répétée à ce gaz sur plusieurs dizaines d’années représente ainsi « un risque sanitaire chronique dont il faut se préoccuper », note Mme Ielsch. Un « risque fortement augmenté par l’association avec le tabagisme », précise M. Mouillseaux. Cela vaut au domicile comme dans les locaux de l’entreprise, où les salariés passent une part importante de leurs journées.
Le sujet est l’objet d’une attention toute particulière dans certaines régions, où les émissions naturelles de radon sont plus importantes. C’est le cas des zones aux sols granitiques ou volcaniques comme la Bretagne et l’Auvergne. Pour autant, « toutes les entreprises sont concernées par la réglementation, notamment celles dont l’espace de travail est situé en sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments et dans le cas d’activités réalisées en souterrain, explique M. Mouillseaux. Elles doivent au minimum se poser la question du risque radon ».

Carnet de bureau. Depuis le 7 mars, les entreprises ont dû réaliser un entretien bilan des six ans d’évolution professionnelle de leurs salariés. Qui a gagné en compétences ? Quels salaires ont été revalorisés sur cette période ? Il y a six ans, la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle a instauré des entretiens bisannuels, conçus comme autant de points d’étape pour suivre la progression des équipes. Comment les organisations abordent-elles le sujet de l’employabilité ?
Dans quelques grands groupes, l’évolution professionnelle est inscrite dans la politique managériale. « Une certaine mobilité dans l’entreprise apporte un autre regard sur le poste, estime Armelle Levieux, la DRH groupe d’Air liquide. Mais la mobilité s’inscrit dans la durée. Il y a une quinzaine d’années, les opérateurs sur les postes d’experts techniques ne bougeaient pas aussi souvent que les cadres : au bout de cinq ans au lieu de trois. Ils souhaitaient évoluer. On a créé un parcours en six niveaux pour leur permettre de progresser en responsabilité et en salaire tout en restant dans leur expertise. »
Mais les pratiques de formation répondent d’abord aux enjeux d’innovation et de concurrence. « De quelles compétences avons-nous besoin ? », interrogeait ainsi Valérie Le Boulanger, la DRH du groupe Orange, en présentant, début février, le plan stratégique Engage 2025, un investissement de 1,5 milliard d’euros dans la formation. « La digitalisation progresse de façon phénoménale et fait évoluer les compétences requises. L’accompagnement des collaborateurs est un enjeu stratégique. Lorsque Orange Campus a été créé en 2010, c’était une université dédiée au management du groupe. Nous avons décidé de passer à une école en réseau ouverte à tous les salariés », a souligné la DRH.
Recherche de compétences rares et évolutives, intérêt collectif à développer la mobilité interne, la transformation numérique a ainsi conduit la plupart des grands groupes, Orange, comme Air liquide par exemple, à repenser leur référentiel métier. Les entreprises sont amenées à recenser précisément les compétences maison pour déployer un programme de formations qui intègre une redistribution des tâches. « Chez Orange, nous sommes directement impactés par ces mutations. 85 % des emplois de 2030 n’existent pas aujourd’hui », indique Mme Le Boulanger.
L’entreprise a, certes, une responsabilité légale à l’égard de l’employabilité des salariés, mais l’organisation passe à l’acte quand l’intérêt est partagé. Ne compter que sur la contrainte légale pour inciter les entreprises à développer l’employabilité des salariés serait un leurre. Est-ce une raison pour s’en priver ?

Gouvernance. La réforme des retraites a débouché sur une crise sociale qu’on a parfois interprétée, de manière un peu simpliste, comme une incapacité congénitale de la France à se réformer. Pourtant, on ne compte pas les réformes qui, depuis quarante ans, ont été engagées par les gouvernants successifs dans tous les domaines, éducation, travail, retraite, santé… La France semble plutôt être une championne des réformes à répétition.
Il est vrai que la façon dont celle-ci a été menée pourrait servir de cas d’école sur ce que les manageurs appellent la résistance au changement. Depuis les années 1980, les entreprises sont, elles aussi, des championnes de la réforme permanente de leurs structures, de leurs processus ou de leurs règles. L’implication des collaborateurs dans ces changements est indispensable. Que nous enseigne, à ce propos, la récente réforme des retraites ?
Essentiellement, que la prise en considération des différentes raisons de résister à un projet de changement détermine sa réussite. On en relève au moins quatre.
D’abord, les collaborateurs résistent quand ils ne comprennent pas en quoi le changement est nécessaire. En réponse, on déploie une communication intense, en faisant le pari que s’ils saisissent l’urgence du changement, ils y adhèrent. Il ne faut pourtant pas abuser de cette hypothèse : l’expérience montre que ceux qui résistent sont souvent convaincus que les choses doivent évoluer. Les enquêtes révèlent, par exemple, qu’une grande partie des Français pensent que l’âge de la retraite sera repoussé, et pourtant une majorité d’entre eux ont soutenu le mouvement social contre la réforme.
Deuxième raison de résister, la mise en cause des avantages propres à des minorités actives. Les exemples n’en ont pas manqué sur les régimes de retraite. Mais même quand les promoteurs du changement sont exemplaires sur le sujet, ils ne peuvent pas s’étonner qu’il faille affronter ceux qui défendent leurs privilèges. Le plus étonnant, c’est quand les non-privilégiés ne les soutiennent pas.
Cela peut tenir au fait que ceux-ci ne voient pas en quoi le changement proposé améliore leur propre situation. C’est une troisième raison de résister : les initiateurs sont dans l’incapacité de préciser quels seront les effets positifs du changement proposé. On voit ce qui est détruit, pas ce qui est construit. Ainsi en a-t-il été quand les autorités n’ont pas été en mesure de chiffrer les économies attendues ou de proposer un simple simulateur permettant le calcul des retraites après réforme.
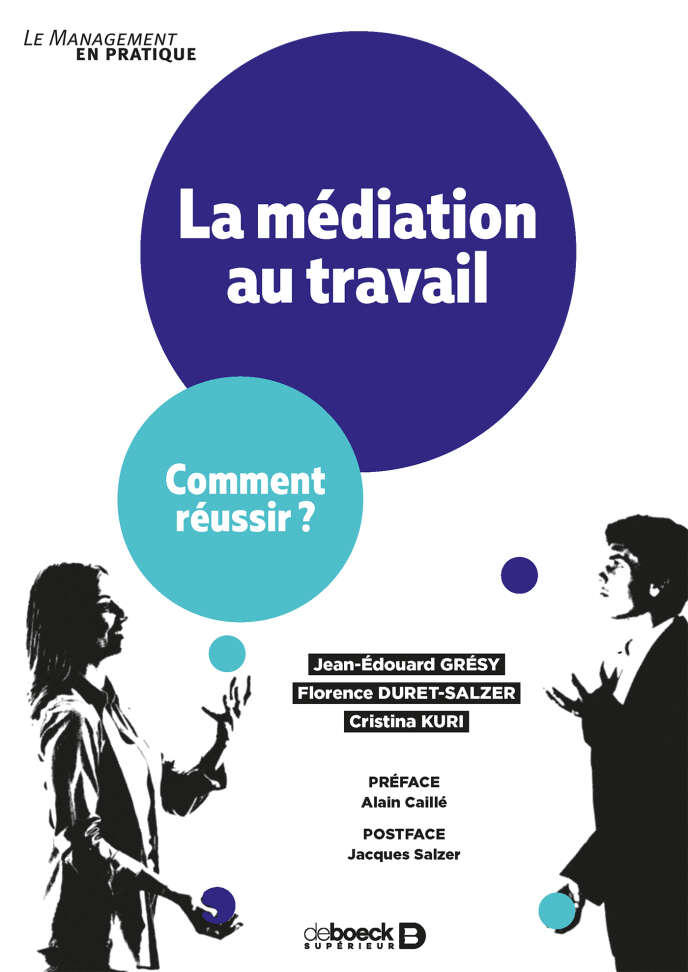
Livre. La médiation existait bien avant de pousser la porte de l’entreprise. Le mot a fait son apparition dans le dictionnaire au XIIIe siècle en France et dispose désormais d’une foule de synonymes : intermédiaire, moyenneur, pacificateur, réconciliateur, etc. Suivre la trace d’une pratique ancestrale qui se transmet oralement est difficile. L’un des premiers écrits sur la médiation, L’Arbitre charitable, date de 1666.
Son auteur, Alexandre de la Roche, explique que le 6 mars 1610, le roi Henri IV avait déclaré que dans « toutes les villes, cours et juridictions du royaume, il y aurait des consultants et arbitres charitables, qui prendraient soin des procès des pauvres gratuitement ». La médiation, c’est « toute une histoire ! », rappellent Jean-Edouard Grésy, Florence Duret-Salzer et Cristina Kuri dans leur essai La Médiation au travail (De Boeck Supérieur).
L’ouvrage s’intéresse à l’installation de la médiation en entreprise, aux ressorts de son déploiement et aux aptitudes du médiateur. Illustré de nombreux exemples et témoignages, le livre s’adresse aux dirigeants, manageurs, collaborateurs convaincus par les vertus d’une conflictualité saine et productive pour maintenir la confiance et renforcer les coopérations.
Pour comprendre pourquoi la médiation se développe dans les organisations, les auteurs examinent sa dimension stratégique, puis précisent le contexte affectif et subjectif dans lequel elle s’opère, sans jamais perdre de vue ses objectifs. La médiation est évidemment un outil de prévention des violences, qu’elles soient sexuelles, sexistes et/ou psychiques, et des discriminations de toute nature. L’employeur a l’obligation légale d’en préserver ses salariés.
Les organisations les moins exposées aux risques psychosociaux ne sont pas celles où l’on se dispute moins, mais celles où l’on débat le mieux sur la manière de réaliser les tâches et d’exercer ses fonctions, soulignent les trois auteurs, respectivement anthropologue médiateur et conférencier, sociologue médiatrice et formatrice et consultante médiatrice et formatrice.
L’ouvrage analyse les étapes de la mise en place d’une médiation en entreprise : « En premier lieu, nous recherchons la raison d’être de la médiation dans les relations du travail, puis nous préciserons la méthode et la posture du médiateur », expliquent les auteurs. Si certaines attitudes du médiateur sont naturelles, d’autres sont acquises grâce à la formation et à l’expérience.

Tribune. Par un arrêt rendu le 4 mars, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé une décision de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019 requalifiant en salarié un conducteur de VTC [véhicule de tourisme avec chauffeur] travaillant en indépendant via la plate-forme Uber. Si une requalification généralisée de ces indépendants en salariés des plates-formes n’est pas souhaitable, il est en revanche temps d’envisager la construction d’un nouveau droit social associé à l’activité professionnelle et protégeant tous les travailleurs, qu’ils soient indépendants ou salariés.
La décision du 4 mars n’est pas le premier cas de requalification en France. La Cour de cassation avait déjà, en novembre 2018, requalifié un travailleur en salarié de la plate-forme de livraison de repas Take Eat Easy, qui a depuis décidé de cesser son activité dans notre pays. Citons également le conseil de prud’hommes de Paris qui, en février 2020, a requalifié le contrat d’un coursier travaillant en prestation de services pour Deliveroo.
La justice a aussi décidé, en mars 2020, de saisir 3 millions d’euros sur les comptes de cette même plate-forme pour non-paiement de cotisations sociales que l’entreprise aurait dû acquitter sur les années 2015-2016. L’arrêt du 4 mars est fondé sur des critères définis par un précédent arrêt rendu en 1996, qui s’appuie lui-même sur la définition du salarié liée au concept de subordination juridique. Uber avait vis-à-vis du conducteur indépendant trois pouvoirs caractérisant l’existence d’un contrat de travail : donner des instructions, contrôler leur exécution, sanctionner leur non-respect.
Il est intéressant de remarquer que ces mêmes critères sont ceux qui fondent des requalifications décidées dans d’autres pays, par exemple par la justice britannique en octobre 2016 contre Uber, ou par une loi californienne de septembre 2019 concernant tous les conducteurs de VTC.
Cette décision fera jurisprudence, les conseils de prud’hommes pourront facilement s’y référer. Il est vrai que de nombreux indépendants travaillant via des plates-formes connaissent des conditions de subordination économique extrêmes et des protections fortement appauvries par rapport à celles des salariés. Cette différence ne concerne pas seulement la protection sociale, et en particulier le chômage, mais aussi de nombreux autres domaines.
Par exemple, le droit social ne confère pas à ces indépendants la protection d’une rémunération minimale équivalente au smic, un encadrement des conditions de travail comme les durées du travail maximales, la possibilité de contester aux prud’hommes les conditions d’une séparation, etc. Ces indépendants portent même, à la différence des salariés, le risque financier lié à l’achat de leur outil de travail, comme le véhicule du conducteur de VTC. Une telle inégalité de droits n’est pas acceptable, elle est contradictoire avec l’objet même du droit social.

« On est obligé de travailler avec le “monstre”. » Le « monstre », pour ce chauffeur (qui souhaite garder l’anonymat), s’appelle Uber. Comme une centaine d’autres conducteurs de VTC, il est venu, vendredi 6 mars, exprimer sa colère contre le fonctionnement de l’application mobile, devant les bureaux de la firme californienne à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
La mobilisation de la profession connaît un regain depuis la décision de la Cour de cassation, le 4 mars, qualifiant de « fictif » le statut d’indépendant d’un conducteur et reconnaissant du même coup son lien avec Uber comme étant un contrat de travail salarié.
Le même chauffeur le répète : travailler avec Uber est une « obligation ». Le service est incontournable, captant entre 60 % et 80 % de la clientèle en Ile-de-France. Après avoir obtenu sa licence de VTC en 2015, il s’est endetté de 40 000 euros pour acheter son véhicule, à l’époque où les conducteurs étaient moins nombreux et les tarifs, plus élevés.
Avant d’arriver à la manifestation, il a pris soin de couper la connexion à Internet sur son smartphone et de désactiver la géolocalisation. « Je ne peux pas me permettre qu’ils voient que j’y participe et suspendent mon compte », explique-t-il.
« Uber vend du rêve aux jeunes, promet 4 000 euros de revenu et une indépendance immédiate. C’est possible, mais à un prix exorbitant ! », commente Makram, autre conducteur présent devant les locaux d’Uber à l’appel de l’intersyndicale nationale VTC. Une fois la commission de 25 % déduite de chaque course, le crédit du véhicule remboursé et l’essence payée, Makram estime gagner entre 1 200 et 1 400 euros brut par mois, pour soixante-dix heures hebdomadaires passées dans sa voiture.
Parmi les reproches adressés à la plate-forme, figurent en première position le manque de transparence sur les courses (dont le tarif estimé et la distance parcourue ne sont pas connus par les chauffeurs avant le départ) et des suspensions de compte considérées comme abusives, sans possibilité de recours.
« Le lien de subordination avec ces entreprises du numérique est patent depuis des années », constate Otto Landreau, chauffeur inscrit sur plusieurs plates-formes (Bolt, Snapcar, Marcel, Chauffeur Privé) pour éviter les tarifs d’Uber, qu’il juge trop bas.
Tout en qualifiant la décision de la Cour de cassation de « bonne nouvelle », peu de conducteurs disent pourtant vouloir mettre fin à leur statut d’auto-entrepreneur et signer un contrat de travail avec l’entreprise américaine. « Je ne veux pas être un salarié sans les avantages et un indépendant avec tous les inconvénients », résume Yahya, conducteur de 44 ans originaire de Lille.
Un collectif de membres de l’Inrae et de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France a exposé, dans une étude prospective, quatre scénarios contrastés d’évolution des relations entre recherche et numérique.